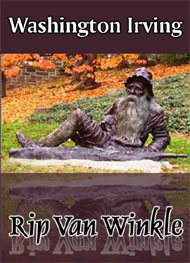
Rip Van Winkle
Enregistrement : Audiocite.net
Publication : 2010-08-21
Lu par Eric
Livre audio de 48min
Fichier mp3 de 44,1 Mo
1722 - Téléchargements - Dernier décompte le 10.01.26
Télécharger
(clic droit "enregistrer sous")Lien Torrent
Peer to peerSignaler
une erreur Commentaires
Warning: Undefined variable $cookies in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 46
Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 46
Warning: Undefined variable $validcookiesSoc in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 46
Washington Irving
Rip Van Winkle
Traduction Théodore Lefebvre.
Le Livre d'esquisses, Poulet-Malassis, 1862 (pp. 32-53).
Quiconque a remonté l'Hudson doit se rappeler les monts Kaatskill. C'est une branche rompue de la grande famille des Apalaches ; on les voit qui filent à l'Ouest du fleuve pour s'élever à une hauteur imposante et dominer le pays d'alentour. À tout changement de saison, à tout changement de temps, que dis-je ? à toute heure du jour, il s'opère un changement dans les teintes et les formes magiques revêtues par ces montagnes, que, de tous côtés, les bonnes femmes regardent comme d'excellents baromètres. Quand le temps est beau et bien assis, elles sont enveloppées de bleu et de pourpre, et leurs contours se détachent vigoureusement sur le ciel pur du soir ; mais quelquefois, lorsque le reste du paysage est sans nuages, il se rassemble autour de leurs sommets une masse de vapeurs grises, qui, colorée aux derniers rayons du soleil couchant, les couronne comme un diadème resplendissant.
Au pied de ces féeriques montagnes le voyageur peut avoir découvert de loin la légère fumée qui s'élève, en ondulant, d'un village dont les toits de planches étincellent entre les arbres, précisément à l'endroit où les teintes bleues de la montagne se mêlent, en se fondant, aux belles teintes vertes du paysage qui se trouve au-dessous. C'est un petit village, mais un village fort ancien, puisqu'il a été fondé par quelques colons hollandais, dans les premiers temps de la province, précisément à l'époque de l'entrée aux affaires du bon Pierre Stuyvesant (que ses cendres reposent en paix!); et quelques-unes des maisons des colons primitifs étaient encore débout il y a peu d'années, construites en petites briques jaunes apportées de Hollande, avec des jalousies et des pignons, sur le devant, surmontés de girouettes.
Dans ce village même, et dans une de ces maisons mêmes (disons toute la vérité, c'était une déplorable victime du temps, elle était battue par tout les vents), vivait, il y a bien des années, à l'époque où le pays était encore une province de la Grande-Bretagne, un simple et brave garçon nommé Rip Van Winkle. C'était un descendant des Van Winkle qui firent si noble figure aux jours glorieux de Pierre Stuyvesant et l'accompagnèrent au siège de Fort-Christine. Pourtant il n'avait que médiocrement hérité du caractère martial de ses ancêtres. J'ai fait observer que c'était un simple et brave garçon ; c'était en outre un bon voisin, un mari docile, se laissant gouverner par sa femme. Et je croirais assez que c'est à cette dernière circonstance qu'il dut cette affabilité qui le rendit si généralement populaire ; car ces hommes-là sont merveilleusement disposés à être complaisants et conciliants au dehors, qui, dans leur intérieur, courbent la tête sous le joug d'une femme acariâtre. Il est incontestable que leur caractère s'assouplit et devient malléable dans la fournaise ardente des tribulations domestiques ; et une mercuriale sous les rideaux vaut tous les sermons du monde pour inculquer les vertus de la patience et de la longanimité. D'où il suit qu'une femme querelleuse peut, à certains égards, être considérée comme une véritable bénédiction ; s'il en est ainsi, Rip Van Winkle était trois fois béni.
Toujours est-il que c'était le grand favori de toutes les bonnes femmes du village, qui, suivant l'usage du beau sexe, prenaient fait et cause pour lui dans toutes les querelles d'intérieur, et ne manquaient jamais, chaque fois qu'elles entamaient ce sujet de caurserie dans leurs commérages du soir, de faire peser tout le blâme sur dame Van Winkle. Les enfants du village, eux, poussaient des cris d'allégresse à son approche. Il assistait à leurs ébats, fabriquait leurs jouets, leur apprenait à enlever les cerfs-volants, à lancer la bille, et leur disait de longues histoires de fantômes, de sorcières et d'Indiens. Quels que fussent l'heure et l'itinéraire qu'il choisît pour leur échapper, il était toujours environné d'une troupe de gamins qui s'accrochaient aux pans de son habit, grimpaient sur son dos et lui jouaient mille tours avec impunité... ; et, dans tout le voisinage, pas un chien n'aurait aboyé après lui.
La grande erreur de Rip et de sa nature, c'était une insurmontable aversion pour toute espèce de travail lucratif. Non pas que cela provînt d'un manque d'assiduité ou de persévérance ; car il restait assis sur un roc humide, avec une ligne aussi longue et aussi pesante que la lance d'un Tartare, à pêcher tout le jour sans murmurer, alors même que pour l'encourager le moindre poisson ne venait pas mordre à l'hameçon. Il portait un fusil de chasse sur l'épaule pendant des heures entières, se fatiguant à traverser les bois et les marais, tantôt sur la colline, tantôt dans la vallée, le tout pour tirer quelques écureuils ou quelques pigeons sauvages. Jamais il ne refusait d'aider un voisin, même dans le travail le plus rude ; et toujours il était le premier quand il s'agissait, comme cela se pratique à la campagne, de donner un coup de main pour écosser le blé de Turquie ou élever un mur de clôture. Les femmes du village avaient aussi l'habitude de l'employer pour remplir leurs messages et satisfaire telles petites fantaisies qui n'auraient pas trouvé des serviteurs dans leurs maris moins complaisants. — En un mot, Rip était prêt à faire la besogne de qui que ce fût, excepté la sienne ; quant à remplir ses devoirs de famille, à s'occuper de sa plantation, il trouvait cela impossible.
En effet, il déclarait que cela ne servait à rien de travailler sur sa plantation ; c'était la plus mauvaise petite pièce de terre de toute la contrée ; tout y venait mal, et y viendrait mal, en dépit de ses efforts. Ses palissades tombaient continuellement en morceaux ; ou sa vache s'égarait, ou bien elle allait au milieu des choux ; les mauvaises herbes étaient sûres de pousser plus vite dans ses champs que partout ailleurs ; la pluie ne manquait jamais d'être à l'ordre du jour quand il avait quelque travail à faire au dehors ; de sorte que bien que les propriétés qui formaient son patrimoine se fussent écornées et dissipées, arpent par arpent, sous son administration, jusqu'à ce qu'il ne lui restât guère plus qu'une pauvre petite bande de blé de Turquie et de pommes de terre, cependant c'était la plantation la plus mal entretenue de tout le voisinage.
Et ses enfants... ils étaient aussi déguenillés, aussi incultes que s'ils n'eussent appartenu à personne. Son fils Rip, polisson engendré à son image même, promettait d'hériter des mœurs en même temps que des vieux habits de son père. On le voyait ordinairement trotter, comme un poulain, derrière sa mère, équipé d'une paire de braies mise au rebut par son père, et qu'à grand'peine il retenait d'une main, de même qu'une belle dame relève sa robe quand le temps est mauvais.
Rip Van Winkle, cependant, était un de ces heureux mortels, à l'humeur joviale et facile, qui ne voient que le beau côté des choses ; à qui il importe peu de manger du pain blanc ou du pain bis, pourvu qu'ils l'aient obtenu avec le moins de peine, de fatigue possible ; qui aimeraient mieux mourir de faim sur un penny que de travailler pour gagner une livre. Laissé à lui-même, il eût, parfaitement satisfait, traversé la vie en sifflant ; mais sa femme lui étourdissait continuellement les oreilles de sa paresse, de son insouciance, de la ruine qu'il apportait dans sa famille. Le matin, à midi et le soir sa langue allait toujours, et quoi qu'il pût dire ou faire il était sûr de faire jaillir une source intarissable d'éloquence domestique. Rip n'avait qu'une réponse pour tous les sermons de cette espèce, et par suite d'un fréquent usage elle était passée en habitude : il haussait les épaules, secouait la tête, levait les yeux au ciel, mais ne disait rien, ce qui cependant ne manquait jamais de ranimer la verve épuisée de sa moitié ; de sorte qu'il était obligé de battre en retraite et d'évacuer la place — seul moyen d'être chez lui qu'ait, à vrai dire, mari en puissance de femme.
Le seul adhérent qu'eût Rip au logis était son chien Wolf, qui était aussi maltraité que son maître ; car dame Van Winkle les regardait comme des compagnons en paresse, et même voyait particulièrement Wolf de très-mauvais œil, comme la cause des fréquentes pérégrinations de son maître. Il est certain qu'il avait toute l'ardeur qui convient à un honorable chien ; que jamais animal plus courageux ne battit les bois. — Mais quel courage peut résister à la terreur montante que répand une langue de femme qui ne s'arrête jamais ? Du moment où Wolf passait le seuil du logis, sa fierté tombait, sa queue balayait tristement le sol ou s'entortillait entre ses pattes ; il se faufilait l'oreille basse, de l'air d'un gibier de potence, jetant plus d'un regard oblique à l'adresse de dame Van Winkle, et dès que le manche à balai ou la cuiller à pot commençait à préluder, il gagnait en glapissant la porte avec la plus grande précipitation.
Les années de mariage s'accumulèrent, et l'horizon s'assombrit de plus en plus pour Rip : un caractère acidulé ne s'adoucit jamais avec l'âge ; une langue bien affilée est le seul instrument tranchant qu'un usage continuel ne fasse qu'aiguiser. Pendant longtemps il eut l'habitude de se consoler, quand il était chassé de la maison, en fréquentant une sorte de club permanent des sages, des philosophes et autres paresseux personnages de l'endroit, lequel tenait ses sessions sur un banc placé devant une petite auberge que signalait un portrait rubicond de sa majesté Georges III. C'est là que, l'été, ils avaient coutume de se prélasser mollement à l'ombre des journées tout entières, s'entretenant nonchalamment des caquets du village, ou disant, d'interminables et soporifiques histoires à propos de rien. Mais un homme d'État n'aurait pas perdu son argent s'il avait entendu les profondes discussions qui survenaient parfois, quand par hasard un vieux journal laissé par un voyageur de passage leur tombait entre les mains. Avec quelle solennité ils en écoutaient le contenu, que laissait tomber d'une voix traînante Derrick Van Bummel, le maître d'école, pétulant et érudit petit homme que le mot le plus formidable du dictionnaire n'était pas capable d'intimider ! Avec quelle sagesse ils délibéraient sur les événements publics quelques mois seulement après qu'ils s'étaient passés !
Les opinions de cette assemblée étaient entièrement dirigées par Nicolas Vedder, un patriarche du village, et le propriétaire de l'auberge, à la porte de laquelle il faisait la sieste du matin jusqu'au soir, prenant tout juste assez de mouvement pour éviter le soleil et rester dans l'ombre d'un arbre aux larges branches, de sorte que les voisins pouvaient, d'après ses évolutions, dire l'heure avec autant de précision que d'après un cadran solaire. Il est vrai qu'on l'entendait rarement parler, mais il fumait incessamment sa pipe. Ses adhérents, cependant (car tout grand homme a ses adhérents), le comprenaient parfaitement et savaient comment recueillir son opinion. Quand une chose lue ou racontée devant lui lui déplaisait, on remarquait qu'il fumait sa pipe avec véhémence ; que les bouffées de tabac sortaient courtes, fréquentes, irritées. Était-il satisfait, il attirait la fumée doucement, tranquillement, et la chassait en nuages légers et gracieux ; quelquefois même, retirant la pipe de sa bouche et laissant la vapeur parfumée onduler autour de son nez, il inclinait gravement la tête en signe de complet assentiment.
Mais, hélas ! l'infortuné Rip fut à la fin délogé de cette redoutable position par sa querelleuse moitié, qui, faisant tout à coup irruption, rompait la tranquillité de l'assemblée et en traitait les membres de bons à rien. Cet auguste personnage, Nicolas Vedder lui-même, n'était pas à l'abri des atteintes de la langue entreprenante de cette terrible virago, qui l'accusait, tout net, d'encourager son mari dans ses habitudes de fainéantise.
Le pauvre Rip finit par se trouver presque réduit au désespoir ; et sa seule ressource, pour échapper aux labeurs de la plantation et aux clameurs de sa femme, était de prendre en main un fusil et de s'enfoncer dans les bois. Là, il s'asseyait parfois au pied d'un arbre, et partageait le contenu de son bissac avec Wolf. Entre eux régnait la sympathie : c'était un compagnon de souffrance et de persécution. « Pauvre Wolf, » disait-il, « ta maîtresse te fait mener une vie de chien ; mais ne fais pas attention, mon garçon : tant que je vivrai tu n'auras pas besoin d'un ami pour te soutenir ; » et Wolf remuait légèrement la queue, regardait fixement son maître en face, et si les chiens sont susceptibles de pitié, je crois fermement qu'il le plaignait aussi du plus profond de son cœur.
Un beau jour d'automne, pendant une longue excursion de cette espèce, Rip avait, sans y songer, escaladé l'une des parties les plus élevées des monts Kaatskill. Il était en train de se livrer à son divertissement favori, la chasse à l'écureuil, et les solitudes endormies avaient retenti et retenti encore des détonations de son fusil. L'après-midi était très-avancée ; haletant, épuisé, il se jeta sur un monticule vert que recouvraient des pâturages de montagne et qui couronnait le front d'un précipice. Par une ouverture entre les arbres il pouvait embrasser tout le pays qui s'étendait à ses pieds, bien des milles de terres magnifiquement boisées. Il voyait dans le lointain l'Hudson majestueux, dessous, mais bien au-dessous de lui, poursuivant sa course silencieuse mais imposante, que venait seulement accidenter la réflexion d'un nuage couleur de pourpre ou la voile d'une barque aux mouvements pleins de lenteur qui dormait çà et là sur son sein poli et se perdait enfin dans le bleu des hautes terres.
Il regarda de l'autre côté, et ses yeux plongèrent dans une vallée profonde, sauvage, solitaire, effrayante, dont le fond était rempli de blocs énormes détachés des rochers qui surplombaient, et qu'éclairaient à peine les rayons réfléchis du soleil couchant. Pendant quelque temps Rip contempla cette scène d'un air rêveur : le soir s'avançait toujours, les montagnes commençaient à projeter sur les vallées leurs longues ombres bleues ; il vit que la nuit tomberait bien avant qu'il pût atteindre le village, et il poussa un profond soupir en songeant à l'accueil gracieux que lui réservait dame Van Winkle.
Comme il était sur le point de descendre, il entendit à une certaine distance une voix qui criait : « Rip Van Winkle ! Rip Van Winkle ! » Il regarda autour de lui, mais il ne vit rien... qu'une corneille qui passait dans son vol solitaire, perpendiculairement à la montagne. Il crut avoir été le jouet de son imagination, et se retournait pour continuer à descendre, quand il entendit le même cri retentir dans l'air assoupi du soir : « Rip Van Winkle ! Rip Van Winkle ! » — En même temps le dos de Wolf se hérissa ; il poussa un grognement étouffé, et, se serrant contre son maître, jeta dans le vallon un regard effrayé. Rip alors sentit une vague appréhension s'emparer de lui ; il -jeta dans la même direction un regard inquiet, et aperçut une forme étrange escaladant lentement et péniblement les rochers, courbée sous le poids d'un fardeau qu'elle portait sur son dos. Il fut surpris de voir un être humain dans cet endroit sauvage et non fréquenté ; mais supposant que c'était quelque habitant du voisinage qui avait besoin de son secours, il se hâta de descendre pour le lui prêter.
Comme il approchait davantage, il fut encore plus surpris de la singularité de la personne de l'étranger. C'était un petit vieillard construit en carré, avec des cheveux épais et incultes et une barbe grise. Il était habillé à l'ancienne mode hollandaise — un pourpoint de drap serré autour de la taille, plusieurs paires de hauts-de-chausses, dont le dernier très-ample, orné de rangées de boutons sur les côtés et de nœuds aux genoux. Sur son épaule était un lourd barriquaut, qui paraissait plein de liquide. Il fit signe à Rip d'approcher et de l'aider à le porter. Quoique sur ses gardes et se défiant de cette nouvelle connaissance, Rip se rendit à son désir avec son empressement ordinaire, et s'aidant l'un l'autre tour à tour, ils escaladèrent une gorge étroite, formée, selon toute apparence, par le lit d'un torrent desséché de la montagne. Comme ils gravissaient, Rip entendit de temps à autre de longs roulements, semblables à des coups de tonnerre dans le lointain, qui paraissaient sortir d'un profond ravin, ou plutôt d'une crevasse, entre des rochers au front élevé, vers lequel menait le sentier difficile, qu'ils avaient pris. Il s'arrêta pendant un instant, mais il supposa que c'était le bruit sourd d'une de ces pluies accompagnées de tonnerre et sans durée, fréquentes dans les montagnes sur les hauteurs, et se remit en marche. Ils traversent le ravin et arrivent à une cavité qui ressemblait à un petit amphithéâtre, entourée de rochers à pic, sur le bord desquels des arbres qui surplombaient laissaient tomber leurs branches, de sorte qu'on n'apercevait que par échappées le ciel bleu et les nuages dorés du couchant. — Pendant tout ce temps, Rip et son compagnon avaient silencieusement poursuivi leur marche pénible ; car, bien que le premier fût grandement curieux de savoir quel motif pouvait pousser à transporter un barriquaut de liqueur sur cette montagne sauvage, cependant il y avait autour de cet inconnu je ne sais quoi de singulier, d'incompréhensible, qui inspirait une crainte respectueuse et n'admettait pas la familiarité.
Comme ils entraient dans l'amphithéâtre, il se présenta de nouveaux sujets d'étonnement. Sur une surface plane, au centre, se trouvait un groupe de personnages au regard étrange, jouant aux quilles. Leur costume bizarre n'était pas à la mode du pays : les uns portaient des pourpoints courts, les autres des jaquettes, avec de longs couteaux dans leurs ceinturons ; la plupart d'entre eux avaient d'énormes hauts-de-chausses, dans le genre de ceux du guide de Rip. Leurs figures, aussi, étaient particulières : l'un avait une grosse tête, une large face et des yeux microscopiques ; le nez de cet autre semblait être tout son visage, lequel était surmonté d'un chapeau blanc, en forme de pain de sucre, qu'ornait une petite queue de coq, de couleur rouge. Tous ils avaient des barbes, mais de formes et de couleurs diverses. Il y en avait un qui paraissait être le chef. C'était un vieux gentleman robuste, à l'air martial ; il portait un pourpoint garni de dentelles, Un large ceinturon soutenant un couteau de chasse, un chapeau haut de forme et à plume, des bas rouges, et des souliers à talons élevés, ornés de rosettes. Ce groupe remit en mémoire à Rip les figures d'une vieille peinture flamande qu'il avait vue dans la salle à manger de Dominie Van Shaick, le curé du village, et qui avait été apportée de Hollande à l'époque de l'établissement de la colonie.
Mais ce qui surtout parut étrange à Rip, c'est que, bien que ces gens s'amusassent évidemment, ils gardassent cependant les physionomies les plus sérieuses, le plus mystérieux silence : c'était la plus mélancolique partie de plaisir à laquelle il eût jamais assisté. Rien n'interrompait le calme de cette scène, rien, si ce n'est le bruit que faisaient les boules en roulant, qui retentissait le long des montagnes comme le tonnerre grondant dans le lointain.
Quand Rip et son compagnon s'approchèrent d'eux, ils abandonnèrent tout à coup leur partie, et le regardèrent avec des yeux si fixes, si glacés, d'un air si étrange, si extraordinaire, si éteint, que le cœur lui manqua, que ses genoux s'entrechoquèrent. Alors son compagnon vida le contenu du barriquaut dans de grands flacons et lui fit signe de servir la compagnie. Il obéit avec crainte et tremblement ; ils burent à longs traits la liqueur dans un profond silence, et puis retournèrent à leur jeu.
Le respect et la crainte de Rip se dissipèrent par degrés. Il alla jusqu'à s'aventurer, quand aucun regard n'était fixé sur lui, à goûter le liquide ; il trouva, rien qu'au parfum, qu'il ressemblait beaucoup à de l'excellente eau-de-vie de genièvre. Il avait naturellement le gosier en pente et fut bientôt tenté d'y retourner. Une rasade en provoqua une autre ; enfin ses visites au flacon devinrent si fréquentes, que le sentiment l'abandonna ; ses yeux nagèrent dans leurs orbites, sa tête pencha graduellement, et il tomba dans un profond sommeil.
En s'éveillant il se trouva sur le monticule vert d'où, pour la première fois, il avait vu le vieillard du vallon. Il se frotta les yeux : — on était au matin, et le soleil brillait ; les oiseaux voletaient çà et là et jetaient leurs notes aiguës dans les buissons ; l'aigle tournait sur lui-même au haut des airs, se maintenant contre la brise pure de la montagne. « Assurément, pensa Rip, je n'ai pas dormi ici toute là nuit. » Il chercha à se rappeler ce qui s'était passé avant qu'il ne s'endormit — l'homme étrange au barriquaut de liqueur — le ravin de la montagne — la retraite sauvage au milieu des rochers — le groupe mélancolique qui jouait aux quilles — le flacon. « Oh ! ce flacon ! ce maudit flacon ! pensa Rip, — quelle excuse apporter à dame Van Winkle ? »
Il chercha des yeux son fusil, mais au lieu de son fusil de chasse si net, si brillant, il n'en trouva près de lui qu'un vieux dont le canon était incrusté de rouille, dont la platine ne tenait plus, et dont le bois était vermoulu. Il soupçonna alors les graves personnages de la montagne de lui avoir joué un tour, et, après l'avoir gorgé de liqueur, de lui avoir dérobé son fusil. Wolf aussi avait disparu ; mais il pouvait s'être élancé à la poursuite d'un écureuil ou d'une perdrix. Il le siffla et l'appela à grands cris, le tout en vain ; l'écho répéta son sifflement et ses cris, mais du chien pas de nouvelles.
Il résolut de revisiter le théâtre des jeux de la soirée dernière, et s'il rencontrait quelqu'un de ceux qu'il y avait vus, de lui demander son chien et son fusil. Comme il se levait pour se mettre en marche, il s'aperçut qu'il avait les articulations raides, que son agilité ordinaire lui faisait défaut. « Ces lits de montagne ne me conviennent pas, pensa Rip, et si cette folie me valait un rhumatisme je passerais un joli quart d'heure avec dame Van Winkle. » Il descendit, non sans difficulté, dans le vallon : il trouva le ravin que son compagnon et lui avaient escalade le soir précèdent ; mais, à sa grande surprise, un ruisseau de montagne y jetait maintenant son écume, sautant de rocher en rocher, babillant et remplissant la vallée de murmures. Cependant il s'efforça de grimper sur les côtés, se frayant péniblement un chemin à travers des buissons de bouleau, de sassafras, de coudrier, trébuchant parfois ou s'embarrassant dans les ceps de vigne sauvage qui entrelaçaient d'un arbre à l'autre leurs tendrons caressants et formaient sous ses pas une espèce de réseau.
Enfin il atteignit l'endroit où le ravin leur avait fourni un passage à travers les rochers pour gagner l'amphithéâtre ; il ne restait aucune trace d'une semblable ouverture. Les rochers formaient une muraille élevée, impénétrable, sur laquelle le torrent roulait sa nappe d'écume diaphane, pour se jeter dans un bassin large et profond, noir des ombres de la forêt prochaine. Ici le pauvre Rip fut enfin forcé de s'arrêter. Il appela, il siffla encore son chien : pas d'autre réponse que les croassements d'une bande de corbeaux oisifs se jouant dans l'air, bien au-dessus de lui, autour d'un arbre desséché qui avançait sur un précipice éclairé par le soleil. Confiants dans leur élévation, ils semblaient regarder en bas et se moquer des perplexités du pauvre homme. Que faire ? — la matinée s'avançait, et Rip, mourant de faim, sentait le besoin de déjeuner. Il était désolé d'abandonner son chien et son fusil ; il redoutait l'accueil de sa femme ; mais ce n'était pas une raison pour se laisser mourir de faim dans les montagnes. Il secoua la tête, mit sur l'épaule son fusil rouillé, et, le cœur plein d'affliction et d'anxiété, tourna ses pas du côté du logis.
Comme il approchait du village, il rencontra nombre de gens, mais personne qu'il reconnût, ce qui le surprit un peu, car il avait jusqu'alors cru connaître tous les habitants des pays d'alentour. Leurs vêtements, aussi, étaient d'une mode différente de celle à laquelle il était habitué. Ils le regardaient tous fixement avec d'égales marques de surprise, et, chaque fois qu'ils jetaient sur lui les yeux, portaient invariablement la main à leur menton. La continuelle répétition de ce geste amena Rip, involontairement, à faire de même. — Alors, à son grand étonnement, il s'aperçut que sa barbe avait grandi d'un pied.
Il venait d'atteindre les premières maisons du village. Une bande d'enfants inconnus se mit à sa poursuite en l'accablant de huées, en se montrant du doigt sa barbe grise. Les chiens, les chiens, parmi lesquels il ne retrouvait pas une vieille connaissance, aboyaient sur son passage. Le village même était changé ; il était maintenant plus large, plus populeux. Il découvrait des rangées de maisons qu'il n'avait jamais vues auparavant, et celles qui avaient été ses retraites favorites avaient disparu. Des noms inconnus étaient sur les portes — des visages inconnus aux croisées — tout était inconnu. Son esprit se chargea de noirs pressentiments ; il en vint à se demander si tout ce qui l'entourait et lui-même n'étaient pas enchantés. C'était pourtant bien là le village où il était né, qu'il n'avait quitté que de la veille ; c'étaient bien là les monts Kaatskill — c'était bien l'Hudson qui roulait dans le lointain ses eaux argentées — chaque colline, chaque vallée était bien telle qu'elle avait toujours été. — Rip était cruellement embarrassé : — « Ce flacon de la nuit dernière, pensait-il, a laissé ma pauvre tête bien vide ! »
Ce ne fut pas sans difficulté qu'il trouva le chemin qui conduisait à sa maison. Il en approcha dans un muet respect, respect mêlé de crainte, s'attendant à chaque minute à entendre la voix perçante de dame Van Winkle. Il trouva la maison en ruine — le toit écroulé, les fenêtres brisées, et les portes sorties des gonds. Un chien à demi mort de faim, qui ressemblait à Wolf, rôdait à l'entour. Rip l'appela par son nom, mais le chien grogna, montra les dents et passa. L'accueil n'était pas gracieux. — « Jusqu'à mon chien, soupira le pauvre Rip, qui m'a oublié !»
Il entra dans la maison, où, c'est une justice à lui rendre, dame Van Winkle avait toujours fait régner l'ordre et la propreté. Elle était vide, triste, et, suivant toute apparence, abandonnée. Cette désolation dompta toutes ses craintes conjugales : — il appela à grands cris sa femme et ses enfants — les chambres solitaires retentirent un moment du bruit de sa voix, et puis tout rentra dans le silence.
Il en sortit précipitamment, et courut à son ancien asile, l'auberge du village — mais elle aussi avait disparu. À la place se dressait, tout rachitique, un grand bâtiment en bois, aux grandes fenêtres béantes, dont quelques-unes avaient été brisées et rajustées avec de vieux chapeaux et de vieux jupons, et sur la porte était peint : « Hôtel de l'Union, tenu par Jonathan Doolittle. » Au lieu du grand arbre qui servait à abriter la petite et tranquille auberge hollandaise d'autrefois, s'élevait maintenant une grande perche nue, avec quelque chose au bout qui ressemblait à un bonnet de nuit de couleur rouge, et au bout de cette perche flottait un drapeau sur lequel il y avait un singulier assemblage d'étoiles et de barres. — Tout cela était étrange, incompréhensible. Il reconnut cependant sur l'enseigne la face vermeille du roi Georges, au-dessous de laquelle il avait si souvent fumé paisiblement sa pipe ; mais ici s'était encore opéré une singulière métamorphose. L'habit rouge avait été remplacé par un justaucorps bleu et couleur chamois ; au lieu d'un sceptre, la main tenait une épée, la tête était ornée d'un chapeau à cornes, et au-dessous était peint en gros caractères : « Le général Washington. »
Il y avait, comme de coutume, beaucoup de monde autour de la porte, mais personne que Rip reconnût. Le caractère même du groupe semblait changé : il y régnait un ton de dispute, je ne sais quoi d'affairé, de remuant, au lieu du flegme accoutumé, du calme soporifique d'autrefois. En vain chercha-t-il des yeux le sage Nicolas Vedder avec sa large face, son double menton, sa longue et belle pipe, laissant échapper des nuages de fumée de tabac au lieu d'inutiles discours ; ou Van Bummel, le maître d'école, communiquant le contenu d'un vieux journal. À leur place, un individu maigre, au regard bilieux, les poches pleines de billets, pérorait avec véhémence sur les droits des citoyens,— les élections, — les membres du congrès, — la liberté, — Bunker's Hill, — les héros de soixante-seize — et autres expressions qui sonnaient aux oreilles troublées de Van Winkle comme un vrai jargon babylonien.
L'apparition de Rip avec sa longue barbe grise, son fusil de chasse couvert de rouille, son costume bizarre et l'armée de femmes et d'enfants qui se pressait sur ses talons, eut bientôt attiré l'attention des politiques de taverne. Ils s'amassèrent autour de lui, l'examinant de la tête aux pieds avec la plus grande curiosité. L'orateur se précipita vers lui, et, le prenant légèrement à part, s'enquit « de quel côté il votait : » Rip le regarda fixement, d'un air distrait et stupide. Un autre individu, de petite taille, mais qui se donnait beaucoup de mouvement, le tira par le bras, et, se haussant sur la pointe des pieds, lui glissa dans l'oreille : « Êtes-vous fédéraliste ou démocrate ? » Rip se mettait encore l'esprit à la torture pour saisir la question, quand un habile et vieux gentleman à mine dictatoriale et coiffé d'un chapeau à cornes finissant en pointe d'aiguille s'ouvrit un passage à travers la foule, que sur son chemin il repoussait à droite et à gauche avec ses coudes, et se plantant devant Van Winkle, un bras sur la hanche, l'autre appuyé sur sa canne, pendant que ses yeux perçants et son chapeau pointu plongeaient, pour ainsi dire, au fond de son âme, lui demanda d'un ton austère « ce qui l'amenait aux élections avec un fusil sur l'épaule et un rassemblement derrière lui, et s'il avait l'intention de faire une émeute dans le village ? » « Hélas ! Messieurs, s'écria Rip quelque peu alarmé, je suis un pauvre homme bien paisible, natif de l'endroit, et un loyal sujet du roi, Dieu le bénisse ! »
À ces mots le même cri échappa à tous les assistants : — « Un tory ! un tory ! un espion ! un réfugié ! Chassez-le, qu'il disparaisse ! » Ce fut à grand'peine que l'important personnage au chapeau à cornes parvint à rétablir l'ordre, et qu'ayant pris un air dix fois plus rébarbatif, il demanda derechef à cet accusé, à cet inconnu, ce qu'il était venu faire et qui il cherchait. Le pauvre homme lui assura bien humblement qu'il n'avait pas de mauvaises intentions, mais était simplement en quête de quelques-uns de ses voisins qui avaient l'habitude de fréquenter la taverne.
« Bien. — Qui sont-ils ? — Nommez-les. »
Rip se recueillit un moment et demanda : « Où est Nicolas Vedder ? »
Il se fit un silence de quelques instants ; enfin, un vieillard répondit d'une voix grêle et flûtée : « Nicolas Vedder ? Eh quoi ! il est mort et enterré depuis dix-huit ans. Il y avait dans le cimetière une tombe de bois qui servait à dire tout ce qui le concernait ; mais elle est pourrie ; elle n'existe plus — non plus.
— Où est Brom Dutcher ?
— Oh ! il est parti pour l'armée au commencement de la guerre. Les uns disent qu'il a été tué à l'assaut de Stony-Point, — d'autres qu'il s'est noyé dans une bourrasque, au pied de Antony's Nose. Je ne sais pas — il n'est jamais revenu.
— Où est Van Bummel, le maître d'école ?
— Il est aussi parti pour la guerre, a été un grand général de milice, et fait maintenant partie du congrès. »
En apprenant ces tristes changements intervenus dans son pays natal, parmi ses amis, en se trouvant ainsi seul au monde, Rip sentit son cœur s'en aller. Et puis chacune de ces réponses l'embarrassait, car elles supposaient un si énorme laps de temps ; elles avaient trait à des choses qu'il ne pouvait comprendre : là guerre — le congrès — Stony-Point ; — il n'eut pas le courage de s'informer davantage de ses amis, mais s'écria dans un mouvement de désespoir : « N'est-il donc personne ici qui connaisse Rip Van Winkle ?
— Oh ! Rip Van Winkle ! répliquèrent deux ou trois ; oh ! bien certainement ! Voilà Rip Van Winkle là-bas, appuyé contre un arbre.»
Rip regarda, et vit l'exacte copie de lui-même, tel qu'il était quand il s'était acheminé vers la montagne ; aussi paresseux, selon toute apparence, et certainement tout aussi déguenillé. Le pauvre homme était maintenant entièrement confondu. Il douta de sa propre identité, s'il était lui-même ou un autre. Au milieu de son trouble l'homme au chapeau à cornes lui demanda qui il était et quel était son nom.
« Dieu le sait ! s'écria-t-il tout hors de lui ; je ne suis pas moi-même — je suis un autre — c'est moi qui suis là-bas — non — c'est un autre dans mes souliers. — J'étais moi-même la nuit dernière, mais je me suis endormi sur la montagne, et l'on m'a changé mon fusil, et tout est changé, et je suis changé, et je ne puis dire quel est mon nom, ni qui je suis ! »
Les spectateurs commencèrent à se regarder les uns les autres, à secouer la tête, à cligner des yeux d'une façon très-significative, et à se frapper le front avec leurs doigts. On se dit aussi à l'oreille qu'il fallait se saisir du fusil pour empêcher le vieillard de faire quelque malheur. À cette suggestion, l'important personnage au chapeau à cornes se retira avec une certaine précipitation. En ce moment critique, une femme fraîche et avenante perça la foule afin de jeter un coup d'œil sur l'homme à la barbe grise. Elle tenait dans ses bras un enfant joufflu, qui, effrayé par les regards de Rip, se mit à pleurer. « Silence, Rip ! s'écria-t-elle ; taisez-vous, petit sot : le vieillard ne vous fera pas de mal. » Le nom de l'enfant, les traits de la mère, le son de sa voix, éveillèrent dans son esprit un monde de souvenirs.
« Quel est votre nom, ma bonne femme ? lui demanda-il.
— Judith Gardenier.
— Et le nom de votre père ?
— Ah ! pauvre homme, son nom était Rip Van Winkle. Il y a vingt ans qu'il partit de la maison avec son fusil, et jamais on n'en a plus entendu parler. — Son chien revint à la maison sans lui, mais s'il s'est tué, ou s'il a été enlevé par les Indiens, c'est ce que personne ne peut dire. Je n'étais alors qu'une petite fille. »
Rip n'avait plus qu'une question à adresser, mais il le fit en balbutiant :
« Et votre mère ?
— Oh ! elle aussi elle est morte, mais depuis quelque temps seulement ; elle se rompit un vaisseau dans un accès de colère contre un colporteur de la Nouvelle-Angleterre. »
Il y avait au moins dans cette nouvelle quelque chose de consolant. Le brave homme ne put se contenir plus longtemps. Il prit sa fille et son enfant dans ses bras. « Je suis votre père ! s'écria-t-il — le jeune Rip Van Winkle autrefois — le vieux Rip Van Winkle aujourd'hui ! — Est-ce que personne ne reconnaît le pauvre Rip Van Winkle ? » Tous étaient saisis d'étonnement ; mais enfin une vieille femme se sépara de la foule, vint en chancelant, porta sa main à son front, et, le regardant par-dessous au visage pendant un moment, s'écria : « Mais assurément, c'est Rip Van Winkle — c'est lui-même ! Soyez le bienvenu parmi nous, vieux voisin. — Eh bien ! où avez-vous été pendant ces vingt longues années? »
L'histoire de Rip fut bientôt dite, car ces vingt années n'avaient été pour lui qu'une seule nuit. Les voisins ouvraient de grands yeux en l'écoutant ; on en vit quelques-uns se faire signe de l'œil et pousser leurs langues contre leurs joues, et l'important personnage au chapeau à cornes, qui, l'alarme dissipée, était revenu sur le champ de bataille, abaissa les coins de sa bouche et secoua la tête. — Là-dessus toute l'assemblée se mit à secouer la tête.
On résolut néanmoins de prendre l'avis du vieux Peter Vanderdonk, que l'on voyait s'avancer lentement sur la chaussée. C'était un descendant de l'historien de ce nom, qui écrivit un des premiers la chronique de la province. Peter était le plus ancien habitant du village, et très versé dans tous les événements merveilleux et les traditions du pays d'alentour. Il reconnut Rip immédiatement, et confirma son dire de la façon la plus satisfaisante. Il assura à la compagnie que c'était un fait transmis par son ancêtre, l'historien, que les monts Kaatskill avaient toujours été hantés par des êtres étranges. On affirmait que le grand Hendrick Hudson, celui qui découvrit le premier la rivière et le pays, y tenait une espèce de veille tous les vingt ans avec son équipage de la Demi-Lune ; qu'il lui était ainsi permis de revoir le théâtre de ses aventures et de jeter un regard tutélaire sur le fleuve et la grande cité qui portent son nom. Il ajoutait que son père les avait vus une fois dans leur antique costume hollandais, jouant aux quilles dans un creux de la montagne, et que lui-même avait entendu, par une après-midi d'été, le bruit des boules, qui ressemblait à des coups de tonnerre dans le lointain.
Afin d'abréger une longue histoire, nous dirons que la foule se dissipa pour retourner aux soins plus importants de l'élection. La fille de Rip le prit chez elle pour vivre ensemble ; elle avait une maison bien commode, bien garnie, et pour mari un bon gros fermier en qui Rip reconnut un des bambins qui avaient l'habitude de grimper sur son dos. Quant au fils et à l'héritier de Rip, seconde édition de son père, qu'il avait vu appuyé contre un arbre, on l'employait à travailler sur la ferme ; mais il marquait une disposition héréditaire à s'appliquer à toute autre chose qu'à sa besogne.
Rip reprit alors ses promenades et ses habitudes d'autrefois. Il eut bientôt retrouvé plusieurs de ses anciennes connaissances ; mais leur caractère s'était déplorablement modifié avec les années, et il préféra se faire des amis parmi la génération naissante, auprès de laquelle il fut bientôt en grande faveur.
N'ayant rien à faire à la maison, et étant arrivé à cet heureux âge où un homme peut être impunément oisif, il reprit sa place sur le banc à la porte de l'auberge, et fut vénéré comme un des patriarches du village, une chronique du vieux temps — « avant la guerre. » Il se passa quelque temps avant qu'il pût prendre part aux causeries d'une façon complète, avant qu'on pût lui faire saisir les événements étranges qui avaient eu lieu pendant sa torpeur ; comment il se faisait qu'il y avait eu une révolution, puis la guerre — que le pays avait repoussé le joug de la vieille Angleterre — et qu'au lieu d'être le sujet de S. M. Georges III, il était maintenant citoyen libre des États-Unis. Rip, dans le fait, n'était pas un politique : les variations des États et des empires l'affectaient assez médiocrement ; mais il était une espèce de despotisme sous lequel il avait longtemps gémi — l'empire de la cornette. Heureusement que son règne était fini ; il avait retiré son cou du joug matrimonial, et pouvait entrer et sortir quand il lui plaisait, sans avoir à redouter la tyrannie de dame Van Winkle. Toutes les fois qu'on prononçait son nom, cependant, il secouait la tête, haussait les épaules et levait les yeux au ciel, ce qui pouvait passer pour l'expression de sa résignation à sa destinée, ou de la joie qu'il éprouvait de sa délivrance.
Il avait coutume de raconter son histoire à tous les étrangers qui arrivaient à l'hôtel de M. Doolittle. On remarqua d'abord qu'il variait sur quelques points chaque fois qu'il la disait, ce qui, à n'en pas douter, venait de ce qu'il était tout récemment éveillé. Elle finit cependant par prendre un caractère de fixité : c'est celle-là que nous avons racontée, et il n'y avait pas dans le voisinage un homme, une femme ou un enfant qui ne la sût par cœur. Il en est bien qui affectèrent toujours de douter de son authenticité, qui répétèrent que Rip avait eu une absence d'esprit, et que c'était un sujet sur lequel il n'avait pas encore la tête bien saine ; mais les vieux habitants d'origine hollandaise y ajoutèrent presque universellement foi, et aujourd'hui même ils n'entendent jamais retentir le tonnerre sur les monts Kaatskill, par une orageuse après-midi d'été, qu'ils ne disent : « Hendrick Hudson et sa bande sont en train de jouer aux quilles ; » et c'est, dans le voisinage, un vœu familier à tous les maris menés par leurs femmes, quand la vie leur pèse lourde sur les bras, que de pouvoir puiser le repos dans le flacon de Rip Van Winkle.
Source: http://fr.wikisource.org
Rip Van Winkle
Traduction Théodore Lefebvre.
Le Livre d'esquisses, Poulet-Malassis, 1862 (pp. 32-53).
Quiconque a remonté l'Hudson doit se rappeler les monts Kaatskill. C'est une branche rompue de la grande famille des Apalaches ; on les voit qui filent à l'Ouest du fleuve pour s'élever à une hauteur imposante et dominer le pays d'alentour. À tout changement de saison, à tout changement de temps, que dis-je ? à toute heure du jour, il s'opère un changement dans les teintes et les formes magiques revêtues par ces montagnes, que, de tous côtés, les bonnes femmes regardent comme d'excellents baromètres. Quand le temps est beau et bien assis, elles sont enveloppées de bleu et de pourpre, et leurs contours se détachent vigoureusement sur le ciel pur du soir ; mais quelquefois, lorsque le reste du paysage est sans nuages, il se rassemble autour de leurs sommets une masse de vapeurs grises, qui, colorée aux derniers rayons du soleil couchant, les couronne comme un diadème resplendissant.
Au pied de ces féeriques montagnes le voyageur peut avoir découvert de loin la légère fumée qui s'élève, en ondulant, d'un village dont les toits de planches étincellent entre les arbres, précisément à l'endroit où les teintes bleues de la montagne se mêlent, en se fondant, aux belles teintes vertes du paysage qui se trouve au-dessous. C'est un petit village, mais un village fort ancien, puisqu'il a été fondé par quelques colons hollandais, dans les premiers temps de la province, précisément à l'époque de l'entrée aux affaires du bon Pierre Stuyvesant (que ses cendres reposent en paix!); et quelques-unes des maisons des colons primitifs étaient encore débout il y a peu d'années, construites en petites briques jaunes apportées de Hollande, avec des jalousies et des pignons, sur le devant, surmontés de girouettes.
Dans ce village même, et dans une de ces maisons mêmes (disons toute la vérité, c'était une déplorable victime du temps, elle était battue par tout les vents), vivait, il y a bien des années, à l'époque où le pays était encore une province de la Grande-Bretagne, un simple et brave garçon nommé Rip Van Winkle. C'était un descendant des Van Winkle qui firent si noble figure aux jours glorieux de Pierre Stuyvesant et l'accompagnèrent au siège de Fort-Christine. Pourtant il n'avait que médiocrement hérité du caractère martial de ses ancêtres. J'ai fait observer que c'était un simple et brave garçon ; c'était en outre un bon voisin, un mari docile, se laissant gouverner par sa femme. Et je croirais assez que c'est à cette dernière circonstance qu'il dut cette affabilité qui le rendit si généralement populaire ; car ces hommes-là sont merveilleusement disposés à être complaisants et conciliants au dehors, qui, dans leur intérieur, courbent la tête sous le joug d'une femme acariâtre. Il est incontestable que leur caractère s'assouplit et devient malléable dans la fournaise ardente des tribulations domestiques ; et une mercuriale sous les rideaux vaut tous les sermons du monde pour inculquer les vertus de la patience et de la longanimité. D'où il suit qu'une femme querelleuse peut, à certains égards, être considérée comme une véritable bénédiction ; s'il en est ainsi, Rip Van Winkle était trois fois béni.
Toujours est-il que c'était le grand favori de toutes les bonnes femmes du village, qui, suivant l'usage du beau sexe, prenaient fait et cause pour lui dans toutes les querelles d'intérieur, et ne manquaient jamais, chaque fois qu'elles entamaient ce sujet de caurserie dans leurs commérages du soir, de faire peser tout le blâme sur dame Van Winkle. Les enfants du village, eux, poussaient des cris d'allégresse à son approche. Il assistait à leurs ébats, fabriquait leurs jouets, leur apprenait à enlever les cerfs-volants, à lancer la bille, et leur disait de longues histoires de fantômes, de sorcières et d'Indiens. Quels que fussent l'heure et l'itinéraire qu'il choisît pour leur échapper, il était toujours environné d'une troupe de gamins qui s'accrochaient aux pans de son habit, grimpaient sur son dos et lui jouaient mille tours avec impunité... ; et, dans tout le voisinage, pas un chien n'aurait aboyé après lui.
La grande erreur de Rip et de sa nature, c'était une insurmontable aversion pour toute espèce de travail lucratif. Non pas que cela provînt d'un manque d'assiduité ou de persévérance ; car il restait assis sur un roc humide, avec une ligne aussi longue et aussi pesante que la lance d'un Tartare, à pêcher tout le jour sans murmurer, alors même que pour l'encourager le moindre poisson ne venait pas mordre à l'hameçon. Il portait un fusil de chasse sur l'épaule pendant des heures entières, se fatiguant à traverser les bois et les marais, tantôt sur la colline, tantôt dans la vallée, le tout pour tirer quelques écureuils ou quelques pigeons sauvages. Jamais il ne refusait d'aider un voisin, même dans le travail le plus rude ; et toujours il était le premier quand il s'agissait, comme cela se pratique à la campagne, de donner un coup de main pour écosser le blé de Turquie ou élever un mur de clôture. Les femmes du village avaient aussi l'habitude de l'employer pour remplir leurs messages et satisfaire telles petites fantaisies qui n'auraient pas trouvé des serviteurs dans leurs maris moins complaisants. — En un mot, Rip était prêt à faire la besogne de qui que ce fût, excepté la sienne ; quant à remplir ses devoirs de famille, à s'occuper de sa plantation, il trouvait cela impossible.
En effet, il déclarait que cela ne servait à rien de travailler sur sa plantation ; c'était la plus mauvaise petite pièce de terre de toute la contrée ; tout y venait mal, et y viendrait mal, en dépit de ses efforts. Ses palissades tombaient continuellement en morceaux ; ou sa vache s'égarait, ou bien elle allait au milieu des choux ; les mauvaises herbes étaient sûres de pousser plus vite dans ses champs que partout ailleurs ; la pluie ne manquait jamais d'être à l'ordre du jour quand il avait quelque travail à faire au dehors ; de sorte que bien que les propriétés qui formaient son patrimoine se fussent écornées et dissipées, arpent par arpent, sous son administration, jusqu'à ce qu'il ne lui restât guère plus qu'une pauvre petite bande de blé de Turquie et de pommes de terre, cependant c'était la plantation la plus mal entretenue de tout le voisinage.
Et ses enfants... ils étaient aussi déguenillés, aussi incultes que s'ils n'eussent appartenu à personne. Son fils Rip, polisson engendré à son image même, promettait d'hériter des mœurs en même temps que des vieux habits de son père. On le voyait ordinairement trotter, comme un poulain, derrière sa mère, équipé d'une paire de braies mise au rebut par son père, et qu'à grand'peine il retenait d'une main, de même qu'une belle dame relève sa robe quand le temps est mauvais.
Rip Van Winkle, cependant, était un de ces heureux mortels, à l'humeur joviale et facile, qui ne voient que le beau côté des choses ; à qui il importe peu de manger du pain blanc ou du pain bis, pourvu qu'ils l'aient obtenu avec le moins de peine, de fatigue possible ; qui aimeraient mieux mourir de faim sur un penny que de travailler pour gagner une livre. Laissé à lui-même, il eût, parfaitement satisfait, traversé la vie en sifflant ; mais sa femme lui étourdissait continuellement les oreilles de sa paresse, de son insouciance, de la ruine qu'il apportait dans sa famille. Le matin, à midi et le soir sa langue allait toujours, et quoi qu'il pût dire ou faire il était sûr de faire jaillir une source intarissable d'éloquence domestique. Rip n'avait qu'une réponse pour tous les sermons de cette espèce, et par suite d'un fréquent usage elle était passée en habitude : il haussait les épaules, secouait la tête, levait les yeux au ciel, mais ne disait rien, ce qui cependant ne manquait jamais de ranimer la verve épuisée de sa moitié ; de sorte qu'il était obligé de battre en retraite et d'évacuer la place — seul moyen d'être chez lui qu'ait, à vrai dire, mari en puissance de femme.
Le seul adhérent qu'eût Rip au logis était son chien Wolf, qui était aussi maltraité que son maître ; car dame Van Winkle les regardait comme des compagnons en paresse, et même voyait particulièrement Wolf de très-mauvais œil, comme la cause des fréquentes pérégrinations de son maître. Il est certain qu'il avait toute l'ardeur qui convient à un honorable chien ; que jamais animal plus courageux ne battit les bois. — Mais quel courage peut résister à la terreur montante que répand une langue de femme qui ne s'arrête jamais ? Du moment où Wolf passait le seuil du logis, sa fierté tombait, sa queue balayait tristement le sol ou s'entortillait entre ses pattes ; il se faufilait l'oreille basse, de l'air d'un gibier de potence, jetant plus d'un regard oblique à l'adresse de dame Van Winkle, et dès que le manche à balai ou la cuiller à pot commençait à préluder, il gagnait en glapissant la porte avec la plus grande précipitation.
Les années de mariage s'accumulèrent, et l'horizon s'assombrit de plus en plus pour Rip : un caractère acidulé ne s'adoucit jamais avec l'âge ; une langue bien affilée est le seul instrument tranchant qu'un usage continuel ne fasse qu'aiguiser. Pendant longtemps il eut l'habitude de se consoler, quand il était chassé de la maison, en fréquentant une sorte de club permanent des sages, des philosophes et autres paresseux personnages de l'endroit, lequel tenait ses sessions sur un banc placé devant une petite auberge que signalait un portrait rubicond de sa majesté Georges III. C'est là que, l'été, ils avaient coutume de se prélasser mollement à l'ombre des journées tout entières, s'entretenant nonchalamment des caquets du village, ou disant, d'interminables et soporifiques histoires à propos de rien. Mais un homme d'État n'aurait pas perdu son argent s'il avait entendu les profondes discussions qui survenaient parfois, quand par hasard un vieux journal laissé par un voyageur de passage leur tombait entre les mains. Avec quelle solennité ils en écoutaient le contenu, que laissait tomber d'une voix traînante Derrick Van Bummel, le maître d'école, pétulant et érudit petit homme que le mot le plus formidable du dictionnaire n'était pas capable d'intimider ! Avec quelle sagesse ils délibéraient sur les événements publics quelques mois seulement après qu'ils s'étaient passés !
Les opinions de cette assemblée étaient entièrement dirigées par Nicolas Vedder, un patriarche du village, et le propriétaire de l'auberge, à la porte de laquelle il faisait la sieste du matin jusqu'au soir, prenant tout juste assez de mouvement pour éviter le soleil et rester dans l'ombre d'un arbre aux larges branches, de sorte que les voisins pouvaient, d'après ses évolutions, dire l'heure avec autant de précision que d'après un cadran solaire. Il est vrai qu'on l'entendait rarement parler, mais il fumait incessamment sa pipe. Ses adhérents, cependant (car tout grand homme a ses adhérents), le comprenaient parfaitement et savaient comment recueillir son opinion. Quand une chose lue ou racontée devant lui lui déplaisait, on remarquait qu'il fumait sa pipe avec véhémence ; que les bouffées de tabac sortaient courtes, fréquentes, irritées. Était-il satisfait, il attirait la fumée doucement, tranquillement, et la chassait en nuages légers et gracieux ; quelquefois même, retirant la pipe de sa bouche et laissant la vapeur parfumée onduler autour de son nez, il inclinait gravement la tête en signe de complet assentiment.
Mais, hélas ! l'infortuné Rip fut à la fin délogé de cette redoutable position par sa querelleuse moitié, qui, faisant tout à coup irruption, rompait la tranquillité de l'assemblée et en traitait les membres de bons à rien. Cet auguste personnage, Nicolas Vedder lui-même, n'était pas à l'abri des atteintes de la langue entreprenante de cette terrible virago, qui l'accusait, tout net, d'encourager son mari dans ses habitudes de fainéantise.
Le pauvre Rip finit par se trouver presque réduit au désespoir ; et sa seule ressource, pour échapper aux labeurs de la plantation et aux clameurs de sa femme, était de prendre en main un fusil et de s'enfoncer dans les bois. Là, il s'asseyait parfois au pied d'un arbre, et partageait le contenu de son bissac avec Wolf. Entre eux régnait la sympathie : c'était un compagnon de souffrance et de persécution. « Pauvre Wolf, » disait-il, « ta maîtresse te fait mener une vie de chien ; mais ne fais pas attention, mon garçon : tant que je vivrai tu n'auras pas besoin d'un ami pour te soutenir ; » et Wolf remuait légèrement la queue, regardait fixement son maître en face, et si les chiens sont susceptibles de pitié, je crois fermement qu'il le plaignait aussi du plus profond de son cœur.
Un beau jour d'automne, pendant une longue excursion de cette espèce, Rip avait, sans y songer, escaladé l'une des parties les plus élevées des monts Kaatskill. Il était en train de se livrer à son divertissement favori, la chasse à l'écureuil, et les solitudes endormies avaient retenti et retenti encore des détonations de son fusil. L'après-midi était très-avancée ; haletant, épuisé, il se jeta sur un monticule vert que recouvraient des pâturages de montagne et qui couronnait le front d'un précipice. Par une ouverture entre les arbres il pouvait embrasser tout le pays qui s'étendait à ses pieds, bien des milles de terres magnifiquement boisées. Il voyait dans le lointain l'Hudson majestueux, dessous, mais bien au-dessous de lui, poursuivant sa course silencieuse mais imposante, que venait seulement accidenter la réflexion d'un nuage couleur de pourpre ou la voile d'une barque aux mouvements pleins de lenteur qui dormait çà et là sur son sein poli et se perdait enfin dans le bleu des hautes terres.
Il regarda de l'autre côté, et ses yeux plongèrent dans une vallée profonde, sauvage, solitaire, effrayante, dont le fond était rempli de blocs énormes détachés des rochers qui surplombaient, et qu'éclairaient à peine les rayons réfléchis du soleil couchant. Pendant quelque temps Rip contempla cette scène d'un air rêveur : le soir s'avançait toujours, les montagnes commençaient à projeter sur les vallées leurs longues ombres bleues ; il vit que la nuit tomberait bien avant qu'il pût atteindre le village, et il poussa un profond soupir en songeant à l'accueil gracieux que lui réservait dame Van Winkle.
Comme il était sur le point de descendre, il entendit à une certaine distance une voix qui criait : « Rip Van Winkle ! Rip Van Winkle ! » Il regarda autour de lui, mais il ne vit rien... qu'une corneille qui passait dans son vol solitaire, perpendiculairement à la montagne. Il crut avoir été le jouet de son imagination, et se retournait pour continuer à descendre, quand il entendit le même cri retentir dans l'air assoupi du soir : « Rip Van Winkle ! Rip Van Winkle ! » — En même temps le dos de Wolf se hérissa ; il poussa un grognement étouffé, et, se serrant contre son maître, jeta dans le vallon un regard effrayé. Rip alors sentit une vague appréhension s'emparer de lui ; il -jeta dans la même direction un regard inquiet, et aperçut une forme étrange escaladant lentement et péniblement les rochers, courbée sous le poids d'un fardeau qu'elle portait sur son dos. Il fut surpris de voir un être humain dans cet endroit sauvage et non fréquenté ; mais supposant que c'était quelque habitant du voisinage qui avait besoin de son secours, il se hâta de descendre pour le lui prêter.
Comme il approchait davantage, il fut encore plus surpris de la singularité de la personne de l'étranger. C'était un petit vieillard construit en carré, avec des cheveux épais et incultes et une barbe grise. Il était habillé à l'ancienne mode hollandaise — un pourpoint de drap serré autour de la taille, plusieurs paires de hauts-de-chausses, dont le dernier très-ample, orné de rangées de boutons sur les côtés et de nœuds aux genoux. Sur son épaule était un lourd barriquaut, qui paraissait plein de liquide. Il fit signe à Rip d'approcher et de l'aider à le porter. Quoique sur ses gardes et se défiant de cette nouvelle connaissance, Rip se rendit à son désir avec son empressement ordinaire, et s'aidant l'un l'autre tour à tour, ils escaladèrent une gorge étroite, formée, selon toute apparence, par le lit d'un torrent desséché de la montagne. Comme ils gravissaient, Rip entendit de temps à autre de longs roulements, semblables à des coups de tonnerre dans le lointain, qui paraissaient sortir d'un profond ravin, ou plutôt d'une crevasse, entre des rochers au front élevé, vers lequel menait le sentier difficile, qu'ils avaient pris. Il s'arrêta pendant un instant, mais il supposa que c'était le bruit sourd d'une de ces pluies accompagnées de tonnerre et sans durée, fréquentes dans les montagnes sur les hauteurs, et se remit en marche. Ils traversent le ravin et arrivent à une cavité qui ressemblait à un petit amphithéâtre, entourée de rochers à pic, sur le bord desquels des arbres qui surplombaient laissaient tomber leurs branches, de sorte qu'on n'apercevait que par échappées le ciel bleu et les nuages dorés du couchant. — Pendant tout ce temps, Rip et son compagnon avaient silencieusement poursuivi leur marche pénible ; car, bien que le premier fût grandement curieux de savoir quel motif pouvait pousser à transporter un barriquaut de liqueur sur cette montagne sauvage, cependant il y avait autour de cet inconnu je ne sais quoi de singulier, d'incompréhensible, qui inspirait une crainte respectueuse et n'admettait pas la familiarité.
Comme ils entraient dans l'amphithéâtre, il se présenta de nouveaux sujets d'étonnement. Sur une surface plane, au centre, se trouvait un groupe de personnages au regard étrange, jouant aux quilles. Leur costume bizarre n'était pas à la mode du pays : les uns portaient des pourpoints courts, les autres des jaquettes, avec de longs couteaux dans leurs ceinturons ; la plupart d'entre eux avaient d'énormes hauts-de-chausses, dans le genre de ceux du guide de Rip. Leurs figures, aussi, étaient particulières : l'un avait une grosse tête, une large face et des yeux microscopiques ; le nez de cet autre semblait être tout son visage, lequel était surmonté d'un chapeau blanc, en forme de pain de sucre, qu'ornait une petite queue de coq, de couleur rouge. Tous ils avaient des barbes, mais de formes et de couleurs diverses. Il y en avait un qui paraissait être le chef. C'était un vieux gentleman robuste, à l'air martial ; il portait un pourpoint garni de dentelles, Un large ceinturon soutenant un couteau de chasse, un chapeau haut de forme et à plume, des bas rouges, et des souliers à talons élevés, ornés de rosettes. Ce groupe remit en mémoire à Rip les figures d'une vieille peinture flamande qu'il avait vue dans la salle à manger de Dominie Van Shaick, le curé du village, et qui avait été apportée de Hollande à l'époque de l'établissement de la colonie.
Mais ce qui surtout parut étrange à Rip, c'est que, bien que ces gens s'amusassent évidemment, ils gardassent cependant les physionomies les plus sérieuses, le plus mystérieux silence : c'était la plus mélancolique partie de plaisir à laquelle il eût jamais assisté. Rien n'interrompait le calme de cette scène, rien, si ce n'est le bruit que faisaient les boules en roulant, qui retentissait le long des montagnes comme le tonnerre grondant dans le lointain.
Quand Rip et son compagnon s'approchèrent d'eux, ils abandonnèrent tout à coup leur partie, et le regardèrent avec des yeux si fixes, si glacés, d'un air si étrange, si extraordinaire, si éteint, que le cœur lui manqua, que ses genoux s'entrechoquèrent. Alors son compagnon vida le contenu du barriquaut dans de grands flacons et lui fit signe de servir la compagnie. Il obéit avec crainte et tremblement ; ils burent à longs traits la liqueur dans un profond silence, et puis retournèrent à leur jeu.
Le respect et la crainte de Rip se dissipèrent par degrés. Il alla jusqu'à s'aventurer, quand aucun regard n'était fixé sur lui, à goûter le liquide ; il trouva, rien qu'au parfum, qu'il ressemblait beaucoup à de l'excellente eau-de-vie de genièvre. Il avait naturellement le gosier en pente et fut bientôt tenté d'y retourner. Une rasade en provoqua une autre ; enfin ses visites au flacon devinrent si fréquentes, que le sentiment l'abandonna ; ses yeux nagèrent dans leurs orbites, sa tête pencha graduellement, et il tomba dans un profond sommeil.
En s'éveillant il se trouva sur le monticule vert d'où, pour la première fois, il avait vu le vieillard du vallon. Il se frotta les yeux : — on était au matin, et le soleil brillait ; les oiseaux voletaient çà et là et jetaient leurs notes aiguës dans les buissons ; l'aigle tournait sur lui-même au haut des airs, se maintenant contre la brise pure de la montagne. « Assurément, pensa Rip, je n'ai pas dormi ici toute là nuit. » Il chercha à se rappeler ce qui s'était passé avant qu'il ne s'endormit — l'homme étrange au barriquaut de liqueur — le ravin de la montagne — la retraite sauvage au milieu des rochers — le groupe mélancolique qui jouait aux quilles — le flacon. « Oh ! ce flacon ! ce maudit flacon ! pensa Rip, — quelle excuse apporter à dame Van Winkle ? »
Il chercha des yeux son fusil, mais au lieu de son fusil de chasse si net, si brillant, il n'en trouva près de lui qu'un vieux dont le canon était incrusté de rouille, dont la platine ne tenait plus, et dont le bois était vermoulu. Il soupçonna alors les graves personnages de la montagne de lui avoir joué un tour, et, après l'avoir gorgé de liqueur, de lui avoir dérobé son fusil. Wolf aussi avait disparu ; mais il pouvait s'être élancé à la poursuite d'un écureuil ou d'une perdrix. Il le siffla et l'appela à grands cris, le tout en vain ; l'écho répéta son sifflement et ses cris, mais du chien pas de nouvelles.
Il résolut de revisiter le théâtre des jeux de la soirée dernière, et s'il rencontrait quelqu'un de ceux qu'il y avait vus, de lui demander son chien et son fusil. Comme il se levait pour se mettre en marche, il s'aperçut qu'il avait les articulations raides, que son agilité ordinaire lui faisait défaut. « Ces lits de montagne ne me conviennent pas, pensa Rip, et si cette folie me valait un rhumatisme je passerais un joli quart d'heure avec dame Van Winkle. » Il descendit, non sans difficulté, dans le vallon : il trouva le ravin que son compagnon et lui avaient escalade le soir précèdent ; mais, à sa grande surprise, un ruisseau de montagne y jetait maintenant son écume, sautant de rocher en rocher, babillant et remplissant la vallée de murmures. Cependant il s'efforça de grimper sur les côtés, se frayant péniblement un chemin à travers des buissons de bouleau, de sassafras, de coudrier, trébuchant parfois ou s'embarrassant dans les ceps de vigne sauvage qui entrelaçaient d'un arbre à l'autre leurs tendrons caressants et formaient sous ses pas une espèce de réseau.
Enfin il atteignit l'endroit où le ravin leur avait fourni un passage à travers les rochers pour gagner l'amphithéâtre ; il ne restait aucune trace d'une semblable ouverture. Les rochers formaient une muraille élevée, impénétrable, sur laquelle le torrent roulait sa nappe d'écume diaphane, pour se jeter dans un bassin large et profond, noir des ombres de la forêt prochaine. Ici le pauvre Rip fut enfin forcé de s'arrêter. Il appela, il siffla encore son chien : pas d'autre réponse que les croassements d'une bande de corbeaux oisifs se jouant dans l'air, bien au-dessus de lui, autour d'un arbre desséché qui avançait sur un précipice éclairé par le soleil. Confiants dans leur élévation, ils semblaient regarder en bas et se moquer des perplexités du pauvre homme. Que faire ? — la matinée s'avançait, et Rip, mourant de faim, sentait le besoin de déjeuner. Il était désolé d'abandonner son chien et son fusil ; il redoutait l'accueil de sa femme ; mais ce n'était pas une raison pour se laisser mourir de faim dans les montagnes. Il secoua la tête, mit sur l'épaule son fusil rouillé, et, le cœur plein d'affliction et d'anxiété, tourna ses pas du côté du logis.
Comme il approchait du village, il rencontra nombre de gens, mais personne qu'il reconnût, ce qui le surprit un peu, car il avait jusqu'alors cru connaître tous les habitants des pays d'alentour. Leurs vêtements, aussi, étaient d'une mode différente de celle à laquelle il était habitué. Ils le regardaient tous fixement avec d'égales marques de surprise, et, chaque fois qu'ils jetaient sur lui les yeux, portaient invariablement la main à leur menton. La continuelle répétition de ce geste amena Rip, involontairement, à faire de même. — Alors, à son grand étonnement, il s'aperçut que sa barbe avait grandi d'un pied.
Il venait d'atteindre les premières maisons du village. Une bande d'enfants inconnus se mit à sa poursuite en l'accablant de huées, en se montrant du doigt sa barbe grise. Les chiens, les chiens, parmi lesquels il ne retrouvait pas une vieille connaissance, aboyaient sur son passage. Le village même était changé ; il était maintenant plus large, plus populeux. Il découvrait des rangées de maisons qu'il n'avait jamais vues auparavant, et celles qui avaient été ses retraites favorites avaient disparu. Des noms inconnus étaient sur les portes — des visages inconnus aux croisées — tout était inconnu. Son esprit se chargea de noirs pressentiments ; il en vint à se demander si tout ce qui l'entourait et lui-même n'étaient pas enchantés. C'était pourtant bien là le village où il était né, qu'il n'avait quitté que de la veille ; c'étaient bien là les monts Kaatskill — c'était bien l'Hudson qui roulait dans le lointain ses eaux argentées — chaque colline, chaque vallée était bien telle qu'elle avait toujours été. — Rip était cruellement embarrassé : — « Ce flacon de la nuit dernière, pensait-il, a laissé ma pauvre tête bien vide ! »
Ce ne fut pas sans difficulté qu'il trouva le chemin qui conduisait à sa maison. Il en approcha dans un muet respect, respect mêlé de crainte, s'attendant à chaque minute à entendre la voix perçante de dame Van Winkle. Il trouva la maison en ruine — le toit écroulé, les fenêtres brisées, et les portes sorties des gonds. Un chien à demi mort de faim, qui ressemblait à Wolf, rôdait à l'entour. Rip l'appela par son nom, mais le chien grogna, montra les dents et passa. L'accueil n'était pas gracieux. — « Jusqu'à mon chien, soupira le pauvre Rip, qui m'a oublié !»
Il entra dans la maison, où, c'est une justice à lui rendre, dame Van Winkle avait toujours fait régner l'ordre et la propreté. Elle était vide, triste, et, suivant toute apparence, abandonnée. Cette désolation dompta toutes ses craintes conjugales : — il appela à grands cris sa femme et ses enfants — les chambres solitaires retentirent un moment du bruit de sa voix, et puis tout rentra dans le silence.
Il en sortit précipitamment, et courut à son ancien asile, l'auberge du village — mais elle aussi avait disparu. À la place se dressait, tout rachitique, un grand bâtiment en bois, aux grandes fenêtres béantes, dont quelques-unes avaient été brisées et rajustées avec de vieux chapeaux et de vieux jupons, et sur la porte était peint : « Hôtel de l'Union, tenu par Jonathan Doolittle. » Au lieu du grand arbre qui servait à abriter la petite et tranquille auberge hollandaise d'autrefois, s'élevait maintenant une grande perche nue, avec quelque chose au bout qui ressemblait à un bonnet de nuit de couleur rouge, et au bout de cette perche flottait un drapeau sur lequel il y avait un singulier assemblage d'étoiles et de barres. — Tout cela était étrange, incompréhensible. Il reconnut cependant sur l'enseigne la face vermeille du roi Georges, au-dessous de laquelle il avait si souvent fumé paisiblement sa pipe ; mais ici s'était encore opéré une singulière métamorphose. L'habit rouge avait été remplacé par un justaucorps bleu et couleur chamois ; au lieu d'un sceptre, la main tenait une épée, la tête était ornée d'un chapeau à cornes, et au-dessous était peint en gros caractères : « Le général Washington. »
Il y avait, comme de coutume, beaucoup de monde autour de la porte, mais personne que Rip reconnût. Le caractère même du groupe semblait changé : il y régnait un ton de dispute, je ne sais quoi d'affairé, de remuant, au lieu du flegme accoutumé, du calme soporifique d'autrefois. En vain chercha-t-il des yeux le sage Nicolas Vedder avec sa large face, son double menton, sa longue et belle pipe, laissant échapper des nuages de fumée de tabac au lieu d'inutiles discours ; ou Van Bummel, le maître d'école, communiquant le contenu d'un vieux journal. À leur place, un individu maigre, au regard bilieux, les poches pleines de billets, pérorait avec véhémence sur les droits des citoyens,— les élections, — les membres du congrès, — la liberté, — Bunker's Hill, — les héros de soixante-seize — et autres expressions qui sonnaient aux oreilles troublées de Van Winkle comme un vrai jargon babylonien.
L'apparition de Rip avec sa longue barbe grise, son fusil de chasse couvert de rouille, son costume bizarre et l'armée de femmes et d'enfants qui se pressait sur ses talons, eut bientôt attiré l'attention des politiques de taverne. Ils s'amassèrent autour de lui, l'examinant de la tête aux pieds avec la plus grande curiosité. L'orateur se précipita vers lui, et, le prenant légèrement à part, s'enquit « de quel côté il votait : » Rip le regarda fixement, d'un air distrait et stupide. Un autre individu, de petite taille, mais qui se donnait beaucoup de mouvement, le tira par le bras, et, se haussant sur la pointe des pieds, lui glissa dans l'oreille : « Êtes-vous fédéraliste ou démocrate ? » Rip se mettait encore l'esprit à la torture pour saisir la question, quand un habile et vieux gentleman à mine dictatoriale et coiffé d'un chapeau à cornes finissant en pointe d'aiguille s'ouvrit un passage à travers la foule, que sur son chemin il repoussait à droite et à gauche avec ses coudes, et se plantant devant Van Winkle, un bras sur la hanche, l'autre appuyé sur sa canne, pendant que ses yeux perçants et son chapeau pointu plongeaient, pour ainsi dire, au fond de son âme, lui demanda d'un ton austère « ce qui l'amenait aux élections avec un fusil sur l'épaule et un rassemblement derrière lui, et s'il avait l'intention de faire une émeute dans le village ? » « Hélas ! Messieurs, s'écria Rip quelque peu alarmé, je suis un pauvre homme bien paisible, natif de l'endroit, et un loyal sujet du roi, Dieu le bénisse ! »
À ces mots le même cri échappa à tous les assistants : — « Un tory ! un tory ! un espion ! un réfugié ! Chassez-le, qu'il disparaisse ! » Ce fut à grand'peine que l'important personnage au chapeau à cornes parvint à rétablir l'ordre, et qu'ayant pris un air dix fois plus rébarbatif, il demanda derechef à cet accusé, à cet inconnu, ce qu'il était venu faire et qui il cherchait. Le pauvre homme lui assura bien humblement qu'il n'avait pas de mauvaises intentions, mais était simplement en quête de quelques-uns de ses voisins qui avaient l'habitude de fréquenter la taverne.
« Bien. — Qui sont-ils ? — Nommez-les. »
Rip se recueillit un moment et demanda : « Où est Nicolas Vedder ? »
Il se fit un silence de quelques instants ; enfin, un vieillard répondit d'une voix grêle et flûtée : « Nicolas Vedder ? Eh quoi ! il est mort et enterré depuis dix-huit ans. Il y avait dans le cimetière une tombe de bois qui servait à dire tout ce qui le concernait ; mais elle est pourrie ; elle n'existe plus — non plus.
— Où est Brom Dutcher ?
— Oh ! il est parti pour l'armée au commencement de la guerre. Les uns disent qu'il a été tué à l'assaut de Stony-Point, — d'autres qu'il s'est noyé dans une bourrasque, au pied de Antony's Nose. Je ne sais pas — il n'est jamais revenu.
— Où est Van Bummel, le maître d'école ?
— Il est aussi parti pour la guerre, a été un grand général de milice, et fait maintenant partie du congrès. »
En apprenant ces tristes changements intervenus dans son pays natal, parmi ses amis, en se trouvant ainsi seul au monde, Rip sentit son cœur s'en aller. Et puis chacune de ces réponses l'embarrassait, car elles supposaient un si énorme laps de temps ; elles avaient trait à des choses qu'il ne pouvait comprendre : là guerre — le congrès — Stony-Point ; — il n'eut pas le courage de s'informer davantage de ses amis, mais s'écria dans un mouvement de désespoir : « N'est-il donc personne ici qui connaisse Rip Van Winkle ?
— Oh ! Rip Van Winkle ! répliquèrent deux ou trois ; oh ! bien certainement ! Voilà Rip Van Winkle là-bas, appuyé contre un arbre.»
Rip regarda, et vit l'exacte copie de lui-même, tel qu'il était quand il s'était acheminé vers la montagne ; aussi paresseux, selon toute apparence, et certainement tout aussi déguenillé. Le pauvre homme était maintenant entièrement confondu. Il douta de sa propre identité, s'il était lui-même ou un autre. Au milieu de son trouble l'homme au chapeau à cornes lui demanda qui il était et quel était son nom.
« Dieu le sait ! s'écria-t-il tout hors de lui ; je ne suis pas moi-même — je suis un autre — c'est moi qui suis là-bas — non — c'est un autre dans mes souliers. — J'étais moi-même la nuit dernière, mais je me suis endormi sur la montagne, et l'on m'a changé mon fusil, et tout est changé, et je suis changé, et je ne puis dire quel est mon nom, ni qui je suis ! »
Les spectateurs commencèrent à se regarder les uns les autres, à secouer la tête, à cligner des yeux d'une façon très-significative, et à se frapper le front avec leurs doigts. On se dit aussi à l'oreille qu'il fallait se saisir du fusil pour empêcher le vieillard de faire quelque malheur. À cette suggestion, l'important personnage au chapeau à cornes se retira avec une certaine précipitation. En ce moment critique, une femme fraîche et avenante perça la foule afin de jeter un coup d'œil sur l'homme à la barbe grise. Elle tenait dans ses bras un enfant joufflu, qui, effrayé par les regards de Rip, se mit à pleurer. « Silence, Rip ! s'écria-t-elle ; taisez-vous, petit sot : le vieillard ne vous fera pas de mal. » Le nom de l'enfant, les traits de la mère, le son de sa voix, éveillèrent dans son esprit un monde de souvenirs.
« Quel est votre nom, ma bonne femme ? lui demanda-il.
— Judith Gardenier.
— Et le nom de votre père ?
— Ah ! pauvre homme, son nom était Rip Van Winkle. Il y a vingt ans qu'il partit de la maison avec son fusil, et jamais on n'en a plus entendu parler. — Son chien revint à la maison sans lui, mais s'il s'est tué, ou s'il a été enlevé par les Indiens, c'est ce que personne ne peut dire. Je n'étais alors qu'une petite fille. »
Rip n'avait plus qu'une question à adresser, mais il le fit en balbutiant :
« Et votre mère ?
— Oh ! elle aussi elle est morte, mais depuis quelque temps seulement ; elle se rompit un vaisseau dans un accès de colère contre un colporteur de la Nouvelle-Angleterre. »
Il y avait au moins dans cette nouvelle quelque chose de consolant. Le brave homme ne put se contenir plus longtemps. Il prit sa fille et son enfant dans ses bras. « Je suis votre père ! s'écria-t-il — le jeune Rip Van Winkle autrefois — le vieux Rip Van Winkle aujourd'hui ! — Est-ce que personne ne reconnaît le pauvre Rip Van Winkle ? » Tous étaient saisis d'étonnement ; mais enfin une vieille femme se sépara de la foule, vint en chancelant, porta sa main à son front, et, le regardant par-dessous au visage pendant un moment, s'écria : « Mais assurément, c'est Rip Van Winkle — c'est lui-même ! Soyez le bienvenu parmi nous, vieux voisin. — Eh bien ! où avez-vous été pendant ces vingt longues années? »
L'histoire de Rip fut bientôt dite, car ces vingt années n'avaient été pour lui qu'une seule nuit. Les voisins ouvraient de grands yeux en l'écoutant ; on en vit quelques-uns se faire signe de l'œil et pousser leurs langues contre leurs joues, et l'important personnage au chapeau à cornes, qui, l'alarme dissipée, était revenu sur le champ de bataille, abaissa les coins de sa bouche et secoua la tête. — Là-dessus toute l'assemblée se mit à secouer la tête.
On résolut néanmoins de prendre l'avis du vieux Peter Vanderdonk, que l'on voyait s'avancer lentement sur la chaussée. C'était un descendant de l'historien de ce nom, qui écrivit un des premiers la chronique de la province. Peter était le plus ancien habitant du village, et très versé dans tous les événements merveilleux et les traditions du pays d'alentour. Il reconnut Rip immédiatement, et confirma son dire de la façon la plus satisfaisante. Il assura à la compagnie que c'était un fait transmis par son ancêtre, l'historien, que les monts Kaatskill avaient toujours été hantés par des êtres étranges. On affirmait que le grand Hendrick Hudson, celui qui découvrit le premier la rivière et le pays, y tenait une espèce de veille tous les vingt ans avec son équipage de la Demi-Lune ; qu'il lui était ainsi permis de revoir le théâtre de ses aventures et de jeter un regard tutélaire sur le fleuve et la grande cité qui portent son nom. Il ajoutait que son père les avait vus une fois dans leur antique costume hollandais, jouant aux quilles dans un creux de la montagne, et que lui-même avait entendu, par une après-midi d'été, le bruit des boules, qui ressemblait à des coups de tonnerre dans le lointain.
Afin d'abréger une longue histoire, nous dirons que la foule se dissipa pour retourner aux soins plus importants de l'élection. La fille de Rip le prit chez elle pour vivre ensemble ; elle avait une maison bien commode, bien garnie, et pour mari un bon gros fermier en qui Rip reconnut un des bambins qui avaient l'habitude de grimper sur son dos. Quant au fils et à l'héritier de Rip, seconde édition de son père, qu'il avait vu appuyé contre un arbre, on l'employait à travailler sur la ferme ; mais il marquait une disposition héréditaire à s'appliquer à toute autre chose qu'à sa besogne.
Rip reprit alors ses promenades et ses habitudes d'autrefois. Il eut bientôt retrouvé plusieurs de ses anciennes connaissances ; mais leur caractère s'était déplorablement modifié avec les années, et il préféra se faire des amis parmi la génération naissante, auprès de laquelle il fut bientôt en grande faveur.
N'ayant rien à faire à la maison, et étant arrivé à cet heureux âge où un homme peut être impunément oisif, il reprit sa place sur le banc à la porte de l'auberge, et fut vénéré comme un des patriarches du village, une chronique du vieux temps — « avant la guerre. » Il se passa quelque temps avant qu'il pût prendre part aux causeries d'une façon complète, avant qu'on pût lui faire saisir les événements étranges qui avaient eu lieu pendant sa torpeur ; comment il se faisait qu'il y avait eu une révolution, puis la guerre — que le pays avait repoussé le joug de la vieille Angleterre — et qu'au lieu d'être le sujet de S. M. Georges III, il était maintenant citoyen libre des États-Unis. Rip, dans le fait, n'était pas un politique : les variations des États et des empires l'affectaient assez médiocrement ; mais il était une espèce de despotisme sous lequel il avait longtemps gémi — l'empire de la cornette. Heureusement que son règne était fini ; il avait retiré son cou du joug matrimonial, et pouvait entrer et sortir quand il lui plaisait, sans avoir à redouter la tyrannie de dame Van Winkle. Toutes les fois qu'on prononçait son nom, cependant, il secouait la tête, haussait les épaules et levait les yeux au ciel, ce qui pouvait passer pour l'expression de sa résignation à sa destinée, ou de la joie qu'il éprouvait de sa délivrance.
Il avait coutume de raconter son histoire à tous les étrangers qui arrivaient à l'hôtel de M. Doolittle. On remarqua d'abord qu'il variait sur quelques points chaque fois qu'il la disait, ce qui, à n'en pas douter, venait de ce qu'il était tout récemment éveillé. Elle finit cependant par prendre un caractère de fixité : c'est celle-là que nous avons racontée, et il n'y avait pas dans le voisinage un homme, une femme ou un enfant qui ne la sût par cœur. Il en est bien qui affectèrent toujours de douter de son authenticité, qui répétèrent que Rip avait eu une absence d'esprit, et que c'était un sujet sur lequel il n'avait pas encore la tête bien saine ; mais les vieux habitants d'origine hollandaise y ajoutèrent presque universellement foi, et aujourd'hui même ils n'entendent jamais retentir le tonnerre sur les monts Kaatskill, par une orageuse après-midi d'été, qu'ils ne disent : « Hendrick Hudson et sa bande sont en train de jouer aux quilles ; » et c'est, dans le voisinage, un vœu familier à tous les maris menés par leurs femmes, quand la vie leur pèse lourde sur les bras, que de pouvoir puiser le repos dans le flacon de Rip Van Winkle.
Source: http://fr.wikisource.org
Cet enregistrement est mis à disposition sous un contrat Creative Commons BY (attribution) SA (Partage dans les mêmes conditions).
Cet enregistrement est également mis à disposition sous un contrat Art Libre.
Cet enregistrement est également mis à disposition sous un contrat Art Libre.
Commentaires :
Warning: Undefined variable $cookies in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 7
Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 7
Warning: Undefined variable $validcookiesStats in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 7
Warning: Undefined variable $cookies in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 134
Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 134
Warning: Undefined variable $validcookiesSoc in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 134






Jolie texte