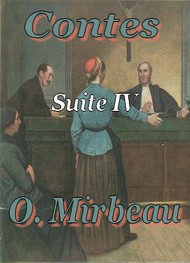
Contes (SuiteIV)
Enregistrement : Audiocite.net
Publication : 2013-02-04
Lu par Alain Bernard
Livre audio de 43min
Fichier mp3 de 39,6 Mo
719 - Téléchargements - Dernier décompte le 28.12.25
Télécharger
(clic droit "enregistrer sous")Lien Torrent
Peer to peerSignaler
une erreur Commentaires
Warning: Undefined variable $cookies in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 46
Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 46
Warning: Undefined variable $validcookiesSoc in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 46
Image: d_après: http://www.dreyfus.culture.fr/fr/mediatheque/media-theme2-html-La_justice_de_paix.htm
Musique : Eric Satie Gnossienne n°5La justice de paix La justice de paix occupait, dans la mairie au rez-de-chaussée, une salle donnant de plain-pied sur la place. Rien d'imposant, je vous assure, et rien de terrible. La pièce nue et carrelée, aux murs blanchis à la chaux, était séparée en son milieu par une sorte de balustrade en bois blanc qui servait indifféremment de banc pour les plaignants, les avocats - aux jours des grands procès - et pour les curieux. Au fond, sur une estrade basse, faite de planches mal jointes, se dressaient trois petites tables devant trois petites chaises, destinées, celle du milieu à monsieur le juge, celle de droite à monsieur le greffier, celle de gauche à monsieur l'huissier. C'était tout. Au moment où j'entrai, « l'audience » battait son plein. La salle était remplie de paysans, appuyés sur leurs bâtons de frêne à courroies de cuir noir, et de paysannes qui portaient de lourds paniers sous les couvercles desquels passaient des crêtes rouges de poulets, des becs jaunes de canards et des oreilles de lapins. Et cela faisait une odeur forte d'écurie et d'étable. Le juge de paix, un petit homme chauve, à face glabre et rouge, vêtu d'un veston de drap pisseux, prêtait une grande attention au discours d'une vieille femme qui, debout dans l'enceinte du prétoire, accompagnait chacune de ses paroles par des gestes expressifs et colères. Les bras croisés, la tête inclinée sur la table, le greffier, chevelu et bouffi, semblait dormir, tandis qu'en face de lui, l'huissier, très maigre, très barbu et très sale, griffonnait je ne sais quoi sur une pile de dossiers crasseux. La vieille femme se tut. -C'est tout ? demanda le juge de paix. -Plaît-y, monsieur le juge ? interrogea la plaideuse en allongeant le cou, un cou ridé comme une patte de poule. -Je vous demande si vous avez fini de jaboter, avec votre mur ? reprit le magistrat d'une voix plus forte. -Pargué oui, mossieu le juge... c'est-à-dire, faites excuses, v'là l'histoire... Le mur en question, le long duquel Jean-Baptiste Macé accote ses... Elle allait recommencer ses antiennes, mais le juge l'interrompit. -C'est bien, c'est bien. Assez, la Martine, permis d'assigner. Greffier ! Le greffier leva lentement la tête, en faisant une affreuse grimace. -Greffier ! répéta le juge, permis d'assigner... prenez note... Et, comptant sur ses doigts : -Mardi... nous assignerons mardi... c'est cela, mardi ! À un autre. Le greffier, clignant de l'oeil, consulta une feuille, la tourna, la retourna, puis, promenant son doigt de bas en haut, sur la feuille, il s'arrêta tout à coup... -Gatelier contre Rousseau ! cria-t-il sans bouger. Est-il là, Gatelier et Rousseau ? -Présent, dit une voix. -Me v'là, dit une autre voix. Et deux paysans se levèrent, et entrèrent dans le prétoire. Ils se placèrent gauchement en face du juge de paix qui allongea ses bras sur la table et croisa ses mains calleuses. -Vas-y, Gatelier ! Qu'est-ce qu'il y a encore, mon gars ? Gatelier se dandina, essuya sa bouche du revers de sa main, regarda à droite, à gauche, se gratta la tête, cracha, puis, ayant croisé ses bras, finalement il dit : -V'là ce que c'est, mossieu le juge... J'revenions d'la foire Saint-Michel, la Gatelière, ma femme, et pis Roussiau, ensemble. J'avions vendu deux viaux et, sauf vout'respect, un cochon, et dame ! on avait un peu pinté. J'revenions donc, à la nuit tombante. Mé, j'chantais, Roussiau agaçait ma femme, et la Gatelière disait tout l'temps : « Finis donc, Roussiau, bon Dieu ! qué t'es donc bête ? qué t'es donc éfant ! » Et, se retournant vers Rousseau, il demanda : -C'est-y ben ça ? -C'est ben ça ! répondit Rousseau. -À mi-chemin, reprit Gatelier, après un court silence, v'là ma femme qui mont' l'talus, enjambe la p'tite hae, au bas de laquelle y avait un grand foussé. « Où qu'tu vas ? » que j'y dis. « Gâter de l'iau », qu'è m'répond. « C'est ben ! », que j'dis... Et j'continuons nout'route, Roussiau et mé. Au bout de queuques pas, v'là Roussiau qui mont' le talus, enjambe la p'tite hae au bas de laquelle y avait un grand foussé. « Où qu'tu vas ? », que j'y dis. « Gâter de l'iau », qu'y me répond. « C'est ben ! », que j'dis. Et j'continue ma route. Il se retourna de nouveau vers Rousseau : -C'est-y ben ça ? dit-il. -C'est ben ça ! répondit Rousseau. -Pour lors, reprit Gatelier, j'continue ma route. J'marche, j'marche, j'marche. Et pis, v'là que j'me retourne, n'y avait personne sus l'chemin. J'me dis : « C'est drôle ! où donc qu'ils sont passés ? » Et je r'viens sus mes pas : « C'est ben long, que j'dis. On a un peu pinté, ça c'est vrai, mais tout de même, c'est ben long. » Et j'arrive à l'endroit où Roussiau avait monté l'talus... Je grimpe la hae itout, j'regarde dans l'foussé : « Bon Dieu, que j'dis, c'est Roussiau qu'est sus ma femme ! » Pardon, excuse, mossieu le juge, mais v'là ce que j'dis. Roussiau était donc sus ma femme, sauf vout'respect, et y gigotait dans le foussé, non, fallait voir comme y gigotait, ce sacré Roussiau ! Ah ! bougre ! Ah ! salaud ! Ah ! propre à ren ! « Hé, gars, que j'y crie du haut du talus, hé, Roussiau ! Voyons, finis donc, animal, finis donc ! » C'est comme si j'chantais. J'avais biau y dire de finir, y n'en gigottait que pus fô, l'mâtin ! Alors, j'descends dans le foussé, j'empoigne Roussiau par sa blouse, et j'tire, j'tire. - « Laisse-mé finir », qu'y me dit. - « Laisse-le donc finir », qu'me dit ma femme. - « Oui, laisse-mé finir, qu'y reprend, et j'te donnerai eune d'mi-pistole, là, t'entends ben, gars, eune d'mi-pistole ! » - « Eune d'mi-pistole, que j'dis, en lâchant la blouse, c'est-y ben vrai, ça ? » - « C'est ben vrai ! » - « C'est juré ? » - « C'est juré ! » - « Donne tout d'suite. » -« Non, quand j'aurai fini. » - « Eh ben, finis. » Et moi, j'reviens sus la route. Gatelier prit pour la troisième fois Rousseau à témoin. -C'est-y ben ça ? -C'est ben ça ! répondit Rousseau. Gatelier poursuivit. -V'entendez, mossieu l'juge, v'entendez... c'était promis, c'était juré !... Quand il eut fini, y revint avé la Gatelière sus la route, ous que j'm'étions assis, en les attendant. « Ma d'mi-pistole ? », que j'demandai. « D'main, d'main, qu'y m'fait, j'ai pas tant seulement deus liâs sus mè ! » Ça pouvait êt'vrai, c'té ment'rie là. J' n'dis rin, et nous v'l'a qui continuons nout'route, la Gatelière, ma femme, et pis Roussiau, ensemble. Mé, j'chantais, Roussiau agaçait ma femme, et la Gatelière disait tout l'temps : « Finis donc, Roussiau, bon Dieu ! qu't'es donc bête ! qu't'es donc éfant ! » En nous séparant, j'dis à Roussiau : « Attention, mon gars, c'est juré ». « C'est juré. » I'm'donne eune pognée d'main, fait mignon à ma femme, et pis, le v'là parti... Eh ben, mossieu l'juge, d'pis c'temps-là, jamais y n'a voulu m'payer la d'mi-pistole... Et l'pus fô c'est, pas pus tard qu'avant-z-hier, quand j'y réclamais mon dû, y m'a appelé cocu ! « Sacré cocu, qu'y m'a fait, tu peux ben t'fouiller ». V'là c' qu'y m'a dit, et c'était juré, mossieu l'juge, juré, tout c'qu'y a d'pus juré. » Le juge de paix était devenu très perplexe. Il se frottait la joue avec sa main, regardait le greffier, puis l'huissier, comme pour leur demander conseil. Évidemment, il se trouvait en présence d'un cas difficile. -Hum ! hum ! fit-il. Puis il réfléchit quelques minutes. -Et, toi, la Gatelière, que dis-tu de ça ? demanda-t-il à une grosse femme, assise sur le banc, son panier entre les jambes, et qui avait suivi le récit de son mari, avec une gravité pénible. -Mé, j'dis ren, répondit en se levant la Gatelière... Mais, pour ce qui est d'avoir promis, d'avoir juré, mossieu l'juge, ben sûr il a promis la d'mi-pistole, l'menteux... Le juge s'adressa à Rousseau. -Qu'est-ce que tu veux, mon gars ? tu as promis, n'est-ce pas ? tu as juré ? Rousseau tournait sa casquette d'un air embarrassé. -Ben, oui ! j'ai promis... dit-il... mais, j'vas vous dire, mossieu l'juge... Eune d'mi-pistole, j'peux pas payer ça, c'est trop cher... a ne vaut pas ça, vrai de vrai ! -Eh bien ! il faut arranger l'affaire... Une demi-pistole, c'est peut-être un peu cher, en effet... Voyons, toi, Gatelier, si tu te contentais d'un écu, par exemple ? -Non, non, non ! Point un écu... La demi-pistole, puisqu'il a juré ! -Réfléchis, mon gars. Un écu, c'est une somme. Et puis Rousseau paiera la goutte, par-dessus le marché... C'est-y convenu comme ça ? Les deux paysans se regardèrent, en se grattant l'oreille. -Ça t'va-t-y, Roussiau ? demanda Gatelier. -Tout d'même, répondit Rousseau, j' sommes-t-y pas d'z amis ! -Eh ben ! c'est convenu ! Ils échangèrent une poignée de main. -À un autre ! cria le juge, pendant que Gatelier, la Gatelière et Rousseau quittaient la salle, lentement, le dos rond, les bras ballants.
La table d'hôte Une grande pièce, tapissée de papier imitant le bois de chêne. La table occupe presque toute la longueur de la pièce. Sur la table, entre les heures des repas, on voit toujours un huilier désargenté, des salières en verre ébréché, des assiettes de petits fours poussiéreux et des carafes à demi pleines d'eau. En face de la cheminée, une armoire de merisier pour le linge ; près de la fenêtre, un buffet, également en merisier, pour la vaisselle. Sur la cheminée s'élèvent deux vases dorés, soigneusement abrités sous des globes, et, sous des globes aussi, une pendule sans mouvement et qui marque toujours cinq heures. Le plafond, noirci par la fumée des lampes, la glace ternie et rayée sont couverts de chiures de mouches. Un portrait de Gambetta, ancienne prime de journal, quelques lithographies, représentant, de préférence, des scènes militaires du premier Empire, et parfois une caricature politique, cadeau d'un commis voyageur, décorent les murs. La table d'hôte n'a que trois pensionnaires : le receveur de l'enregistrement, le receveur des contributions indirectes, celui que les cabaretiers appellent : le rat de cave, et les paysans : l'ambulant ; le troisième, récemment arrivé de Vendée, est le principal clerc de Me Bernard, notaire. C'est un vieil homme fort râpé, qui sent la poussière des paperasses et des dossiers ; pourtant il porte des bottes à l'écuyère et ne s'habille que de jaquettes en velours feuille morte, ornées de boutons de bronze représentant des attributs de chasse. Le principal clerc de Me Bernard a la passion de la chasse à courre, bien qu'il n'ait jamais chassé, mais il s'en console en citant à tout propos le nom des piqueux célèbres, des grands veneurs, et en sonnant de la trompe, chaque soir, après dîner, dans la petite chambre qu'il occupe à l'hôtel. Le jour de son arrivée, il a cru devoir faire sa profession de foi aux convives de la table d'hôtes : « Je suis républicain, messieurs, mais il faut être juste en tout ; eh bien, pour sonner de la trompe, il n'y en a pas comme Baudry-d'Asson [Léon Baudry d'Asson, député légitimiste de Vendée de 1876 à 1914.]. » Le receveur de l'enregistrement est un jeune homme rangé, triste, ponctuel et très propre. Il mange beaucoup et parle peu. On ne lui connaît pas d'autres distractions qu'une promenade d'une heure au bord de la rivière, dans la journée, et, le soir, la lecture des vers de M. Coppée et des romans de M. Ohnet. À une époque, il aimait à s'oublier parfois, au bureau de tabac, où trône la belle Valentine ; il lui prêtait Serge Panine et copiait pour elle quelques vers du Passant, mais on prétend que « ça n'a pas été plus loin ». D'ailleurs, depuis deux mois il n'entre plus au bureau de tabac : « Je ne fume plus », dit-il mélancoliquement. Le rat de cave, lui, est très gai, grand chasseur, et d'une mise plus que négligée. Il arrive toujours pour dîner, en tenue de chasse, avec ses guêtres boueuses, son pantalon et son veston de toile bleue, maculés de sang. Le principal clerc le méprise un peu, parce qu'il trouve que la chasse au fusil manque de distinction et qu'il n'y a que « la chasse à courre pour être vraiment chic ». De là des discussions qui, la plupart du temps, dégénèrent en disputes. « Un perdreau ! s'écrie le principal, dédaigneusement, qu'est-ce que c'est que ça qu'un perdreau !... Parlez-moi d'un dix-cors, d'un sanglier, au moins cela signifie quelque chose. » - « Et ta meute ! répond le rat de cave d'un ton froissé. Va donc, vieux limier ! Tu fais le pied dans les actes de ton patron, tu embûches les souris dans les cartons de l'étude ! » Le rat de cave a, sans cesse, des aventures extraordinaires à raconter. Dans ses conversations, il imite le chien à l'arrêt, le vol des perdreaux, le lièvre qui roule, frappé à la tête d'un coup de plomb, les détonations du fusil, la pipée de la bécasse ; tous les objets qui se trouvent sous sa main lui servent à expliquer ses récits, à les rendre visibles. -J'arrive dans un champ de luzerne (il pose au milieu de la table son assiette où restent encore quelques feuilles de salade)... Ça c'est le champ de luzerne... Suivez-moi bien... À côté, il y avait un bois... tenez... (il dispose près de l'assiette deux ou trois bouteilles)... ça c'est le bois... Attention !... Voilà que, tout à coup, dans la luzerne (il montre l'assiette)... tout contre le bois (il indique les bouteilles)... j'aperçois un lièvre au gîte... (il coule une croûte de pain sous des feuilles de salade)... voyez-vous, ça c'est le lièvre... un gros lièvre... énorme... Alors... (il se lève, se recule sur la pointe des pieds, doucement)... il rondissait l'oeil... (il fait le geste d'épauler)... je ne me presse pas... (il vise la croûte de pain)... Pan !... pan !... Je cours... (il se précipite vers l'assiette, en retire la croûte de pain, et prend un air consterné)... C'était pas un lièvre !... non... c'était une casquette ! (il jette la croûte à terre, et la repousse du pied)... une casquette !... Ah ! ah !... J'en ris maintenant... mais sur le moment !... Une casquette !... Oh ! oh !... Hormis ces trois pensionnaires qui mangent régulièrement à la table d'hôte, les autres convives se composent de commis-voyageurs, d'étrangers de passage et de gros fermiers, les jours de foire seulement. Jamais je n'oublierai le dîner que je fis là. Il y avait autour de la table cinq ou six commis-voyageurs et les trois pensionnaires qui, du couteau et de la fourchette, luttaient désespérés contre une carcasse de vieille poule, carcasse cuirassée, carcasse invincible, carcasse inexpugnable. C'était, je vous assure, un lamentable spectacle. Je m'assis, très impressionné. En face de moi se trouvaient deux personnages assez bizarres qui attirèrent aussitôt mon attention. L'un était grand, gros, avec des yeux ronds, très noirs, des moustaches énormes qui pendaient de chaque côté des lèvres, une bouche lippue et un triple menton qui s'épanouissait sur sa poitrine, entièrement cachée par la serviette. L'autre, petit, maigre, d'un blond filasse, le visage rouge et glabre, était si grimaçant et si agité qu'on aurait pu le prendre pour un échappé de cabanon. Son oeil droit, grand ouvert, très pâle, restait fixe et inerte comme l'oeil d'un mort ou d'un aveugle. La paupière, fripée et sans cils, retombait sur l'oeil gauche et le recouvrait entièrement. Et c'était une chose presque fantastique de voir ce petit homme qui, lorsqu'il voulait saisir un objet, ou parler à son voisin, du doigt levait la paupière paralysée jusqu'au sommet de l'arcade sourcilière, la retournait d'un geste brusque, découvrant ainsi l'oeil, encadré d'une peau écorchée, humide et sanguinolente. Le gros voyageait pour les jouets d'enfants, le petit pour les gilets de flanelle. Après avoir inutilement tenté de manger son poulet, après avoir juré, tempêté, appelé les bonnes, maudit l'établissement, le gros s'adressa au petit : -Eh bien ! qu'est-ce que je t'avais dit, à Alençon, bougre de serin ? As-tu lu le journal ? l'as tu lu ? C'est une infamie. Au Tonkin, c'est comme en 70, on nous fiche dedans, les généraux trahissent. Tu connais ce Négrier ? Ah ! c'est du propre ! Un tas de canailles ! Tiens ! ce Courbet, il paraît qu'il est mort à temps. Le petit leva sa paupière, grimaça et, regardant son compagnon : -T'es sûr de cela, que les généraux trahissent ? dit-il, t'es sûr ? -Pardi ! si je suis sûr, bougre de saint Thomas ! Oh ! on ne me la fait pas à moi ! Faudrait être plus malin... Je connais ça... Je te dis que c'est comme à Metz. J'y étais, tu sais bien, à Metz, et partout... J'ai vu, - il n'y a pas à dire que je n'ai pas vu, - comment que ça se turbinait. Oh ! les canailles ! Mais, t'as donc pas lu le journal ? Il frappa sur la table un formidable coup de poing. Les autres commis-voyageurs parurent très intéressés ; les deux fonctionnaires, ayant terminé leur repas, se retirèrent sans dissimuler leur indignation. Il reprit, en élevant la voix : -C'est comme ces deux mangeurs de budget, ces fainéants !... Ils ont bien fait de ne rien dire, parce que je leur aurais frictionné l'opportunisme, moi !... Certainement, les opinions sont libres, excepté celles des curés et puis des autres bonapartistes... Mais ce qui n'est pas libre, c'est de trahir !... Quand je pense à cela, ça me fout en rage... À Metz, j'y étais, tu sais bien, à Metz, et partout... Je les ai vus les généraux, les maréchaux, tout le tremblement. Des propres à rien qui ne sortaient pas des cafés ! Ils étaient saoûls tout le temps... Et ça se gobergeait avec les Allemands, un tas de sales Bavarois !... Tiens, Canrobert, le vieux Canrobert, veux-tu que je te dise ? Eh bien ! Canrobert, oui, messieurs, Canrobert, on était obligé de le remporter chez lui tous les jours, tellement il était poivrot !... C'est pas une fois que j'ai vu ça. C'est cent, c'est deux cents fois ! Et les femmes avec qui il faisait la noce, c'en était rempli partout, des traînées de Paris, des salopes de Bullier et du Cadet [Bals populaires.]... et laides, non, fallait voir !... Nous crevions de faim, nous ; mais elles, c'est des truffes qu'elles mangeaient... Ah ! les sales canailles !... Eh ben, au Tonkin, c'est tout pareil... S'il n'y avait eu que ça encore !... Les généraux, c'est bon pour boire et pour nocer, c'est dans le sang, c'est le métier qui veut ça, quoi ! Mais ils trahissaient, tonnerre de Dieu !... Et puis qu'on ne vienne pas me La table d'hôte 122
Contes IV dire qu'ils ne trahissaient pas, non, qu'on ne vienne pas me le dire... parce que moi qui te parle, moi, tu entends bien, moi, sacré mâtin, je les ai vus trahir ! Et pas une fois, non !... mais plus de cent fois, plus de mille fois !... oui, plus de deux mille fois ! Le petit était indigné, sa face maigre s'empourprait, devenait violette. Il se remuait sur sa chaise avec une agitation extraordinaire, montrait le poing à des personnages qu'on ne voyait pas, levait et baissait sa paupière au bord de laquelle son oeil apparaissait furieux, se grattait la tête, frappait la table. Il bégaya : -Les canailles ! les canailles !... Mais comment qu'ils s'y prenaient, dis ? Comment qu'ils s'y prenaient pour trahir ? -Comment qu'ils s'y prenaient ? répéta le gros en ricanant effroyablement. Comment qu'ils... Eh ben ! mais... ils trahissaient... Voilà comment ils s'y prenaient. À cette explication imprévue, le petit lança un juron ordurier ; de la paume de la main, il se frappa la cuisse, puis, repoussant sa chaise en arrière, se balança pendant quelques secondes. -Tiens ! dit-il d'une voix frémissante de colère, causons plus de ça, hein ? Parce que ces choses-là, vois-tu, ça me met hors de moi..., ça me fout malade... Il y eut un silence de plusieurs minutes. Après quoi, ils parlèrent littérature.
Un poète local L'homme qui entra était un grand diable, maigre, terreux et très voûté. Ses vêtements usés, rapiécés, semblaient ne pas lui tenir au corps, tellement ils étaient minables. Il avait un bâton d'épine à la main, et portait sur son dos une sorte de carnassière, dans laquelle je distinguai, à travers le filet à grosses mailles, des registres, des imprimés d'administration, un encrier et un morceau de pain. L'homme me salua à plusieurs reprises et me tendit une lettre. Voici ce que disait cette lettre : « Monsieur et honoré confrère, Je vous prie d'accueillir favorablement M. Hippolyte Dougère qui vous remettra ce mot. C'est un jeune homme du plus brillant avenir et du plus beau talent. M. Dougère a composé plusieurs tragédies qui sont admirables -ni classiques, ni romantiques, ni naturalistes -, mais admirables. J'espère, monsieur et honoré confrère, que vous voudrez bien aider notre jeune poète à sortir de l'ombre, et à utiliser pour lui vos précieuses relations dans le monde du théâtre. Excusez mon indiscrétion, mais c'est l'amour des lettres - je dis des belles-lettres - qui me met la plume à la main. Agréez, etc. JULES RENAUDOT, Membre de la Pomme, percepteur à X... P.S. - Je connais tout particulièrement M. Monselet [Charles Monselet (1825-1888), journaliste, érudit, gastronome, membre éminent de la Bohême littéraire.] et quelques-uns de ces messieurs. » Quand j'eus achevé la lecture de la lettre de M. Renaudot, membre de la Pomme, percepteur à X..., l'homme me salua de nouveau et me dit, non sans quelque fierté : -C'est moi, Hippolyte Dougère. -Enchanté, monsieur. Puis-je vous être bon à quelque chose ? -À tout, monsieur. Je le priai de s'asseoir. Hippolyte Dougère salua encore ; il déposa sa carnassière et son bâton sur le plancher, entre ses jambes, puis, passant la main dans ses cheveux : -Monsieur, dit-il, voici l'affaire... Je suis commis à cheval... -Pardon ! je croyais que vous étiez poète ? -Certainement, je suis poète ; mais je suis aussi commis à cheval... Trouveriez-vous par hasard que ces deux qualités sont incompatibles ? -Nullement, monsieur... au contraire. Il poursuivit : -Je suis commis à cheval... C'est-à-dire que j'en ai le titre et que je n'en ai pas le cheval... Commis à cheval, sans cheval... Dérision, n'est-ce pas ! ironie, antithèse ! car... Notre cheval à nous, seigneur, ce sont nos jambes. Et d'un geste de pitié, le poète me montra ses longues jambes étiques que terminaient des souliers lamentables, hideusement éculés. -Mais il ne s'agit pas de cela, reprit Hippolyte Dougère... Si je vous dévoile ma profession - bâillon, carcan, boulet -, ne croyez pas que je m'en vante... Oh ! non ! C'est uniquement pour vous dire : « Vous avez devant vous un commis à cheval, un rat de cave à cheval... » Il prononça ce mot, en ricanant amèrement, comme s'il voulait résumer toutes ses protestations contre l'injustice des répartitions sociales. -Vous avez devant vous un rat de cave à cheval, continua-t-il... Vous comprenez ce que cela signifie... C'est-à-dire un être faible, obscur, pauvre... Regardez-moi... Or, aujourd'hui, pour arriver, il faut être fort, connu, riche... Il faut surtout ne pas être rat de cave... Est-ce vrai !... Que voulez-vous qu'on pense de quelqu'un qui arpente, tous les jours, la campagne, des registres sur le dos, comme un fou... de quelqu'un qui compte des bouteilles de vin, des litres de trois-six dans les caves des cabarets... qui sonde les fûts, espionne les foudres, tape familièrement sur le ventre des barriques... oui, des barriques !... de quelqu'un qui sème partout les amendes et les procès-verbaux ? Pensera-t-on jamais qu'un tel misérable puisse écrire des tragédies ?... Je vous le demande... non ?... Eh bien ! j'en écris... Hippolyte Dougère promena autour de lui un regard de défi. -J'en écris, répéta-t-il d'une voix retentissante... Oui, monsieur, j'ai cette audace... Tragédies historiques, drames sociaux... la patrie, l'humanité, l'indépendance, la revanche de l'individu contre l'étouffement de la société... voilà ce que j'écris !... tout cela, en vers, en vers libres. -Et il y a longtemps, demandai-je, que vous écrivez des tragédies... en vers ? -Longtemps ?... Depuis huit ans... Depuis que je suis marié... Alors, j'étais à Caen, employé à la direction... employé !... Savez-vous ce que c'est que d'être employé !... J'allais souvent dans un petit café-concert... J'y tombai amoureux d'une chanteuse comique... Elle était sage, cette chanteuse comique - du moins, je le crois - et je l'épousai... Voyez ce que c'est !... si j'avais été riche, comte, ou seulement coiffeur, cabotin, journaliste, je ne l'aurais pas épousée ; je l'aurais payée, ou elle m'eût payé, et j'en eusse fait ma maîtresse... Mais simple employé, c'est autre chose... Le mariage ou rien... Quelle situation de troisième acte !... J'obligeai ma femme à abandonner son art, parce qu'on n'eût pas toléré, dans l'administration, que la femme d'un futur rat de cave, fût chanteuse comique... Était-ce mon droit ?... Ne devais-je pas plutôt me sacrifier ?... Enfin je l'obligeai... Elle me chantait son répertoire... Oui, le soir, elle s'habillait avec ses anciens costumes... elle se mettait du blanc, du rouge, du noir... une fleur dans les cheveux... et elle chantait... dans notre petite chambre... pour moi !... pour moi tout seul... Que cela était triste !... Un jour, elle désira que je lui fisse une chanson... Son répertoire l'ennuyait... elle soupirait après une création... Ah ! c'était une artiste !... Je me mis à la besogne... Je n'avais jamais fait de vers, jamais je n'avais aligné que des chiffres... Eh bien ! au bout de quinze jours, j'avais composé, non pas une chanson... non... pas une chanson... mais une tragédie !... Emporté par l'inspiration, d'une simple chanson, monsieur, j'étais arrivé à une tragédie !... Sous ma plume, le vers léger des gaudrioles se transformait en vers tragique... Là où j'avais voulu mettre des assonances cabriolantes, se dressaient les rimes au grand masque terrible !... Croyez-vous aux vocations ?... au coup de foudre des vocations ?... Moi, j'y crois... Hippolyte Dougère respira un peu et ramena en arrière des mèches de cheveux qui pendaient sur son front. Il poursuivit : -Depuis le moment où je m'étais révélé poète tragique... moi simple employé, moi, futur commis à cheval... depuis ce moment, j'avais un devoir, le devoir de continuer... Je continuai... Étienne Marcel, Louis XIV, Napoléon, Gambetta... j'écrivis huit tragédies... huit ! Et ce n'est pas fini... Je les envoyai en bloc au Théâtre-Français, à l'Odéon, à l'Éden, au théâtre de Montmartre... partout enfin où il est reconnu que l'on représente des oeuvres sévères, historiques... Je les envoyai avec les recommandations de mon ami, M. Renaudot... Une fois même, je crus devoir ajouter à ce patronage une requête des plus hauts imposés de la commune... Croiriez-vous qu'on me les a renvoyées, sans les lire !... le croiriez-vous ?... Sans les lire !... Et pourquoi ?... Parce que je suis rat de cave ?... Sans doute... mais il y a une autre raison... Monsieur, je touche au point délicat... écoutez-moi... Je ne suis pas de l'école de Belot, et ma muse ne se promène pas sur des éléphants, des zèbres, des hippopotames, des girafes, à travers des décors abyssiniens ; je ne suis pas non plus de l'école de Zola... des cochonneries, fi donc !... Et cet Augier, dont on parle tant, qu'est-ce que c'est, je vous prie ? Un bourgeois... Et ce Coppée ?... le connaissez-vous ce Coppée qui s'en va rossignoler des romances au pied des statues hongroises !... et ce Delair ?... si cela ne fait pas pitié !... Il n'y a donc pas assez de théâtres pour lui en France ! il faut qu'il déborde sur la Belgique !... Quant à Victor Hugo, vous m'accorderez bien que ce ne sont que des mots... des mots qui ronflent... Moi aussi je ronfle, quand je dors, hé, hé... Mes tragédies, c'est autre chose... je remue les foules... Or, peut-on comprendre cela, un rat de cave à cheval qui remue les foules ?... Voilà la raison, monsieur... Effrayant dilemme, car enfin ou je dois continuer à remuer les foules, et il ne faut plus que je sois rat de cave ; ou je dois continuer à être rat de cave, et il ne faut plus que je remue les foules... Concluez !... Tenez, je vous apporte un fragment de ma dernière tragédie : Le Masque de la Mort Rouge... -Vous avez sans doute pris le sujet dans le conte d'Edgar Poe ? -Je n'en sais rien... J'ai vu cela quelque part... vous le lirez... et vous conclurez... Ah ! monsieur, je voudrais que vous me comprissiez... Certes je suis connu dans ce pays, je puis même affirmer que je n'y manque pas de célébrité... Le journal de l'arrondissement écrit en parlant de moi : « Notre éminent compatriote, le poète Hippolyte Dougère... » Et puis après ? qu'est-ce que cela me fait ! Je ne suis toujours qu'un poète local, je n'ai qu'une réputation de clocher ! Être acclamé par ses parents, admiré par ses amis, porté en triomphe par des gens avec qui l'on vit, que l'on tutoie... que l'on coudoie à toutes les heures de la journée... la belle affaire !... Est-ce vraiment de la célébrité ?... Non !... ce qu'il faut, c'est l'admiration inconnue ; c'est se dire : À Moscou, à Calcutta, au Japon, à Lons-le-Saulnier, dans le Soudan, à Paris, il y a des gens que tu ne connais pas, dont tu ignores le nom, le sexe, le langage et la race, qui ne sont pas habillés comme toi, qui peut-être portent des dieux peints sur les fesses, adorent des lapins blancs et mangent de la chair humaine, des gens que tu ne verras jamais, dont tu n'entendras jamais parler... jamais, jamais... et qui t'applaudissent, et qui crient : « Vive le grand poète Hippolyte Dougère » !... Voilà la célébrité, la vraie, la seule... Mais comment faire ?... Voyons, monsieur, vous écrivez dans les journaux, par conséquent, vous êtes une force, vous avez de l'influence auprès des directeurs, des acteurs, vous connaissez Coquelin [Coquelin (1841-1909), sociétaire de la Comédie-Française, dont Mirbeau a dénoncé la vanité.]... Que me faut-il de plus ?... Vous n'avez qu'un mot à dire, et toutes les portes me sont ouvertes... Mais lisez Le Masque de la Mort Rouge... Vous verrez quel souffle, quelle ampleur, quelle portée sociale... Je reviendrai... Il ne se peut pas que vous laissiez agoniser le théâtre avec ce Victorien Sardou, ce... comment l'appelez-vous ?... Paillon, Pailleron..., ce Jean Aicard [Victorien Sardou (1831-1908), Édouard Pailleron (1834-1899) et Jean Aicard (1848-1921) sont des auteurs dramatiques à succès.]... Oh ! je les connais !... Je reviendrai... Et s'il faut donner ma démission, affronter la lutte... comptez sur moi... Je reviendrai... au revoir, monsieur, je reviendrai. Hippolyte Dougère se leva. Il reprit son bâton et sa carnassière. Je vis quelque temps, sur la route, son grand corps, maigre et voûté, qui se balançait tristement sur des pattes de faucheux.
Le nid de frelons Madame Lechanteur, veuve d'un commerçant honorablement connu dans le quartier des Halles, avait quitté Paris, au début de l'été, avec sa fille, frêle et délicate enfant de quatorze ans, un peu triste, toujours un peu malade, et pour laquelle le médecin avait recommandé un séjour de plusieurs mois, au grand air, en pleine vie champêtre. -De préférence la Bretagne, avait-il ajouté. Et pas tout à fait sur la côte, à cause des vents. Après avoir longtemps et vainement cherché un endroit qui lui plût et convint à sa fille, elle avait fini par trouver, à trois kilomètres de la ville d'Auray, sur les bords du Loch, une maison charmante et très ancienne, moitié ferme, moitié château, enfouie dans la verdure, et cependant ayant vue sur la rivière, par une large échappée dans les bois. Ce qui la décida, c'est qu'il n'y avait pas de landes alentour, de ces landes mornes, comme elle en avait vu dans la campagne de Vannes et le pays Gallo, et qui lui serraient le coeur de tristesse et de peur vague. Et puis, le gardien qui l'accompagnait dans la visite domiciliaire, lui avait fait remarquer, en ouvrant les volets, que, du salon, aux heures du flot, on voyait passer les lougres, des goélettes, et toutes les chaloupes du Bouno, petit port de pêche situé près de là, au confluent du Loch et de la rivière de Sainte-Avoye. Elle s'installa donc à Toulmanach. Ainsi se nommait la propriété. Avant de partir de Paris, madame Lechanteur avait congédié ses domestiques, se disant qu'en Bretagne elle en aurait autant qu'elle en voudrait, de tous les genres, et à meilleur compte. Sur la foi de quelques historiographes romantiques, elle avait même émis cette opinion : -En Bretagne, ce sont des gens vertueux, fidèles et qui ne mangent rien ; des domestiques d'avant la Révolution ! Cependant, au bout d'un mois, quel désenchantement ! Elle avait eu douze bonnes, cuisinières et femmes de chambre, qu'elle avait été forcée, à peine arrivées, de renvoyer. Les unes volaient le sucre, le café, l'eau-de-vie ; les autres dérobaient le vin et s'ivrognaient comme des brutes. Toutes étaient d'une saleté repoussante. Celle-ci était plus insolente qu'une poissarde ; elle avait surpris celle-là avec le garçon de la ferme voisine. La dernière était partie volontairement, parce que, étant d'une congrégation, elle ne pouvait causer avec un homme, cet homme fût-il le facteur, le boucher, le boulanger, sous peine de péché mortel. Et madame Lechanteur se désolait. Obligée, le plus souvent de faire sa cuisine, son ménage, de se livrer à des besognes qui lui répugnaient, elle ne cessait de soupirer : -Eh bien, voilà un repos !... Quelle plaie, mon Dieu ! que les domestiques !... Et ce sont des Bretonnes, ça ?... Des Bretonnes !... Jamais de la vie. Elle alla compter ses peines à l'épicière. -Voyons, madame, vous ne connaîtriez pas quelqu'un ?... une bonne fille... une vraie Bretonne ? L'épicière hocha la tête. -C'est bien difficile, madame, bien difficile... Le pays est très ingrat pour la domesticité. Et, baissant les yeux, d'une voix timide, elle ajouta : -Depuis qu'il y a de la troupe, surtout !... Ces militaires, voyez-vous... C'est bien sûr le diable qui les a amenés ici ! Ça les dévergonde ! Ça les dévergonde ! -Je ne puis pourtant pas me passer de bonne ! cria madame Lechanteur. -Sans doute ! madame !... J'en connais bien une, une bonne fille, bonne cuisinière, très douce, quarante ans !... Nous l'appelons Mathurine Le Gorrec... Seulement elle est un peu drôle, un peu toquée !... Elle est restée dix ans chez madame de Créac'hadic, votre voisine, sur la rivière... -Mais, si elle est folle ? interrogea avec effroi madame Lechanteur. -Folle n'est pas le mot, répartit l'épicière... Elle est faible de tête, voilà tout... mais bien adroite, et douce comme un agneau. -Enfin, envoyez-la tout de même !... Il faut que j'en sorte !... Et puisqu'elle est douce !... Le lendemain, Mathurine Le Gorrec se présentait à Toulmanach, au moment où madame Lechanteur et sa fille achevaient de déjeuner. -Bonjour, madame !... C'est sans doute votre fille, cette belle demoiselle !... Bonjour, mademoiselle ! Madame Lechanteur examina Mathurine. Celle-ci avait un aspect avenant, propre, l'air doux, le visage souriant, les yeux un peu étranges. Elle portait la coiffe des femmes d'Auray. Un petit châle violet, à franges, couvrait ses épaules ; une coquette guimpe de fine lingerie ornait son corsage. Sans doute l'examen fut favorable, car madame Lechanteur demanda avec sympathie : -Alors, ma fille, vous désirez entrer ici comme cuisinière ? -Mais oui, madame ! avec une belle dame comme madame ! avec une belle demoiselle comme mademoiselle ! Moi, j'aime les bons maîtres ! -Vous avez été dix ans chez Madame Créac'hadic ? -Dix ans, oui, madame... Une bien bonne dame !... Et très riche !... Elle avait un râtelier en or... Le soir, elle le mettait dans un verre d'eau, pour qu'il baigne... C'était très joli, très riche... Madame a sans doute un râtelier en or ? -Non, ma fille ! répondit en souriant madame Lechanteur. Que savez-vous faire en cuisine ? Mais les yeux de Mathurine étaient fixés sur le parquet, obstinément... Tout à coup, elle se baissa, s'agenouilla, et ramena au bout de ses doigts un fragment d'allumette. -C'est une allumette, ça, madame !... c'est très dangereux !... Ainsi, madame, au Guéméné, une fois, un homme avait posé une allumette près d'un paquet de tabac... L'allumette prit feu, le tabac prit feu, la maison prit feu... Et l'on a retrouvé l'homme brûlé, sous les cendres, avec deux doigts de moins. C'est très vrai, ce que je dis à madame... Ce n'est pas un conte !... -Oui, ma fille, mais que savez-vous faire en cuisine ? -Madame, je prends deux oreilles de cochon, deux pieds de cochon, du persil haché... Et je fais cuire longtemps, longtemps !... C'est un commandant de marine, qui avait été au Sénégal, qui m'a appris cela... C'est très doux... Et ça cuit, madame, comme du beurre, comme de la paille... C'est très doux !... Et regardant autour d'elle : -Oh ! mais l'habitation est très jolie, ici... Il y a du bois !... Seulement, je tiens à prévenir madame que les bois sont dangereux... Il y a des bêtes dans les bois... Ainsi, madame, ce que je dis à madame est très vrai, ce n'est pas un conte... Ainsi mon père, un soir... -Est-ce que vous n'avez jamais été malade ? interrompit madame Lechanteur, inquiète de ces propos incohérents. -Jamais, madame... Ainsi la sonnette de madame de Créac'hadic - une grosse sonnette - m'est tombée sur la tête... C'est très vrai ce que je dis à madame... Eh bien, je n'ai rien eu à la tête... Et c'est la sonnette qui n'a plus sonné !... Ce n'est pas un conte. Elle parlait d'une voix douce et chantante. Et cette douceur, et ce chantonnement tranquillisaient un peu la pauvre veuve, malgré le décousu et l'incompréhensible verbiage de la bonne. Et puis, elle était lasse de n'avoir plus un moment de répit, impatiente de jouir du plaisir de la campagne, d'avoir quelqu'un qui pût garder, elle absente, la maison. Justement, ce jour-là, elle avait projeté de faire une excursion en rivière, de visiter le golfe si gai du Morbihan, les dolmens de Gavrinis, l'île aux Moines. Elle avait loué un bateau qui l'attendait... L'heure de la marée passait... Elle engagea Mathurine. Et après lui avoir donné des ordres, pour le dîner, elle partit... On verrait plus tard. * * * Il était huit heures du soir, quand, délicieusement fatiguées et ravies de leur promenade, elles débarquèrent, non loin de leur propriété, masquée à cet endroit par une élévation verdoyante de la rive. -Je suis curieuse de savoir, dit gaiement madame Lechanteur, comment notre Mathurine se sera tirée de son dîner !... Nous allons peut-être manger des choses extraordinaires. Puis reniflant légèrement. -Comme ça sent le roussi ! fit-elle. En même temps, au-dessus des arbres, dans le ciel, elle vit une colonne de fumée épaisse et noire qui montait. Et il lui sembla entendre des clameurs, des cris, des appels sinistres de voix humaines. -Mais que se passe-t-il donc ? se demanda-t-elle prise d'angoisse... On dirait que c'est à Toulmanach. Vite, elle escalada la rive, coupa par les bois, courut... Quelque chose rougeoyait entre les feuilles... Les clameurs se rapprochaient... Les cris se faisaient plus distincts. Et, tout à coup, aveuglée par la fumée, étourdie, bousculée, elle se trouva dans la cour et poussa un cri d'horreur. De Toulmanach, il ne restait plus rien que des murs effondrés, des poutres embrasées, des cendres rouges qui crépitaient et fumaient. Toute souriante, avec sa coiffe blanche, son fichu violet et sa guimpe bien propre, Mathurine était auprès de sa maîtresse. -C'est très curieux, madame, dit-elle... C'est un nid de frelons... Mon Dieu, oui, un nid de frelons. Et comme madame Lechanteur restait là, hébétée, les yeux fixes, ne comprenant pas, Mathurine répondit de sa voix chantante : -C'est un nid de frelons... C'est très vrai ! quand madame a été partie, j'ai visité la maison. Je suis monté au grenier... Un bien beau grenier qu'avait madame... Dans un trou de la charpente, il y avait un nid de frelons... C'est très méchant, cela, madame ; cela pique, ces petites bêtes... Au Guéméné, quand on trouve un nid de frelons, on les enfume... Et ils fuient tous. Et ils ne piquent plus... Alors j'ai apporté un fagot... J'ai mis le feu au fagot... le fagot a mis le feu à la charpente... la charpente a mis le feu à la maison qui était très belle. Et voilà !... Il n'y a plus de nid de frelons, il n'y a plus de maison... Il n'y a plus rien ! -Malheureuse !... misé... râla madame Lechanteur. Et toute pâle, battant l'air de ses mains, elle défaillit entre les bras de Mathurine. Le nid de frelons
Cet enregistrement est mis à disposition sous un contrat Creative Commons BY (attribution) NC (Pas d'utilisation commerciale) ND (Pas de modification).
Warning: Undefined variable $cookies in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 7
Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 7
Warning: Undefined variable $validcookiesStats in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 7
Warning: Undefined variable $cookies in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 134
Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 134
Warning: Undefined variable $validcookiesSoc in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 134






