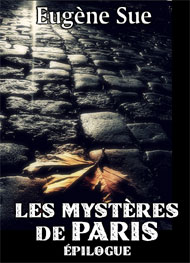
Les Mystères de Paris-épilogue
Enregistrement : Audiocite.net
Publication : 2009-11-02
Lu par Jean-François Ricou - (Email: jean-francois.ricou@wanadoo.fr)
Livre audio de 3h10min
Fichier Zip de 174 Mo (il contient des Mp3)

Télécharger
(clic droit "enregistrer sous")Signaler
une erreur
Warning: Undefined variable $cookies in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 46
Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 46
Warning: Undefined variable $validcookiesSoc in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 46
Photo: bahreynî
Certains droits réservés (licence Creative Commons)
Musique: AlbanLepsy:"Requiem love" - Licence Art libre
+++Dixième Partie
Téléchargement chapitre par chapitre:01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08.
Certains droits réservés (licence Creative Commons)
Musique: AlbanLepsy:"Requiem love" - Licence Art libre
+++Dixième Partie
Téléchargement chapitre par chapitre:01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08.
Les Mystères de Paris - Épilogue
I. Gerolstein
LE PRINCE HENRI D'HERKAUSEN-OLDENZAAL AU COMTE MAXIMILIEN KAMINETZ
Oldenzaal, 25 août 1840
J'arrive de Gerolstein, où j'ai passé trois mois auprès du grand-duc et de sa famille ; je croyais trouver une lettre m'annonçant votre arrivée à Oldenzaal, mon cher Maximilien. Jugez de ma surprise, de mon chagrin, lorsque j'apprends que vous êtes encore retenu en Hongrie pour plusieurs semaines.
Depuis quatre mois je n'ai pu vous écrire, ne sachant où vous adresser mes lettres, grâce à votre manière originale et aventureuse de voyager ; vous m'aviez pourtant formellement promis à Vienne, au moment de notre séparation, de vous trouver le 1er août à Oldenzaal. Il me faut donc renoncer au plaisir de vous voir, et pourtant jamais je n'aurais eu plus besoin d'épancher mon cœur dans le vôtre, mon bon Maximilien, mon plus vieil ami, car, quoique bien jeunes encore, notre amitié est ancienne : elle date de notre enfance.
Que vous dirai-je ? Depuis trois mois une révolution complète s'est opérée en moi… Je touche à l'un de ces instants qui décident de l'existence d'un homme… Jugez si votre présence, si vos conseils me manquent !
Mais vous ne me manquerez pas longtemps, quels que soient les intérêts qui vous retiennent en Hongrie ; vous viendrez, Maximilien, vous viendrez, je vous en conjure, car j'aurai besoin sans doute de puissantes consolations… et je ne puis aller vous chercher. Mon père dont la santé est de plus en plus chancelante, m'a rappelé de Gerolstein. Il s'affaiblit chaque jour davantage ; il m'est impossible de le quitter…
J'ai tant à vous dire que je serai prolixe : il me faut vous raconter l'époque la plus pleine, la plus romanesque de ma vie…
Étrange et triste hasard ! Pendant cette époque nous sommes fatalement restés éloignés l'un de l'autre, nous, les inséparables, nous, les deux frères, nous, les deux plus fervents apôtres de la trois fois sainte amitié ! Nous, enfin, si fiers de prouver que le Carlos et le Posa de notre Schiller ne sont pas des idéalistes, et que, comme ces divines créations du grand poëte, nous savons goûter les suaves délices d'un tendre et mutuel attachement !
Oh ! mon ami, que n'êtes-vous là ! Que n'étiez-vous là ! Depuis trois mois mon cœur déborde d'émotions à la fois d'une douceur ou d'une tristesse inexprimables. Et j'étais seul, et je suis seul… Plaignez-moi, vous qui connaissez ma sensibilité quelquefois si bizarrement expansive, vous qui souvent avez vu mes yeux se mouiller de larmes au naïf récit d'une action généreuse, au simple aspect d'un beau soleil couchant, ou d'une nuit d'été paisible et étoilée ! Vous souvenez-vous, l'an passé, lors de notre excursion aux ruines d'Oppenfeld… au bord du grand lac… nos rêveries silencieuses pendant cette magnifique soirée si remplie de calme, de poésie et de sérénité ?
Bizarre contraste !… C'était trois jours avant ce duel sanglant où je n'ai pas voulu vous prendre pour second, car j'aurais trop souffert pour vous, si j'avais été blessé sous vos yeux… Ce duel, où, pour une querelle de jeu, mon second, à moi, a malheureusement tué ce jeune Français, le vicomte de Saint-Remy… À propos, savez-vous ce qu'est devenue cette dangereuse sirène que M. de Saint-Remy avait amenée à Oppenfeld, et qui se nommait, je crois, Cecily David ?
Mon ami, vous devez sourire de pitié en me voyant m'égarer ainsi parmi de vagues souvenirs du passé, au lieu d'arriver aux graves confidences que je vous annonce ; c'est que, malgré moi, je recule l'instant de ces confidences ; je connais votre sévérité, et j'ai peur d'être grondé, oui, grondé, parce qu'au lieu d'agir avec réflexion, avec sagesse (une sagesse de vingt et un ans, hélas !), j'ai agi follement, ou plutôt je n'ai pas agi… je me suis laissé aveuglément emporter au courant qui m'entraînait… et c'est seulement depuis mon retour de Gerolstein que je me suis, pour ainsi dire, éveillé du songe enchanteur qui m'a bercé pendant trois mois… et ce réveil est funeste…
Allons, mon ami, mon bon Maximilien, je prends mon grand courage. Écoutez-moi avec indulgence… Je commence en baissant les yeux, je n'ose vous regarder… car, en lisant ces lignes, vos traits doivent être devenus si graves, si sévères… homme stoïque !
Ayant obtenu un congé de six mois, je quittai Vienne, et je restai ici quelque temps auprès de mon père ; sa santé étant bonne alors, il me conseilla d'aller visiter mon excellente tante, la princesse Juliane, supérieure de l'abbaye de Gerolstein. Je vous ai dit, je crois, mon ami, que mon aïeule était cousine germaine de l'aïeul du grand-duc actuel, et que ce dernier, Gustave-Rodolphe, grâce à cette parenté, a toujours bien voulu nous traiter, moi et mon père, très-affectueusement de cousins. Vous savez aussi, je crois, que, pendant un assez long voyage que le prince fit dernièrement en France, il chargea mon père de l'administration du grand-duché.
Ce n'est nullement par orgueil, vous le pensez, mon ami, que je vous parle de ces circonstances ; c'est pour vous expliquer les causes de l'extrême intimité dans laquelle j'ai vécu avec le grand-duc et sa famille pendant mon séjour à Gerolstein.
Vous souvenez-vous que l'an passé, lors de notre voyage des bords du Rhin, on nous apprit que le prince avait retrouvé en France et épousé in extremis Mme la comtesse Mac-Gregor, afin de légitimer la naissance d'une fille qu'il avait eue d'elle lors d'une première union secrète, plus tard cassée pour vice de forme et parce qu'elle avait été contractée malgré la volonté du grand-duc alors régnant ?
Cette jeune fille, ainsi solennellement reconnue, est cette charmante princesse Amélie[2] dont lord Dudley, qui l'avait vue à Gerolstein il y a maintenant une année environ, nous parlait cet hiver, à Vienne, avec un enthousiasme que nous accusions d'exagération… Étrange hasard !… Qui m'eût dit alors !…
Mais, quoique vous ayez sans doute maintenant à peu près deviné mon secret, laissez-moi suivre la marche des événements sans l'intervertir…
Le couvent de Sainte-Hermangilde, dont ma tante est abbesse, est à peine éloigné d'un demi-quart de lieue de Gerolstein, car les jardins de l'abbaye touchent aux faubourgs de la ville ; une charmante maison, complètement isolée du cloître, avait été mise à ma disposition par ma tante, qui m'aime, vous le savez, avec une tendresse maternelle.
Le jour de mon arrivée, elle m'apprit qu'il y avait le lendemain réception solennelle et fête à la cour, le grand-duc devant ce jour-là officiellement annoncer son prochain mariage avec Mme la marquise d'Harville, arrivée depuis peu à Gerolstein, accompagnée de son père, M. le comte d'Orbigny[3].
Les uns blâmaient le prince de n'avoir pas recherché encore cette fois une alliance souveraine (la grande-duchesse dont le prince était veuf appartenait à la maison de Bavière), d'autres, au contraire, et ma tante était du nombre, le félicitaient d'avoir préféré à des vues d'ambitieuses convenances une jeune et aimable femme qu'il adorait et qui appartenait à la plus haute noblesse de France. Vous savez d'ailleurs, mon ami, que ma tante a toujours eu pour le grand-duc Rodolphe l'attachement le plus profond ; mieux que personne elle pouvait apprécier les éminentes qualités du prince.
– Mon cher enfant, me dit-elle, à propos de cette réception solennelle où je devais me rendre le lendemain de mon arrivée, mon cher enfant, ce que vous verrez de plus merveilleux dans cette fête sera sans contredit la perle de Gerolstein.
– De qui voulez-vous parler, ma bonne tante ?
– De la princesse Amélie…
– La fille du grand-duc ? En effet, lord Dudley nous en avait parlé à Vienne avec un enthousiasme que nous avions taxé d'exagération poétique.
– À mon âge, avec mon caractère et dans ma position, reprit ma tante, on s'exalte assez peu ; aussi vous croirez à l'impartialité de mon jugement, mon cher enfant ! Eh bien ! je vous dis, moi, que de ma vie je n'ai rien connu de plus enchanteur que la princesse Amélie. Je vous parlerais de son angélique beauté, si elle n'était pas douée d'un charme inexprimable qui est encore supérieur à la beauté. Figurez-vous la candeur dans la dignité et la grâce dans la modestie. Dès le premier jour où le grand-duc m'a présentée à elle, j'ai senti pour cette jeune princesse une sympathie involontaire. Du reste, je ne suis pas la seule : l'archiduchesse Sophie est à Gerolstein depuis quelques jours ; c'est bien la plus fière et la plus hautaine princesse que je sache…
– Il est vrai, ma tante, son ironie est terrible, peu de personnes échappent à ses mordantes plaisanteries. À Vienne on la craignait comme le feu… La princesse Amélie aurait-elle trouvé grâce devant elle ?
– L'autre jour elle vint ici après avoir visité la maison d'asile placée sous la surveillance de la jeune princesse. Savez-vous une chose ? me dit cette redoutable archiduchesse avec sa brusque franchise ; j'ai l'esprit singulièrement tourné à la satire, n'est-ce pas ? Eh bien ! si je vivais longtemps avec la fille du grand-duc, je deviendrais, j'en suis sûre, inoffensive… tant sa bonté est pénétrante et contagieuse.
– Mais c'est donc une enchanteresse que ma cousine ? dis-je à ma tante en souriant.
– Son plus puissant attrait, à mes yeux du moins, reprit ma tante, est ce mélange de douceur, de modestie et de dignité dont je vous ai parlé, et qui donne à son visage angélique l'expression la plus touchante.
– Certes, ma tante, la modestie est une rare qualité chez une princesse si jeune, si belle et si heureuse.
– Songez encore, mon cher enfant, qu'il est d'autant mieux à la princesse Amélie de jouir sans ostentation vaniteuse de la haute position qui lui est incontestablement acquise, que son élévation est récente[4].
– Et dans son entretien avec vous, ma tante, la princesse a-t-elle fait quelque allusion à sa fortune passée ?
– Non ; mais lorsque, malgré mon grand âge, je lui parlai avec le respect qui lui est dû, puisque Son Altesse est la fille de notre souverain, son trouble ingénu, mêlé de reconnaissance et de vénération pour moi, m'a profondément émue ; car sa réserve, remplie de noblesse et d'affabilité, me prouvait que le présent ne l'enivrait pas assez pour qu'elle oubliât le passé, et qu'elle rendait à mon âge ce que j'accordais à son rang.
– Il faut, en effet, dis-je à ma tante, un tact exquis pour observer ces nuances si délicates.
– Aussi, mon cher enfant, plus j'ai vu la princesse Amélie, plus je me suis félicitée de ma première impression. Depuis qu'elle est ici, ce qu'elle a fait de bonnes œuvres est incroyable, et cela avec une réflexion, une maturité de jugement qui me confondent chez une personne de son âge. Jugez-en : à sa demande, le grand-duc a fondé à Gerolstein un établissement pour les petites filles orphelines de cinq ou six ans, et pour les jeunes filles orphelines aussi abandonnées, qui ont atteint seize ans, âge si fatal pour les infortunées que rien ne défend contre la séduction du vice ou l'obsession du besoin. Ce sont des religieuses nobles de mon abbaye qui enseignent et dirigent les pensionnaires de cette maison. En allant la visiter, j'ai eu souvent occasion de juger de l'adoration que ces pauvres créatures déshéritées ont pour la princesse Amélie. Chaque jour elle va passer quelques heures dans cet établissement, placé sous sa protection spéciale ; et, je vous le répète, mon enfant, ce n'est pas seulement du respect, de la reconnaissance, que les pensionnaires et les religieuses ressentent pour Son Altesse, c'est presque du fanatisme.
– Mais c'est un ange que la princesse Amélie, dis-je à ma tante.
– Un ange, oui, un ange, reprit-elle, car vous ne pouvez vous imaginer avec quelle attendrissante bonté elle traite ses protégées, de quelle pieuse sollicitude elle les entoure. Jamais je n'ai vu ménager avec plus de délicatesse la susceptibilité du malheur ; on dirait qu'une irrésistible sympathie attire surtout la princesse vers cette classe de pauvres abandonnées. Enfin, le croiriez-vous ? elle, fille d'un souverain, n'appelle jamais autrement ces jeunes filles que mes sœurs.
À ces derniers mots de ma tante, je vous l'avoue, Maximilien, une larme me vint aux yeux. Ne trouvez-vous pas en effet belle et sainte la conduite de cette jeune princesse ? Vous connaissez ma sincérité, je vous jure que je vous rapporte et que je vous rapporterai toujours presque textuellement les paroles de ma tante.
– Puisque la princesse, lui dis-je, est si merveilleusement douée, j'éprouverai un grand trouble lorsque demain je lui serai présenté ; vous connaissez mon insurmontable timidité, vous savez que l'élévation du caractère m'impose encore plus que le rang : je suis donc certain de paraître à la princesse aussi stupide qu'embarrassé ; j'en prends mon parti d'avance.
– Allons, allons, me dit ma tante en souriant, elle aura pitié de vous, mon cher enfant, d'autant plus que vous ne serez pas pour elle une nouvelle connaissance.
– Moi, ma tante ?
– Sans doute.
– Et comment cela ?
– Vous vous souvenez que, lorsqu'à l'âge de seize ans vous avez quitté Oldenzaal pour faire un voyage en Russie et en Angleterre avec votre père, j'ai fait faire de vous un portrait dans le costume que vous portiez au premier bal costumé donné par feu la grande-duchesse.
– Oui, ma tante, un costume de page allemand du XVIe siècle.
– Notre excellent peintre Fritz Mocker, tout en reproduisant fidèlement vos traits, n'avait pas seulement retracé un personnage du XVIe siècle ; mais, par un caprice d'artiste, il s'était plu à imiter jusqu'à la manière et jusqu'à la vétusté des tableaux peints à cette époque. Quelques jours après son arrivée en Allemagne, la princesse Amélie, étant venue me voir avec son père, remarqua votre portrait et me demanda naïvement quelle était cette charmante figure des temps passés. Son père sourit, me fit un signe, et lui répondit : « Ce portrait est celui d'un de nos cousins, qui aurait maintenant, vous le voyez, à son costume, ma chère Amélie, quelque trois cents ans, mais qui, bien jeune, avait déjà témoigné d'une rare intrépidité et d'un cœur excellent ; ne porte-t-il pas, en effet, la bravoure dans le regard et la bonté dans le sourire ? »
(Je vous en supplie, Maximilien, ne haussez pas les épaules avec un impatient dédain en me voyant écrire de telles choses à propos de moi-même ; cela me coûte, vous devez le croire ; mais la suite de ce récit vous prouvera que ces puérils détails, dont je sens le ridicule amer, sont malheureusement indispensables. Je ferme cette parenthèse, et je continue.)
– La princesse Amélie, reprit ma tante, dupe de cette innocente plaisanterie, partagea l'avis de son père sur l'expression douce et fière de votre physionomie, après avoir plus attentivement considéré le portrait. Plus tard, lorsque j'allai la voir à Gerolstein, elle me demanda, en souriant, des nouvelles de son cousin des temps passés. Je lui avouai alors notre supercherie, lui disant que le beau page du XVIe siècle était simplement mon neveu, le prince Henri d'Herkaüsen-Oldenzaal, actuellement âgé de vingt et un ans, capitaine aux gardes de S. M. l'empereur d'Autriche, et en tout, sauf le costume, fort ressemblant à son portrait. À ces mots, la princesse Amélie, ajouta ma tante, rougit et redevint sérieuse, comme elle l'est presque toujours. Depuis elle ne m'a naturellement jamais reparlé du tableau. Néanmoins, vous voyez, mon cher enfant, que vous ne serez pas complètement étranger et un nouveau visage pour votre cousine, comme dit le grand-duc. Ainsi donc, rassurez-vous, et soutenez l'honneur de votre portrait, ajouta ma tante en souriant.
Cette conversation avait eu lieu, je vous l'ai dit, mon cher Maximilien, la veille du jour où je devais être présenté à la princesse ma cousine ; je quittai ma tante, et je rentrai chez moi.
Je ne vous ai jamais caché mes plus secrètes pensées, bonnes ou mauvaises ; je vais donc vous avouer à quelles absurdes et folles imaginations je me laissai entraîner après l'entretien que je viens de vous rapporter.
II. Gerolstein (suite)
LE PRINCE HENRI D'HERKAUSEN-OLDENZAAL AU COMTE MAXIMILIEN KAMINETZ
Vous m'avez dit bien des fois, mon cher Maximilien, que j'étais dépourvu de toute vanité ; je le crois, j'ai besoin de le croire pour continuer ce récit sans m'exposer à passer à vos yeux pour un présomptueux.
Lorsque je fus seul chez moi, me rappelant l'entretien de ma tante, je ne pus m'empêcher de songer, avec une secrète satisfaction, que la princesse Amélie, ayant remarqué ce portrait de moi fait depuis six ou sept ans, avait quelques jours après demandé, en plaisantant, des nouvelles de son cousin des temps passés.
Rien n'était plus sot que de baser le moindre espoir sur une circonstance aussi insignifiante, j'en conviens ; mais, je vous l'ai dit, je serai comme toujours, envers vous, de la plus entière franchise : eh bien ! cette insignifiante circonstance me ravit. Sans doute, les louanges que j'avais entendu donner à la princesse Amélie par une femme aussi grave, aussi austère que ma tante, en élevant davantage la princesse à mes yeux, me rendaient plus sensible encore la distinction qu'elle avait daigné m'accorder, ou plutôt qu'elle avait accordée à mon portrait. Pourtant, que vous dirai-je ! cette distinction éveilla en moi des espérances si folles que, jetant à cette heure un regard plus calme sur le passé, je me demande comment j'ai pu me laisser entraîner à ces pensées qui aboutissaient inévitablement à un abîme.
Quoique parent du grand duc et toujours parfaitement accueilli de lui, il m'était impossible de concevoir la moindre espérance de mariage avec la princesse, lors même qu'elle eût agréé mon amour, ce qui était plus qu'improbable. Notre famille tient honorablement à son rang, mais elle est pauvre, si on compare notre fortune aux immenses domaines du grand-duc, le prince le plus riche de la Confédération germanique ; et puis enfin j'avais vingt et un ans à peine, j'étais simple capitaine aux gardes, sans renom, sans position personnelle ; jamais en un mot, le grand-duc ne pouvait songer à moi pour sa fille.
Toutes ces réflexions auraient dû me préserver d'une passion que je n'éprouvais pas encore, mais dont j'avais pour ainsi dire le singulier pressentiment. Hélas ! je m'abandonnai au contraire à de nouvelles puérilités. Je portais au doigt une bague qui m'avait été autrefois donnée par Thécla (la bonne comtesse que vous connaissez) : quoique ce gage d'un amour étourdi, facile et léger, ne pût me gêner beaucoup, j'en fis héroïquement le sacrifice à mon amour naissant, et le pauvre anneau disparut dans les eaux rapides de la rivière qui coule sous mes fenêtres.
Vous dire la nuit que je passai est inutile : vous la devinez. Je savais la princesse Amélie blonde et d'une angélique beauté : je tâchai de m'imaginer ses traits, sa taille, son maintien, le son de sa voix, l'expression de son regard ; puis, songeant à mon portrait qu'elle avait remarqué, je me rappelai à regret que l'artiste maudit m'avait dangereusement flatté ; de plus, je comparais avec désespoir le costume pittoresque du page du XVIe siècle au sévère uniforme du capitaine aux gardes de Sa Majesté Impériale. Puis, à ces niaises préoccupations succédaient çà et là, je vous l'assure, mon ami, quelques pensées généreuses, quelques nobles élans de l'âme ; je me sentais ému, oh ! profondément ému, au ressouvenir de cette adorable bonté de la princesse Amélie, qui appelait les pauvres abandonnées qu'elle protégeait ses sœurs, m'avait dit ma tante.
Enfin, bizarre et inexplicable contraste ! j'ai, vous le savez, la plus humble opinion de moi-même… et j'étais cependant assez glorieux pour supposer que la vue de mon portrait avait frappé la princesse ; j'avais assez de bon sens pour comprendre qu'une distance infranchissable me séparait d'elle à jamais, et cependant je me demandais avec une véritable anxiété si elle ne me trouverait pas trop indigne de mon portrait. Enfin je ne l'avais jamais vue, j'étais convaincu d'avance qu'elle me remarquerait à peine… et cependant je me croyais le droit de lui sacrifier le gage de mon premier amour.
Je passai dans de véritables angoisses la nuit dont je vous parle et une partie du lendemain. L'heure de la réception arriva. J'essayai deux ou trois habits d'uniforme, les trouvant plus mal faits les uns que les autres, et je partis pour le palais grand-ducal très-mécontent de moi.
Quoique Gerolstein soit à peine éloigné d'un quart de lieue de l'abbaye de Sainte-Hermangilde, durant ce court trajet mille pensées m'assaillirent, toutes les puérilités dont j'avais été si occupé disparurent devant une idée grave, triste, presque menaçante ; un invincible pressentiment m'annonçait une de ces crises qui dominent la vie tout entière, une sorte de révélation me disait que j'allais aimer, aimer passionnément, aimer comme on n'aime qu'une fois ; et, pour comble de fatalité, cet amour, aussi hautement que dignement placé, devait être pour moi toujours malheureux.
Ces idées m'effrayèrent tellement que je pris tout à coup la sage résolution de faire arrêter ma voiture, de revenir à l'abbaye et d'aller rejoindre mon père, laissant à ma tante le soin d'excuser mon brusque départ auprès du grand-duc.
Malheureusement une de ces causes vulgaires dont les effets sont quelquefois immenses m'empêcha d'exécuter mon premier dessein. Ma voiture étant arrêtée à l'entrée de l'avenue qui conduit au palais, je me penchais à la portière pour donner à mes gens ordre de retourner, lorsque le baron et la baronne Koller, qui, comme moi, se rendaient à la cour, m'aperçurent et firent aussi arrêter leur voiture. Le baron, me voyant en uniforme, me dit : « Pourrai-je vous être bon à quelque chose, mon cher prince ? Que vous arrive-t-il ? Puisque vous allez au palais, montez avec nous, dans le cas où un accident serait arrivé à vos chevaux. »
Rien ne m'était plus facile, n'est-ce pas, mon ami que de trouver une défaite pour quitter le baron et regagner l'abbaye. Eh bien ! soit impuissance, soit secret désir d'échapper à la détermination salutaire que je venais de prendre, je répondis d'un air embarrassé que je donnais ordre à mon cocher de s'informer à la grille du palais si l'on y entrait par le pavillon neuf ou par la cour de marbre.
– On entre par la cour de marbre, mon cher prince, me répondit le baron, car c'est une réception de grand gala. Dites à votre voiture de suivre la mienne, je vous indiquerai le chemin.
Vous savez, Maximilien, combien je suis fataliste ; je voulais retourner à l'abbaye pour m'épargner les chagrins que je pressentais ; le sort s'y opposait, je m'abandonnai à mon étoile. Vous ne connaissez pas le palais grand-ducal de Gerolstein, mon ami ? Selon tous ceux qui ont visité les capitales d'Europe, il n'est pas, à l'exception de Versailles, une résidence royale dont l'ensemble et les abords soient d'un aspect plus majestueux. Si j'entre dans quelques détails à ce sujet, c'est qu'en me souvenant à cette heure de ces imposantes splendeurs, je me demande comment elles ne m'ont pas tout d'abord rappelé à mon néant ; car enfin la princesse Amélie était fille du souverain maître de ce palais, de ces gardes, de ces richesses merveilleuses.
La cour de marbre, vaste hémicycle, est ainsi appelée parce qu'à l'exception d'un large chemin de ceinture où circulent les voitures, elle est dallée de marbres de toutes couleurs, formant de magnifiques mosaïques au centre desquelles se dessine un immense bassin revêtu de brèche antique, alimenté par d'abondantes eaux qui tombent incessamment d'une large vasque de porphyre.
Cette cour d'honneur est circulairement entourée d'une rangée de statues de marbre blanc du plus haut style, portant des torchères de bronze doré d'où jaillissent des flots de gaz éblouissant. Alternant avec ces statues, des vases Médicis, exhaussés sur leurs socles richement sculptés, renfermaient d'énormes lauriers-roses, véritables buissons fleuris, dont le feuillage lustré, vu aux lumières, resplendissait d'une verdure métallique.
Les voitures s'arrêtaient au pied d'une double rampe à balustres qui conduisait au péristyle du palais ; au pied de cet escalier se tenaient en vedette, montés sur leurs chevaux noirs, deux cavaliers du régiment des gardes du grand-duc, qui choisit ces soldats parmi les sous-officiers les plus grands de son armée. Vous, mon ami, qui aimez tant les gens de guerre, vous eussiez été frappé de la tournure sévère et martiale de ces deux colosses, dont la cuirasse et le casque d'acier d'un profil antique, sans cimier ni crinière, étincelaient aux lumières ; ces cavaliers portaient l'habit bleu à collet jaune, le pantalon de daim blanc et les bottes fortes montant au-dessus du genou. Enfin pour vous, mon ami, qui aimez ces détails militaires, j'ajouterai qu'au haut de l'escalier, de chaque côté de la porte, deux grenadiers du régiment d'infanterie de la garde grand-ducale étaient en faction. Leur tenue, sauf la couleur de l'habit et les revers, ressemblait, m'a-t-on dit, à celle des grenadiers de Napoléon.
Après avoir traversé le vestibule où se tenaient, hallebarde en main, les suisses de livrée du prince, je montai un imposant escalier de marbre blanc qui aboutissait à un portique orné de colonnes de jaspe et surmonté d'une coupole peinte et dorée. Là se trouvaient deux longues files de valets de pied. J'entrai ensuite dans la salle des gardes, à la porte de laquelle se tenaient toujours un chambellan et un aide de camp de service, chargés de conduire auprès de Son Altesse Royale les personnes qui avaient droit à lui être particulièrement présentées. Ma parenté, quoique éloignée, me valut cet honneur : un aide de camp me précéda dans une longue galerie remplie d'hommes en habit de cour ou d'uniforme, et de femmes en grande parure.
Pendant que je traversais lentement cette foule brillante, j'entendis quelques paroles qui augmentèrent encore mon émotion : de tous côtés on admirait l'angélique beauté de la princesse Amélie, les traits charmants de la marquise d'Harville, et l'air véritablement impérial de l'archiduchesse Sophie, qui, récemment arrivée de Munich avec l'archiduc Stanislas, allait bientôt repartir pour Varsovie ; mais, tout en rendant hommage à l'altière dignité de l'archiduchesse, à la gracieuse distinction de la marquise d'Harville, on reconnaissait que rien n'était plus idéal que la figure enchanteresse de la princesse Amélie.
À mesure que j'approchais de l'endroit où se tenaient le grand-duc et sa fille, je sentais mon cœur battre avec violence. Au moment où j'arrivai à la porte de ce salon (j'ai oublié de vous dire qu'il y avait bal et concert à la cour), l'illustre Liszt venait de se mettre au piano ; aussi le silence le plus recueilli succéda-t-il au léger murmure des conversations. En attendant la fin du morceau, que le grand artiste jouait avec sa supériorité accoutumée, je restai dans l'embrasure d'une porte.
Alors, mon cher Maximilien, pour la première fois je vis la princesse Amélie. Laissez-moi vous dépeindre cette scène, car j'éprouve un charme indicible à rassembler ces souvenirs.
Figurez-vous, mon ami, un vaste salon meublé avec une somptuosité royale, éblouissant de lumières et tendu d'étoffe de soie cramoisie, sur laquelle courait un feuillage d'or brodé en relief. Au premier rang, sur de grands fauteuils dorés, se tenait l'archiduchesse Sophie (le prince lui faisait les honneurs de son palais) ; à sa gauche Mme la marquise d'Harville, et à sa droite la princesse Amélie ; debout derrière elles était le grand-duc, portant l'uniforme de colonel de ses gardes ; il semblait rajeuni par le bonheur et ne pas avoir plus de trente ans ; l'habit militaire faisait encore valoir l'élégance de sa taille et la beauté de ses traits ; auprès de lui était l'archiduc Stanislas en costume de feld-maréchal, puis venaient ensuite les dames d'honneur de la princesse Amélie, les femmes des grands dignitaires de la cour, et enfin ceux-ci.
Ai-je besoin de vous dire que la princesse Amélie, moins encore par son rang que par sa grâce et sa beauté, dominait cette foule étincelante ? Ne me condamnez pas, mon ami, sans lire ce portrait. Quoiqu'il soit mille fois encore au-dessous de la réalité, vous comprendrez mon adoration, vous comprendrez que dès que je la vis je l'aimai, et que la rapidité de cette passion ne put être égalée que par sa violence et son éternité.
La princesse Amélie, vêtue d'une simple robe de moire blanche, portait, comme l'archiduchesse Sophie, le grand cordon de l'ordre impérial de Saint-Népomucène, qui lui avait été récemment envoyé par l'impératrice. Un bandeau de perles, entourant son front noble et candide, s'harmonisait à ravir avec les deux grosses nattes de cheveux d'un blond cendré magnifique qui encadraient ses joues légèrement rosées ; ses bras charmants, plus blancs encore que les flots de dentelle d'où ils sortaient, étaient à demi cachés par des gants qui s'arrêtaient au-dessous de son coude à fossette ; rien de plus accompli que sa taille, rien de plus joli que son pied chaussé de satin blanc. Au moment où je la vis, ses grands yeux, du plus pur azur, étaient rêveurs ; je ne sais même si à cet instant elle subissait l'influence de quelque pensée sérieuse, ou si elle était vivement impressionnée par la sombre harmonie du morceau que jouait Liszt ; mais son demi-sourire me parut d'une douceur et d'une mélancolie indicibles. La tête légèrement baissée sur sa poitrine, elle effeuillait machinalement un gros bouquet d'œillets blancs et de roses qu'elle tenait à la main.
Jamais je ne pourrai vous exprimer ce que je ressentis alors : tout ce que m'avait dit ma tante de l'ineffable bonté de la princesse Amélie me revint à la pensée… Souriez, mon ami… mais malgré moi je sentis mes yeux devenir humides en voyant rêveuse, presque triste, cette jeune fille si admirablement belle, entourée d'honneurs, de respects, et idolâtrée par un père tel que le grand-duc.
Maximilien, je vous l'ai souvent dit : de même que je crois l'homme incapable de goûter certains bonheurs pour ainsi dire trop complets, trop immenses pour ses facultés bornées, de même aussi je crois certains êtres trop divinement doués pour ne pas quelquefois sentir avec amertume combien ils sont esseulés ici-bas, et pour ne pas alors regretter vaguement leur exquise délicatesse, qui les expose à tant de déceptions, à tant de froissements ignorés des natures moins choisies… Il me semblait qu'alors la princesse Amélie éprouvait la réaction d'une pensée pareille.
Tout à coup, par un hasard étrange (tout est fatalité dans ceci), elle tourna machinalement les yeux du côté où je me trouvais.
Vous savez combien l'étiquette et la hiérarchie des rangs sont scrupuleusement observées chez nous. Grâce à mon titre et aux liens de parenté qui m'attachent au grand-duc, les personnes au milieu desquelles je m'étais d'abord placé s'étaient peu à peu reculées, de sorte que je restai presque seul et très-en évidence au premier rang, dans l'embrasure de la porte de la galerie.
Il fallut cette circonstance pour que la princesse Amélie, sortant de sa rêverie, m'aperçût et me remarquât sans doute, car elle fit un léger mouvement de surprise, et rougit.
Elle avait vu mon portrait à l'abbaye, chez ma tante, elle me reconnaissait : rien de plus simple. La princesse m'avait à peine regardé pendant une seconde, mais ce regard me fit éprouver une commotion violente, profonde : je sentis mes joues en feu, je baissai les yeux et je restai quelques minutes sans oser les lever de nouveau sur la princesse… Lorsque je m'y hasardai, elle causait tout bas avec l'archiduchesse Sophie, qui semblait l'écouter avec le plus affectueux intérêt.
Liszt ayant mis un intervalle de quelques minutes entre les deux morceaux qu'il devait jouer, le grand-duc profita de ce moment pour lui exprimer son admiration de la manière la plus gracieuse. Le prince, revenant à sa place, m'aperçut, me fit un signe de tête rempli de bienveillance et dit quelques mots à l'archiduchesse en me désignant du regard. Celle-ci, après m'avoir un instant considéré, se retourna vers le grand-duc, qui ne put s'empêcher de sourire en lui répondant et en adressant la parole à sa fille. La princesse Amélie me parut embarrassée, car elle rougit de nouveau.
J'étais au supplice ; malheureusement l'étiquette ne me permettait pas de quitter la place où je me trouvais avant la fin du concert, qui recommença bientôt. Deux ou trois fois je regardai la princesse Amélie à la dérobée ; elle me sembla pensive et attristée ; mon cœur se serra ; je souffrais de la légère contrariété que je venais de lui causer involontairement, et que je croyais deviner. Sans doute le grand-duc lui avait demandé en plaisantant si elle me trouvait quelque ressemblance avec le portrait de son cousin des temps passés ; et, dans son ingénuité, elle se reprochait peut-être de n'avoir pas dit à son père qu'elle m'avait déjà reconnu. Le concert terminé, je suivis l'aide de camp de service ; il me conduisit auprès du grand-duc, qui voulut bien faire quelques pas au-devant de moi, me prit cordialement par le bras et dit à l'archiduchesse Sophie, en s'approchant d'elle :
– Je demande à Votre Altesse Impériale la permission de lui présenter mon cousin le prince Henri d'Herkaüsen-Oldenzaal.
– J'ai déjà vu le prince à Vienne, et je le retrouve ici avec plaisir, répondit l'archiduchesse, devant laquelle je m'inclinai profondément.
– Ma chère Amélie, reprit le prince en s'adressant à sa fille, je vous présente le prince Henri, votre cousin ; il est fils du prince Paul, l'un de mes plus vénérables amis, que je regrette bien de ne pas voir aujourd'hui à Gerolstein.
– Voudriez-vous, monsieur, faire savoir au prince Paul que je partage vivement les regrets de mon père, car je serai toujours bien heureuse de connaître ses amis, me répondit ma cousine avec une simplicité pleine de grâce…
Je n'avais jamais entendu le son de la voix de la princesse ; imaginez-vous, mon ami, le timbre le plus doux, le plus frais, le plus harmonieux, enfin un de ces accents qui font vibrer les cordes les plus délicates de l'âme.
– J'espère, mon cher Henri, que vous resterez quelque temps chez votre tante que j'aime, que je respecte comme ma mère, vous le savez, me dit le grand-duc avec bonté. Venez souvent nous voir en famille, à la fin de la matinée, sur les trois heures : si nous sortons, vous partagerez notre promenade ; vous savez que je vous ai toujours aimé, parce que vous êtes un des plus nobles cœurs que je connaisse.
– Je ne sais comment exprimer à Votre Altesse Royale ma reconnaissance pour le bienveillant accueil qu'elle daigne me faire.
– Eh bien ! pour me prouver votre reconnaissance, dit le prince en souriant, invitez votre cousine pour la deuxième contredanse, car la première appartient de droit à l'archiduc…
– Votre Altesse voudra-t-elle m'accorder cette grâce ?… dis-je à la princesse Amélie en m'inclinant devant elle.
– Appelez-vous simplement cousin et cousine, selon la bonne vieille coutume allemande, dit gaiement le grand-duc ; le cérémonial ne convient pas entre parents.
– Ma cousine me fera-t-elle l'honneur de danser cette contredanse avec moi ?
– Oui, mon cousin, me répondit la princesse Amélie.
III. Gerolstein (suite et fin)
LE PRINCE HENRI D'HERKAUSEN-OLDENZAAL AU COMTE MAXIMILIEN KAMINETZ
Je ne saurais vous dire, mon ami, combien je fus à la fois heureux et peiné de la paternelle cordialité du grand-duc ; la confiance qu'il me témoignait, l'affectueuse bonté avec laquelle il avait engagé sa fille et moi à substituer aux formules de l'étiquette ces appellations de famille d'une intimité si douce, tout me pénétrait de reconnaissance ; je me reprochais d'autant plus amèrement le charme fatal d'un amour qui ne devait ni ne pouvait être agréé par le prince.
Je m'étais promis, il est vrai (je n'ai pas failli à cette résolution) de ne jamais dire un mot qui pût faire soupçonner à ma cousine l'amour que je ressentais ; mais je craignais que mon émotion, que mes regards me trahissent… Malgré moi pourtant, ce sentiment, si muet, si caché qu'il dût être, me semblait coupable.
J'eus le temps de faire ces réflexions pendant que la princesse Amélie dansait la première contredanse avec l'archiduc Stanislas. Ici, comme partout, la danse n'est plus qu'une sorte de marche qui suit la mesure de l'orchestre ; rien ne pouvait faire valoir davantage la grâce sérieuse du maintien de ma cousine.
J'attendais avec un bonheur mêlé d'anxiété le moment d'entretien que la liberté du bal allait me permettre d'avoir avec elle. Je fus assez maître de moi pour cacher mon trouble lorsque j'allai la chercher auprès de la marquise d'Harville.
En songeant aux circonstances du portrait, je m'attendais à voir la princesse Amélie partager mon embarras ; je ne me trompais pas. Je me souviens presque mot pour mot de notre première conversation ; laissez-moi vous la rapporter, mon ami :
– Votre Altesse me permettra-t-elle, lui dis-je, de l'appeler ma cousine, ainsi que le grand-duc m'y autorise ?
– Sans doute, mon cousin, me répondit-elle avec grâce ; je suis toujours heureuse d'obéir à mon père.
– Et je suis d'autant plus fier de cette familiarité, ma cousine, que j'ai appris par ma tante à vous connaître, c'est-à-dire à vous apprécier.
– Souvent aussi mon père m'a parlé de vous, mon cousin, et ce qui vous étonnera peut-être, ajouta-t-elle timidement, c'est que je vous connaissais déjà, si cela peut se dire, de vue… Mme la supérieure de Sainte-Hermangilde, pour qui j'ai la plus respectueuse affection, nous avait un jour montré, à mon père, et à moi, un portrait…
– Où j'étais représenté en page du XVIe siècle ?
– Oui, mon cousin ; et mon père fit même la petite supercherie de me dire que ce portrait était celui d'un de nos parents du temps passé, en ajoutant d'ailleurs des paroles si bienveillantes pour ce cousin d'autrefois que notre famille doit se féliciter de le compter parmi nos parents d'aujourd'hui…
– Hélas ! ma cousine, je crains de ne pas plus ressembler au portrait moral que le grand-duc a daigné faire de moi qu'au page du XVIe siècle.
– Vous vous trompez, mon cousin, me dit naïvement la princesse ; car, à la fin du concert, en jetant par hasard les yeux du côté de la galerie, je vous ai reconnu tout de suite, malgré la différence du costume.
Puis, voulant changer sans doute un sujet de conversation qui l'embarrassait, elle me dit :
– Quel admirable talent que celui de M. Liszt, n'est-ce pas ?
– Admirable. Avec quel plaisir vous l'écoutiez !
– C'est qu'en effet il y a, ce me semble, un double charme dans la musique sans paroles : non-seulement on jouit d'une excellente exécution, mais on peut appliquer sa pensée du moment aux mélodies que l'on écoute, et qui en deviennent pour ainsi dire l'accompagnement… Je ne sais si vous me comprenez, mon cousin ?
– Parfaitement. Les pensées sont alors des paroles que l'on met mentalement sur l'air que l'on entend.
– C'est cela, c'est cela, vous me comprenez, dit-elle avec un mouvement de gracieuse satisfaction ; je craignais de mal expliquer ce que je ressentais tout à l'heure pendant cette mélodie si plaintive et si touchante.
– Grâce à Dieu, ma cousine, lui dis-je en souriant, vous n'avez aucune parole à mettre sur un air triste.
Soit que ma question fût indiscrète et qu'elle voulût éviter d'y répondre, soit qu'elle ne l'eût pas entendue, tout à coup la princesse Amélie me dit, en me montrant le grand-duc, qui, donnant le bras à l'archiduchesse Sophie, traversait alors la galerie où l'on dansait :
– Mon cousin, voyez donc mon père, comme il est beau !… Quel air noble et bon ! Comme tous les regards le suivent avec sollicitude ! Il me semble qu'on l'aime encore plus qu'on ne le révère…
– Ah ! m'écriai-je, ce n'est pas seulement ici, au milieu de sa cour, qu'il est chéri ! Si les bénédictions du peuple retentissaient dans la postérité, le nom de Rodolphe de Gerolstein serait justement immortel.
En parlant ainsi, mon exaltation était sincère ; car vous savez, mon ami, qu'on appelle, à bon droit, les États du prince le Paradis de l'Allemagne.
Il m'est impossible de vous peindre le regard reconnaissant que ma cousine jeta sur moi en m'entendant parler de la sorte.
– Apprécier ainsi mon père, me dit-elle avec émotion, c'est être bien digne de l'attachement qu'il vous porte.
– C'est que personne plus que moi ne l'aime et l'admire ! En outre des rares qualités qui font les grands princes, n'a-t-il pas le génie de la bonté, qui fait les princes adorés ?…
– Vous ne savez pas combien vous dites vrai !… s'écria la princesse encore plus émue.
– Oh ! je le sais, je le sais, et tous ceux qu'il gouverne le savent comme moi… On l'aime tant que l'on s'affligerait de ses chagrins comme on se réjouit de son bonheur ; l'empressement de tous à venir offrir leurs hommages à Mme la marquise d'Harville consacre à la fois et le choix de Son Altesse Royale et la valeur de la future grande-duchesse.
– Mme la marquise d'Harville est plus digne que qui que ce soit de l'attachement de mon père ; c'est le plus bel éloge que je puisse vous faire d'elle.
– Et vous pouvez sans doute l'apprécier justement : car vous l'avez probablement connue en France, ma cousine ?
À peine avais-je prononcé ces derniers mots, que je ne sais quelle soudaine pensée vint à l'esprit de la princesse Amélie ; elle baissa les yeux, et, pendant une seconde, ses traits prirent une expression de tristesse qui me rendit muet de surprise.
Nous étions alors à la fin de la contredanse, la dernière figure me sépara un instant de ma cousine ; lorsque je la reconduisis auprès de Mme d'Harville, il me sembla que ses traits étaient encore légèrement altérés…
Je crus et je crois encore que mon allusion au séjour de la princesse en France, lui ayant rappelé la mort de sa mère, lui causa l'impression pénible dont je viens de vous parler.
Pendant cette soirée, je remarquai une circonstance qui vous paraîtra puérile, mais qui m'a été une nouvelle preuve de l'intérêt que cette jeune fille inspire à tous. Son bandeau de perles s'étant un peu dérangé, l'archiduchesse Sophie, à qui elle donnait alors le bras, eut la bonté de vouloir lui replacer elle-même ce bijou sur le front. Or, pour qui connaît la hauteur proverbiale de l'archiduchesse, une telle prévenance de sa part semble à peine croyable. Du reste, la princesse Amélie, que j'observais attentivement à ce moment, parut à la fois si confuse, si reconnaissante, je dirais presque si embarrassée de cette gracieuse attention, que je crus voir briller une larme dans ses yeux.
Telle fut, mon ami, ma première soirée à Gerolstein. Si je vous l'ai racontée avec tant de détails, c'est que presque toutes ces circonstances ont eu plus tard pour moi leurs conséquences.
Maintenant, j'abrégerai ; je ne vous parlerai que de quelques faits principaux relatifs à mes fréquentes entrevues avec ma cousine et son père.
Le surlendemain de cette fête, je fus du très-petit nombre de personnes invitées à la célébration du mariage du grand-duc avec Mme la marquise d'Harville. Jamais je ne vis la physionomie de la princesse Amélie plus radieuse et plus sereine que pendant cette cérémonie. Elle contemplait son père et la marquise avec une sorte de religieux ravissement qui donnait un nouveau charme à ses traits ; on eût dit qu'ils reflétaient le bonheur ineffable du prince et de Mme d'Harville.
Ce jour-là, ma cousine fut très-gaie, très-causante. Je lui donnai le bras dans une promenade que l'on fit après dîner dans les jardins du palais, magnifiquement illuminés. Elle me dit, à propos du mariage de son père :
– Il me semble que le bonheur de ceux que nous chérissons nous est encore plus doux que notre propre bonheur ; car il y a toujours une nuance d'égoïsme dans la jouissance de notre félicité personnelle.
Si je vous cite entre mille cette réflexion de ma cousine, mon ami, c'est pour que vous jugiez du cœur de cette créature adorable, qui a, comme son père, le génie de la bonté.
Quelques jours après le mariage du grand-duc, j'eus avec lui une assez longue conversation ; il m'interrogea sur le passé, sur mes projets d'avenir ; il me donna les conseils les plus sages, les encouragements les plus flatteurs, me parla même de plusieurs de ses projets de gouvernement avec une confiance dont je fus aussi fier que flatté ; enfin, que vous dirai-je ? un moment, l'idée la plus folle me traversa l'esprit : je crus que le prince avait deviné mon amour, et que dans cet entretien il voulait m'étudier, me pressentir, et peut-être m'amener à un aveu…
Malheureusement, cet espoir insensé ne dura pas longtemps : le prince termina la conversation en me disant que le temps des grandes guerres était fini ; que je devais profiter de mon nom, de mes alliances, de l'éducation que j'avais reçue et de l'étroite amitié qui unissait mon père au prince de M. Premier ministre de l'empereur, pour parcourir la carrière diplomatique au lieu de la carrière militaire, ajoutant que toutes les questions qui se décidaient autrefois sur les champs de bataille se décideraient désormais dans les congrès ; que bientôt les traditions tortueuses et perfides de l'ancienne diplomatie feraient place à une politique large et humaine, en rapport avec les véritables intérêts des peuples, qui de jour en jour avaient davantage la conscience de leurs droits ; qu'un esprit élevé, loyal et généreux pourrait avoir avant quelques années un noble et grand rôle à jouer dans les affaires politiques, et faire ainsi beaucoup de bien. Il me proposait enfin le concours de sa souveraine protection pour me faciliter les abords de la carrière qu'il m'engageait instamment à parcourir.
Vous comprenez, mon ami, que si le prince avait eu le moindre projet sur moi, il ne m'eût pas fait de telles ouvertures. Je le remerciai de ses offres avec une vive reconnaissance, en ajoutant que je sentais tout le prix de ses conseils, et que j'étais décidé à les suivre.
J'avais d'abord mis la plus grande réserve dans mes visites au palais ; mais, grâce à l'insistance du grand-duc, j'y vins bientôt presque chaque jour vers les trois heures. On y vivait dans toute la charmante simplicité de nos cours germaniques. C'était la vie des grands châteaux d'Angleterre, rendue plus attrayante par la simplicité cordiale, la douce liberté des mœurs allemandes. Lorsque le temps le permettait, nous faisions de longues promenades à cheval avec le grand-duc, la grande-duchesse, ma cousine, et les personnes de leur maison. Lorsque nous restions au palais, nous nous occupions de musique, je chantais avec la grande-duchesse et ma cousine, dont la voix avait un timbre d'une pureté, d'une suavité sans égales, et que je n'ai jamais pu entendre sans me sentir remué jusqu'au fond de l'âme. D'autres fois, nous visitions en détail les merveilleuses collections de tableaux et d'objets d'art, ou les admirables bibliothèques du prince, qui, vous le savez, est un des hommes les plus savants et les plus éclairés de l'Europe ; assez souvent je revenais dîner au palais, et, les jours d'Opéra, j'accompagnais au théâtre la famille grand-ducale.
Chaque jour passait comme un songe ; peu à peu ma cousine me traita avec une familiarité toute fraternelle ; elle ne me cachait pas le plaisir qu'elle éprouvait à me voir, elle me confiait tout ce qui l'intéressait ; deux ou trois fois elle me pria de l'accompagner lorsqu'elle allait avec la grande-duchesse visiter ses jeunes orphelines ; souvent aussi elle me parlait de mon avenir avec une maturité de raison, avec un intérêt sérieux et réfléchi qui me confondait de la part d'une jeune fille de son âge ; elle aimait aussi beaucoup à s'informer de mon enfance, de ma mère, hélas ! toujours si regrettée. Chaque fois que j'écrivais à mon père, elle me priait de la rappeler à son souvenir ; puis, comme elle brodait à ravir, elle me remit un jour pour lui une charmante tapisserie à laquelle elle avait longtemps travaillé. Que vous dirai-je, mon ami ? un frère et une sœur, se retrouvant après de longues années de séparation, n'eussent pas joui d'une intimité plus douce. Du reste, lorsque, par le plus grand des hasards, nous restions seuls, l'arrivée d'un tiers ne pouvait jamais changer le sujet ou même l'accent de notre conversation.
Vous vous étonnerez peut-être, mon ami, de cette fraternité entre deux jeunes gens, surtout en songeant aux aveux que je vous fais ; mais plus ma cousine me témoignait de confiance et de familiarité, plus je m'observais, plus je me contraignais, de peur de voir cesser cette adorable familiarité. Et puis, ce qui augmentait encore ma réserve, c'est que la princesse mettait dans ses relations avec moi tant de franchise, tant de noble confiance, et surtout si peu de coquetterie, que je suis presque certain qu'elle a toujours ignoré ma violente passion. Il me reste un léger doute à ce sujet, à propos d'une circonstance que je vous raconterai tout à l'heure.
Si cette intimité fraternelle avait dû toujours durer, peut-être ce bonheur m'eût suffi ; mais par cela même que j'en jouissais avec délices, je songeais que bientôt mon service ou la carrière que le prince m'engageait à parcourir m'appellerait à Vienne ou à l'étranger ; je songeais enfin que prochainement peut-être le grand-duc penserait à marier sa fille d'une manière digne d'elle…
Ces pensées me devinrent d'autant plus pénibles que le moment de mon départ approchait. Ma cousine remarqua bientôt le changement qui s'était opéré en moi. La veille du jour où je la quittai, elle me dit que depuis quelque temps, elle me trouvait sombre, préoccupée. Je tâchai d'éluder ces questions, j'attribuai ma tristesse à un vague ennui.
– Je ne puis vous croire, me dit-elle ; mon père vous traite presque comme un fils, tout le monde vous aime ; vous trouver malheureux serait de l'ingratitude.
– Eh bien ! lui dis-je sans pouvoir vaincre mon émotion, ce n'est pas de l'ennui, c'est du chagrin, oui, c'est un profond chagrin que j'éprouve.
– Et pourquoi ? Que vous est-il arrivé ? me demanda-t-elle avec intérêt.
– Tout à l'heure, ma cousine, vous m'avez dit que votre père me traitait comme un fils… qu'ici tout le monde m'aimait… Eh bien ! avant peu il me faudra renoncer à ces affections si précieuses, il faudra enfin… quitter Gerolstein, et je vous l'avoue, cette pensée me désespère.
– Et le souvenir de ceux qui nous sont chers… n'est-ce donc rien, mon cousin ?
– Sans doute… mais les années, mais les événements amènent tant de changements imprévus !
– Il est du moins des affections qui ne sont pas changeantes : celle que mon père vous a toujours témoignée… celle que je ressens pour vous est de ce nombre, vous le savez bien ; on est frère et sœur… pour ne jamais s'oublier, ajouta-t-elle en levant sur moi ses grands yeux bleus humides de larmes.
Ce regard me bouleversa, je fus sur le point de me trahir ; heureusement je me contins.
– Il est vrai que les affections durent, lui dis-je avec embarras ; mais les positions changent… Ainsi, ma cousine, quand je reviendrai dans quelques années, croyez-vous qu'alors cette intimité, dont j'apprécie tout le charme, puisse encore durer ?
– Pourquoi ne durerait-elle pas ?
– C'est qu'alors vous serez sans doute mariée, ma cousine… vous aurez d'autres devoirs… et vous aurez oublié votre pauvre frère.
Je vous le jure, mon ami, je ne lui dis rien de plus ; j'ignore encore si elle vit dans ces mots un aveu qui l'offensa, ou si elle fut comme moi douloureusement frappée des changements inévitables que l'avenir devait nécessairement apporter à nos relations ; mais, au lieu de me répondre, elle resta un moment silencieuse, accablée ; puis, se levant brusquement, la figure pâle, altérée, elle sortit après avoir regardé pendant quelques secondes la tapisserie de la jeune comtesse d'Oppenheim, une de ses dames d'honneur, qui travaillait dans l'embrasure d'une des fenêtres du salon où avait lieu notre entretien.
Le soir même de ce jour, je reçus de mon père une nouvelle lettre qui me rappelait précipitamment ici. Le lendemain matin j'allai prendre congé du grand-duc ; il me dit que ma cousine était un peu souffrante, qu'il se chargerait de mes adieux pour elle ; il me serra paternellement dans ses bras, regrettant, ajouta-t-il, mon prompt départ, et surtout que ce départ fût causé par les inquiétudes que me donnait la santé de mon père ; puis, me rappelant avec la plus grande bonté ses conseils au sujet de la nouvelle carrière qu'il m'engageait très-instamment à embrasser, il ajouta qu'au retour de mes missions, ou pendant mes congés, il me reverrait toujours à Gerolstein avec un vif plaisir.
Heureusement, à mon arrivée ici, je trouvai l'état de mon père un peu amélioré ; il est encore alité, et toujours d'une grande faiblesse, mais il ne me donne plus d'inquiétude sérieuse. Malheureusement il s'est aperçu de mon abattement, de ma sombre taciturnité ; plusieurs fois, mais en vain, il m'a déjà supplié de lui confier la cause de mon morne chagrin. Je n'oserais, malgré son aveugle tendresse pour moi ; vous savez sa sévérité au sujet de tout ce qui lui paraît manquer de franchise et de loyauté.
Hier je le veillais ; seul auprès de lui, le croyant endormi, je n'avais pu retenir mes larmes, qui coulaient silencieusement en songeant à mes beaux jours de Gerolstein. Il me vit pleurer, car il sommeillait à peine, et j'étais complètement absorbé par ma douleur ; il m'interrogea avec la plus touchante bonté ; j'attribuai ma tristesse aux inquiétudes que m'avait données sa santé, mais, il ne fut pas dupe de cette défaite.
Maintenant que vous savez tout, mon bon Maximilien, dites, mon sort est-il assez désespéré ?… Que faire ?… Que résoudre ?…
Ah ! mon ami, je ne puis vous dire mon angoisse. Que va-t-il arriver, mon Dieu ?… Tout est à jamais perdu ! Je suis le plus malheureux des hommes, si mon père ne renonce pas à son projet.
Voici ce qui vient d'arriver :
Tout à l'heure, je terminais cette lettre, lorsqu'à mon grand étonnement, mon père, que je croyais couché, est entré dans son cabinet, où je vous écrivais ; il vit sur son bureau mes quatre premières grandes pages déjà remplies, j'étais à la fin de celle-ci.
– À qui écris-tu si longuement ? me demanda-t-il en souriant.
– À Maximilien, mon père.
– Oh ! me dit-il avec une expression d'affectueux reproche, je sais qu'il a toute ta confiance… Il est bien heureux, lui !
Il prononça ces derniers mots d'un ton si douloureusement navré que, touché de son accent, je lui répondis en lui donnant ma lettre presque sans réflexion :
– Lisez, mon père…
Mon ami, il a tout lu. Savez-vous ce qu'il m'a dit ensuite, après être resté quelque temps méditatif ?
– Henri, je vais écrire au grand-duc ce qui s'est passé pendant votre séjour à Gerolstein.
– Mon père, je vous en conjure, ne faites pas cela.
– Ce que vous racontez à Maximilien est-il scrupuleusement vrai ?
– Oui, mon père.
– En ce cas, jusqu'ici votre conduite a été loyale… Le prince l'appréciera. Mais il ne faut pas qu'à l'avenir vous vous montriez indigne de sa noble confiance, ce qui arriverait si, abusant de son offre, vous retourniez plus tard à Gerolstein dans l'intention peut-être de vous faire aimer de sa fille.
– Mon père… pouvez-vous penser… ?
– Je pense que vous aimez avec passion, et que la passion est tôt ou tard une mauvaise conseillère.
– Comment ! mon père, vous écrirez au prince que…
– Que vous aimez éperdument votre cousine.
– Au nom du ciel ! mon père, je vous en supplie, n'en faites rien !
– Aimez-vous votre cousine ?
– Je l'aime avec idolâtrie, mais…
Mon père m'interrompit.
– En ce cas, je vais écrire au grand-duc et lui demander pour vous la main de sa fille…
– Mais, mon père, une telle prétention est insensée de ma part !
– Il est vrai… Néanmoins je dois faire franchement cette demande au prince, en lui exposant les raisons qui m'imposent cette démarche. Il vous a accueilli avec la plus loyale hospitalité, il s'est montré pour vous d'une bonté paternelle, il serait indigne de moi et de vous de le tromper. Je connais l'élévation de son âme, il sera sensible à mon procédé d'honnête homme ; s'il refuse de vous donner sa fille, comme cela est presque indubitable, il saura du moins qu'à l'avenir, si vous retourniez à Gerolstein, vous ne devez plus vivre avec elle dans la même intimité. Vous m'avez, mon enfant, ajouta mon père avec bonté, librement montré la lettre que vous écriviez à Maximilien. Je suis maintenant instruit de tout ; il est de mon devoir d'écrire au grand-duc… et je vais lui écrire à l'instant même.
Vous le savez, mon ami, mon père est le meilleur des hommes, mais il est d'une inflexible ténacité de volonté lorsqu'il s'agit de ce qu'il regarde comme son devoir ; jugez de mes angoisses, de mes craintes. Quoique la démarche qu'il va tenter soit, après tout, franche et honorable, elle ne m'en inquiète pas moins. Comment le grand-duc accueillera-t-il cette folle demande ? N'en sera-t-il pas choqué, et la princesse Amélie ne sera-t-elle pas aussi blessée que j'aie laissé mon père prendre une résolution pareille sans son agrément ?
Ah ! mon ami, plaignez-moi, je ne sais que penser. Il me semble que je contemple un abîme et que le vertige me saisit…
Je termine à la hâte cette longue lettre ; bientôt je vous écrirai. Encore une fois, plaignez-moi, car en vérité je crains de devenir fou si la fièvre qui m'agite dure longtemps encore. Adieu, adieu, tout à vous de cœur et à toujours.
HENRI D'H. O.
Maintenant nous conduirons le lecteur au palais de Gerolstein, habité par Fleur-de-Marie depuis son retour de France.
IV. La princesse Amélie
L'appartement occupé par Fleur-de-Marie (nous ne l'appellerons la princesse Amélie qu'officiellement) dans le palais grand-ducal avait été meublé, par les soins de Rodolphe, avec un goût et une élégance extrêmes.
Du balcon de l'oratoire de la jeune fille on découvrait au loin les deux tours du couvent de Sainte-Hermangilde, qui, dominant d'immenses massifs de verdure, étaient elles-mêmes dominées par une haute montagne boisée, au pied de laquelle s'élevait l'abbaye. Par une belle matinée d'été, Fleur-de-Marie laissait errer ses regards sur ce splendide paysage qui s'étendait au loin. Coiffée en cheveux, elle portait une robe montante d'étoffe printanière blanche à petites raies bleues ; un large col de batiste très-simple, rabattu sur ses épaules, laissait voir les deux bouts et le nœud d'une petite cravate de soie du même bleu que la ceinture de sa robe.
Assise dans un grand fauteuil d'ébène sculpté, à haut dossier de velours cramoisi, le coude soutenu par un des bras de ce siège, la tête un peu baissée, elle appuyait sa joue sur le revers de sa petite main blanche, légèrement veinée d'azur.
L'attitude languissante de Fleur-de-Marie, sa pâleur, la fixité de son regard, l'amertume de son demi-sourire révélaient une mélancolie profonde.
Au bout de quelques moments, un soupir profond, douloureux, souleva son sein. Laissant alors retomber la main où elle appuyait sa joue, elle inclina davantage encore sa tête sur sa poitrine. On eût dit que l'infortunée se courbait sous le poids de quelque grand malheur.
À cet instant une femme d'un âge mûr, d'une physionomie grave et distinguée, vêtue avec une élégante simplicité, entra presque timidement dans l'oratoire et toussa légèrement pour attirer l'attention de Fleur-de-Marie.
Celle-ci, sortant de sa rêverie, releva vivement la tête et dit en saluant avec un mouvement plein de grâce :
– Que voulez-vous, ma chère comtesse ?
– Je viens prévenir Votre Altesse que monseigneur la prie de l'attendre ; car il va se rendre ici dans quelques minutes, répondit la dame d'honneur de la princesse Amélie avec une formalité respectueuse.
– Aussi je m'étonnais de n'avoir pas encore embrassé mon père aujourd'hui ; j'attends avec tant d'impatience sa visite de chaque matin !… Mais j'espère que je ne dois pas à une indisposition de Mlle d'Harneim le plaisir de vous voir deux jours de suite au palais, ma chère comtesse ?
– Que Votre Altesse n'ait aucune inquiétude à ce sujet ; Mlle d'Harneim m'a priée de la remplacer aujourd'hui ; demain elle aura l'honneur de reprendre son service auprès de Votre Altesse, qui daignera peut-être excuser ce changement.
– Certainement, car je n'y perdrai rien ; après avoir eu le plaisir de vous voir deux jours de suite, ma chère comtesse, j'aurai pendant deux autres jours Mlle d'Harneim auprès de moi.
– Votre Altesse nous comble, répondit la dame d'honneur en s'inclinant de nouveau ; son extrême bienveillance m'encourage à lui demander une grâce !
– Parlez… parlez ; vous connaissez mon empressement à vous être agréable…
– Il est vrai que depuis longtemps Votre Altesse m'a habituée à ses bontés ; mais il s'agit d'un sujet tellement pénible, que je n'aurais pas le courage de l'aborder, s'il ne s'agissait d'une action très-méritante ; aussi j'ose compter sur l'indulgence extrême de Votre Altesse.
– Vous n'avez nullement besoin de mon indulgence, ma chère comtesse ; je suis toujours très-reconnaissante des occasions que l'on me donne de faire un peu de bien.
– Il s'agit d'une pauvre créature qui malheureusement avait quitté Gerolstein avant que Votre Altesse eût fondé son œuvre si utile et si charitable pour les jeunes filles orphelines ou abandonnées, que rien ne défend contre les mauvaises passions.
– Et qu'a-t-elle fait ? Que réclamez-vous pour elle ?
– Son père, homme très-aventureux, avait été chercher fortune en Amérique, laissant sa femme et sa fille dans une existence assez précaire. La mère mourut ; la fille, âgée de seize ans à peine, livrée à elle-même, quitta le pays pour suivre à Vienne un séducteur, qui la délaissa bientôt. Ainsi que cela arrive toujours, ce premier pas dans le sentier du vice conduisit cette malheureuse à un abîme d'infamie ; en peu de temps elle devint, comme tant d'autres misérables, l'opprobre de son sexe…
Fleur-de-Marie baissa les yeux, rougit et ne put cacher un léger tressaillement qui n'échappa pas à sa dame d'honneur. Celle-ci, craignant d'avoir blessé la chaste susceptibilité de la princesse en l'entretenant d'une telle créature, reprit avec embarras :
– Je demande mille pardons à Votre Altesse, je l'ai choquée sans doute, en attirant son attention sur une existence si flétrie ; mais l'infortunée manifeste un repentir si sincère… que j'ai cru pouvoir solliciter pour elle un peu de pitié.
– Et vous avez eu raison. Continuez… je vous en prie, dit Fleur-de-Marie en surmontant sa douloureuse émotion ; tous les égarements sont en effet dignes de pitié, lorsque le repentir leur succède.
– C'est ce qui est arrivé dans cette circonstance, ainsi que je l'ai fait observer à Votre Altesse. Après deux années de cette vie abominable, la grâce toucha cette abandonnée… Saisie d'un tardif remords, elle est revenue ici. Le hasard a fait qu'en arrivant elle a été se loger dans une maison qui appartient à une digne veuve, dont la douceur et la pitié sont populaires. Encouragée par la pieuse bonté de la veuve, la pauvre créature lui a avoué ses fautes, ajoutant qu'elle ressentait une juste horreur pour sa vie passée, et qu'elle achèterait au prix de la pénitence la plus rude le bonheur d'entrer dans une maison religieuse où elle pourrait expier ses égarements et mériter leur rédemption. La digne veuve à qui elle fit cette confidence, sachant que j'avais l'honneur d'appartenir à Votre Altesse, m'a écrit pour me recommander cette malheureuse qui, par la toute-puissante intervention de Votre Altesse auprès de la princesse Juliane, supérieure de l'abbaye, pourrait espérer d'entrer sœur converse au couvent de Sainte-Hermangilde ; elle demande comme une faveur d'être employée aux travaux les plus pénibles, pour que sa pénitence soit plus méritoire. J'ai voulu entretenir plusieurs fois cette femme avant de me permettre d'implorer pour elle la pitié de Votre Altesse, et je suis fermement convaincue que son repentir sera durable. Ce n'est ni le besoin ni l'âge qui la ramène au bien ; elle a dix-huit ans à peine, elle est très-belle encore, et possède une petite somme d'argent qu'elle veut affecter à une œuvre charitable, si elle obtient la faveur qu'elle sollicite.
– Je me charge de votre protégée, dit Fleur-de-Marie en contenant difficilement son trouble, tant sa vie passée offrait de ressemblance avec celle de la malheureuse en faveur de qui on la sollicitait ; puis elle ajouta : Le repentir de cette infortunée est trop louable pour ne pas l'encourager.
– Je ne sais comment exprimer ma reconnaissance à Votre Altesse. J'osais à peine espérer qu'elle daignât s'intéresser si charitablement à une pareille créature…
– Elle a été coupable, elle se repent…, dit Fleur-de-Marie avec un accent de commisération et de tristesse indicible ; il est juste d'avoir pitié d'elle… Plus ses remords sont sincères, plus ils doivent être douloureux, ma chère comtesse…
– J'entends, je crois, monseigneur, dit tout à coup la dame d'honneur sans remarquer l'émotion profonde et croissante de Fleur-de-Marie.
En effet, Rodolphe entra dans un salon qui précédait l'oratoire, tenant à la main un énorme bouquet de roses.
À la vue du prince, la comtesse se retira discrètement. À peine eut-elle disparu que Fleur-de-Marie se jeta au cou de son père, appuya son front sur son épaule et resta ainsi quelques secondes sans parler.
– Bonjour… bonjour, mon enfant chérie, dit Rodolphe en serrant sa fille dans ses bras avec effusion sans s'apercevoir encore de sa tristesse. Vois donc ce buisson de roses… quelle belle moisson j'ai faite ce matin pour toi ! C'est ce qui m'a empêché de venir plus tôt. J'espère que je ne t'ai jamais apporté un plus magnifique bouquet… Tiens.
Et le prince, ayant toujours son bouquet à la main, fit un léger mouvement en arrière pour se dégager des bras de sa fille et la regarder ; mais, la voyant fondre en larmes, il jeta le bouquet sur une table, prit les mains de Fleur-de-Marie dans les siennes et s'écria :
– Tu pleures, mon Dieu ! qu'as-tu donc ?
– Rien… rien… mon bon père…, dit Fleur-de-Marie en essuyant ses larmes et tâchant de sourire à Rodolphe.
– Je t'en conjure, dis-moi ce que tu as… Qui peut t'avoir attristée ?
– Je vous assure, mon père, qu'il n'y a pas de quoi vous inquiéter… La comtesse était venue solliciter mon intérêt pour une pauvre femme si intéressante… si malheureuse… que malgré moi je me suis attendrie à son récit.
– Bien vrai ?… Ce n'est que cela…
– Ce n'est que cela, reprit Fleur-de-Marie en prenant sur une table les fleurs que Rodolphe avait jetées. Mais comme vous me gâtez ! ajouta-t-elle… quel bouquet magnifique ! Et quand je pense que chaque jour… vous m'en apportez un pareil… cueilli par vous…
– Mon enfant, dit Rodolphe en contemplant sa fille avec anxiété, tu me caches quelque chose… Ton sourire est douloureux, contraint. Je t'en conjure, dis-moi ce qui t'afflige… Ne t'occupe pas de ce bouquet.
– Oh ! vous le savez ce bouquet est ma joie de chaque matin, et puis j'aime tant les roses… Je les ai toujours tant aimées… Vous vous souvenez, ajouta-t-elle avec un sourire navrant, vous vous souvenez de mon pauvre petit rosier !… dont j'ai toujours gardé les débris…
À cette pénible allusion au temps passé, Rodolphe s'écria :
– Malheureuse enfant ! mes soupçons seraient-ils fondés ?… Au milieu de l'éclat qui t'environne, songerais-tu encore quelquefois à cet horrible temps ?… Hélas ! j'avais cru cependant te le faire oublier à force de tendresse !
– Pardon, pardon, mon père ! Ces paroles m'ont échappé. Je vous afflige…
– Je m'afflige, pauvre ange, dit tristement Rodolphe, parce que ces retours vers le passé doivent être affreux pour toi… parce qu'ils empoisonneraient ta vie si tu avais la faiblesse de t'y abandonner.
– Mon père… c'est par hasard… Depuis notre arrivée ici, c'est la première fois…
– C'est la première fois que tu m'en parles… oui… mais ce n'est peut-être pas la première fois que ces pensées te tourmentent… Je m'étais aperçu de tes accès de mélancolie, et quelquefois j'accusais le passé de causer ta tristesse… Mais, faute de certitude, je n'osais pas même essayer de combattre la funeste influence de ces ressouvenirs, de t'en montrer le néant, l'injustice ; car si ton chagrin avait eu une autre cause, si le passé avait été pour toi ce qu'il doit être, un vain et mauvais songe, je risquais d'éveiller en toi les idées pénibles que je voulais détruire…
– Combien vous êtes bon !… Combien ces craintes témoignent encore de votre ineffable tendresse !
– Que veux-tu… ma position était si difficile, si délicate… Encore une fois, je ne te disais rien, mais j'étais sans cesse préoccupé de ce qui te touchait… En contractant ce mariage qui comblait tous mes vœux, j'avais aussi cru donner une garantie de plus à ton repos. Je connaissais trop l'excessive délicatesse de ton cœur pour espérer que jamais… jamais tu ne songerais plus au passé ; mais je me disais que si par hasard ta pensée s'y arrêtait, tu devais, en te sentant maternellement chérie par la noble femme qui t'a connue et aimée au plus profond de ton malheur, tu devais, dis-je, regarder le passé comme suffisamment expié par tes atroces misères et être indulgente ou plutôt juste envers toi-même ; car enfin ma femme a droit par ses rares qualités aux respects de tous, n'est-ce pas ? Eh bien ! dès que tu es pour elle une fille, une sœur chérie, ne dois-tu pas être rassurée ? Son tendre attachement n'est-il pas une réhabilitation complète ? Ne te dit-il pas qu'elle sait comme toi que tu as été victime et non coupable, qu'on ne peut enfin te reprocher que le malheur… qui t'a accablée dès ta naissance ! Aurais-tu même commis de grandes fautes, ne seraient-elles pas mille fois expiées, rachetées par tout ce que tu as fait de bien, par tout ce qui s'est développé d'excellent et d'adorable en toi ?…
– Mon père…
– Oh ! je t'en prie, laisse-moi te dire ma pensée entière, puisqu'un hasard, qu'il faudra bénir sans doute, a amené cet entretien. Depuis longtemps je le désirais et je le redoutais à la fois… Dieu veuille qu'il ait un succès salutaire !… J'ai à te faire oublier tant d'affreux chagrins ; j'ai à remplir auprès de toi une mission si auguste, si sacrée, que j'aurais eu le courage de sacrifier à ton repos mon amour pour Mme d'Harville… mon amitié pour Murph, si j'avais pensé que leur présence t'eût trop douloureusement rappelé le passé.
– Oh ! mon bon père, pouvez-vous le croire ?… Leur présence, à eux, qui savent… ce que j'étais… et qui pourtant m'aiment tendrement, ne personnifie-t-elle pas au contraire l'oubli et le pardon ?… Enfin, mon père, ma vie entière n'eût-elle pas été désolée si pour moi vous aviez renoncé à votre mariage avec Mme d'Harville ?
– Oh ! je n'aurais pas été seul à vouloir ce sacrifice s'il avait dû assurer ton bonheur… Tu ne sais pas quel renoncement Clémence s'était déjà volontairement imposé ?… Car elle aussi comprend toute l'étendue de mes devoirs envers toi.
– Vos devoirs envers moi, mon Dieu ! Et qu'ai-je fait pour mériter autant ?
– Ce que tu as fait, pauvre ange aimé ?… Jusqu'au moment où tu m'as été rendue, ta vie n'a été qu'amertume, misère, désolation… et tes souffrances passées je me les reproche comme si je les avais causées ! Aussi, lorsque je te vois souriante, satisfaite, je me crois pardonné… Mon seul but, mon seul vœu est de te rendre aussi idéalement heureuse que tu as été infortunée, de t'élever autant que tu as été abaissée, car il me semble que les derniers vestiges du passé s'effacent lorsque les personnes les plus éminentes, les plus honorables, te rendent les respects qui te sont dus.
– À moi du respect ?… Non, non, mon père… mais à mon rang, ou plutôt à celui que vous m'avez donné.
– Oh ! ce n'est pas ton rang qu'on aime et qu'on révère… c'est toi, entends-tu bien, mon enfant chérie, c'est toi-même, c'est toi seule… Il est des hommages imposés par le rang, mais il en est aussi d'imposés par le charme et par l'attrait ! Tu ne sais pas distinguer ceux-là, toi, parce que tu t'ignores, parce que, par un prodige d'esprit et de tact qui me rend aussi fier qu'idolâtre de toi, tu apportes dans ces relations cérémonieuses, si nouvelles pour toi, un mélange de dignité, de modestie et de grâce, auquel ne peuvent résister les caractères les plus hautains…
– Vous m'aimez tant, mon père, et on vous aime tant, que l'on est sûr de vous plaire en me témoignant de la déférence.
– Oh ! la méchante enfant ! s'écria Rodolphe en interrompant sa fille et en l'embrassant avec tendresse. La méchante enfant, qui ne veut accorder aucune satisfaction à mon orgueil de père !
– Cet orgueil n'est-il pas aussi satisfait en vous attribuant à vous seul la bienveillance que l'on me témoigne, mon bon père ?
– Non, certainement, mademoiselle, dit le prince en souriant à sa fille pour chasser la tristesse dont il la voyait encore atteinte, non, mademoiselle, ce n'est pas la même chose ; car il ne m'est pas permis d'être fier de moi, et je puis et je dois être fier de vous… oui, fier. Encore une fois, tu ne sais pas combien tu es divinement douée… En quinze mois ton éducation s'est si merveilleusement accomplie que la mère la plus difficile serait enthousiaste de toi ; et cette éducation a encore augmenté l'influence presque irrésistible que tu exerces autour de toi sans t'en douter.
– Mon père… vos louanges me rendent confuse.
– Je dis la vérité, rien que la vérité. En veux-tu des exemples ? Parlons hardiment du passé : c'est un ennemi que je veux combattre corps à corps, il faut le regarder en face. Eh bien ! te souviens-tu de la Louve, de cette courageuse femme qui t'a sauvée ? Rappelle-toi cette scène de la prison que tu m'as racontée : une foule de détenues, plus stupides encore que méchantes, s'acharnaient à tourmenter une de leurs compagnes faible et infirme, leur souffre-douleur : tu parais, tu parles… et voilà qu'aussitôt ces furies, rougissant de leur lâche cruauté envers leur victime, se montrent aussi charitables qu'elles avaient été méchantes. N'est-ce donc rien, cela ? Enfin, est-ce, oui ou non, grâce à toi que la Louve, cette femme indomptable, a connu le repentir et désiré une vie honnête et laborieuse ? Va, crois-moi, mon enfant chérie, celle qui avait dominé la Louve et ses turbulentes compagnes par le seul ascendant de la bonté jointe à une rare élévation d'esprit, celle-là, quoique dans d'autres circonstances et dans une sphère tout opposée, devait par le même charme (n'allez pas sourire de ce rapprochement, mademoiselle) fasciner aussi l'altière archiduchesse Sophie et tout mon entourage ; car bons et méchants, grands et petits, subissent presque toujours l'influence des âmes supérieures… Je ne veux pas dire que tu sois née princesse dans l'acception aristocratique du mot, cela serait une pauvre flatterie à te faire, mon enfant… mais tu es de ce petit nombre d'êtres privilégiés qui sont nés pour dire à une reine ce qu'il faut pour la charmer et s'en faire aimer… et aussi pour dire à une pauvre créature, avilie et abandonnée, ce qu'il faut pour la rendre meilleure, la consoler et s'en faire adorer.
– Mon bon père… de grâce…
– Oh ! tant pis pour vous, mademoiselle, il y a trop longtemps que mon cœur déborde. Songe donc, avec mes craintes d'éveiller en toi les souvenirs de ce passé que je veux anéantir, que j'anéantirai à jamais dans ton esprit… je n'osais t'entretenir de ces comparaisons… de ces rapprochements qui te rendent si adorable à mes yeux. Que de fois Clémence et moi nous sommes-nous extasiés sur toi !… Que de fois, si attendrie que les larmes lui venaient aux yeux, elle m'a dit : « N'est-il pas merveilleux que cette chère enfant soit ce qu'elle est, après le malheur qui l'a poursuivie ? ou plutôt, reprenait Clémence, n'est-il pas merveilleux que, loin d'altérer cette noble et rare nature, l'infortune ait au contraire donné plus d'essor à ce qu'il y avait d'excellent en elle ?
À ce moment-là, la porte du salon s'ouvrit et Clémence, grande-duchesse de Gerolstein, entra, tenant une lettre à la main.
– Voici, mon ami, dit-elle à Rodolphe, une lettre de France. J'ai voulu vous l'apporter afin de dire bonjour à ma paresseuse enfant, que je n'ai pas encore vue ce matin, ajouta Clémence en embrassant tendrement Fleur-de-Marie.
– Cette lettre arrive à merveille, dit gaiement Rodolphe après l'avoir parcourue ; nous causions justement du passé… de ce monstre que nous allons incessamment combattre, ma chère Clémence… car il menace le repos et le bonheur de notre enfant.
– Serait-il vrai, mon ami ? Ces accès de mélancolie que nous avions remarqués…
– N'avaient pas d'autre cause que de méchants souvenirs ; mais heureusement nous connaissons maintenant notre ennemi… et nous en triompherons…
– Mais de qui donc est cette lettre, mon ami ? demanda Clémence.
– De la gentille Rigolette… la femme de Germain.
– Rigolette…, s'écria Fleur-de-Marie, quel bonheur d'avoir de ses nouvelles !
– Mon ami, dit tout bas Clémence à Rodolphe, en lui montrant Fleur-de-Marie du regard, ne craignez-vous pas que cette lettre… ne lui rappelle des idées pénibles ?
– Ce sont justement ces souvenirs que je veux anéantir, ma chère Clémence ; il faut les aborder hardiment, et je suis sûr que je trouverai dans la lettre de Rigolette d'excellentes armes contre eux… car cette bonne petite créature adorait notre enfant et l'appréciait comme elle devait l'être.
Et Rodolphe lut à haute voix la lettre suivante :
« Ferme de Bouqueval, 15 août 1841
« Monseigneur,
« Je prends la liberté de vous écrire encore pour vous faire part d'un bien grand bonheur qui nous est arrivé, et pour vous demander une nouvelle faveur, à vous à qui nous devons déjà tant, ou plutôt à qui nous devons le vrai paradis où nous vivons, moi, mon Germain et sa bonne mère.
« Voilà de quoi il s'agit, monseigneur : depuis dix jours je suis comme folle de joie, car il y a dix jours que j'ai un amour de petite fille ; moi je trouve que c'est tout le portrait de Germain ; lui, que c'est tout le mien ; notre chère maman Georges dit qu'elle nous ressemble à tous les deux ; le fait est qu'elle a de charmants yeux bleus comme Germain, et des cheveux noirs tout frisés comme moi. Par exemple, contre son habitude, mon mari est injuste, il veut toujours avoir notre petite sur ses genoux… tandis que moi, c'est mon droit, n'est-ce pas, monseigneur ?
– Braves et dignes jeunes gens ! Qu'ils doivent être heureux ! dit Rodolphe. Si jamais couple fut bien assorti… c'est celui-là.
– Et combien Rigolette mérite son bonheur ! dit Fleur-de-Marie.
– Aussi j'ai toujours béni le hasard qui me l'a fait rencontrer, dit Rodolphe ; et il continua :
« Mais, au fait, monseigneur, pardon de vous entretenir de ces gentilles querelles de ménage qui finissent toujours par un baiser… Du reste les oreilles doivent joliment vous tinter, monseigneur, car il ne se passe pas de jour que nous ne disions, en nous regardant nous deux Germain : « Sommes-nous heureux, mon Dieu ! sommes-nous heureux !… » et naturellement votre nom vient tout de suite après ces mots-là… Excusez ce griffonnage qu'il y a là, monseigneur, avec un pâté ; c'est que, sans y penser, j'avais écrit monsieur Rodolphe, comme je disais autrefois, et j'ai raturé. J'espère, à propos de cela, que vous trouverez que mon écriture a bien gagné, ainsi que mon orthographe ; car Germain me montre toujours, et je ne fais plus des grands bâtons en allant tout de travers, comme du temps où vous me tailliez mes plumes…
– Je dois avouer, dit Rodolphe, en riant, que ma petite protégée se fait un peu illusion, et je suis sûr que Germain s'occupe plutôt de baiser la main de son élève que de la diriger.
– Allons, mon ami, vous êtes injuste, dit Clémence en regardant la lettre ; c'est un peu gros, mais très-lisible.
– Le fait est qu'il y a progrès, reprit Rodolphe ; autrefois il lui aurait fallu huit pages pour contenir ce qu'elle écrit maintenant en deux.
Et il continua :
« C'est pourtant vrai que vous m'avez taillé des plumes, monseigneur ; quand nous y pensons, nous deux Germain, nous en sommes tout honteux, en nous rappelant que vous étiez si peu fiers… Ah ! mon Dieu ! voilà encore que je me surprends à vous parler d'autre chose que de ce que nous voulons vous demander, monseigneur ; car mon mari se joint à moi et c'est bien important ; nous y attachons une idée… vous allez voir.
« Nous vous supplions donc, monseigneur, d'avoir la bonté de nous choisir et de nous donner un nom pour notre petite fille chérie ; c'est convenu avec le parrain et la marraine, et ces parrain et marraine, savez-vous qui c'est, monseigneur ? Deux des personnes que vous et Mme la marquise d'Harville vous avez tirées de la peine pour les rendre bien heureuses, aussi heureuses que nous… En un mot, c'est Morel le lapidaire et Jeanne Duport, la sœur d'un pauvre prisonnier nommé Pique-Vinaigre, une digne femme que j'avais vue en prison quand j'allais y visiter mon pauvre Germain, et que plus tard Mme la marquise a fait sortir de l'hôpital.
« Maintenant, monseigneur, il faut que vous sachiez pourquoi nous avons choisi M. Morel pour parrain et Jeanne Duport pour marraine. Nous nous sommes dit, nous deux Germain : « Ça sera comme une manière de remercier encore M. Rodolphe de ses bontés que de prendre pour parrain et marraine de notre petite fille des dignes gens qui doivent tout à lui et à Mme la marquise… » sans compter que Morel le lapidaire et Jeanne Duport sont la crème des honnêtes gens… Ils sont de notre classe, et de plus, comme nous disons avec Germain, ils sont nos parents en bonheur, puisqu'ils sont comme nous de la famille de vos protégés, monseigneur.
– Ah ! mon père, ne trouvez-vous pas cette idée d'une délicatesse charmante ? dit Fleur-de-Marie avec émotion. Prendre pour parrain et marraine de leur enfant des personnes qui vous doivent tout, à vous et à ma seconde mère ?
– Vous avez raison, chère enfant, dit Clémence ; je suis on ne peut plus touchée de ce souvenir.
– Et moi je suis très-heureux d'avoir si bien placé mes bienfaits, dit Rodolphe en continuant sa lecture :
« Du reste, au moyen de l'argent que vous lui avez fait donner, monsieur Rodolphe, Morel est maintenant courtier en pierres fines ; il gagne de quoi bien élever sa famille et faire apprendre un état à ses enfants. La bonne et pauvre Louise va, je crois, se marier avec un digne ouvrier qui l'aime et la respecte comme elle doit l'être, car elle a été bien malheureuse, mais non coupable, et le fiancé de Louise a assez de cœur pour comprendre cela…
– J'étais bien sûr, s'écria Rodolphe en s'adressant à sa fille, de trouver dans la lettre de cette chère petite Rigolette des armes contre notre ennemi !… Tu entends, c'est l'expression du simple bon sens de cette âme honnête et droite… Elle dit de Louise : Elle a été malheureuse et non coupable, et son fiancé a assez de cœur pour comprendre cela.
Fleur-de-Marie, de plus en plus émue et attristée par la lecture de cette lettre, tressaillit du regard que son père attacha un moment sur elle en prononçant les derniers mots que nous avons soulignés.
Le prince continua :
« Je vous dirai encore, monseigneur, que Jeanne Duport, par la générosité de Mme la marquise, a pu se faire séparer de son mari, ce vilain homme qui lui mangeait tout et la battait ; elle a repris sa fille aînée auprès d'elle, et elle tient une petite boutique de passementerie où elle vend ce qu'elle fabrique avec ses enfants ; leur commerce prospère. Il n'y a pas non plus de gens plus heureux, et cela, grâce à qui ? grâce à vous, monseigneur, grâce à Mme la marquise, qui, tous deux, savez si bien donner, et donner si à propos.
« À propos de ça, Germain vous écrit comme d'ordinaire, monseigneur, à la fin du mois, au sujet de la Banque des travailleurs sans ouvrage et des prêts gratuits. Il n'y a presque jamais de remboursements en retard et on s'aperçoit déjà beaucoup du bien-être que cela répand dans le quartier. Au moins maintenant, de pauvres familles peuvent supporter la morte-saison du travail sans mettre leur linge et leurs matelas au mont-de-piété. Ainsi, quand l'ouvrage revient, faut voir avec quel cœur ils s'y mettent ; ils sont si fiers qu'on ait eu confiance dans leur travail et dans leur probité !… Dame ! ils n'ont que ça. Aussi comme ils vous bénissent de leur avoir fait prêter là-dessus ! Oui, monseigneur, ils vous bénissent, vous ; car, quoique vous disiez que vous n'êtes pour rien dans cette fondation, sauf la nomination de Germain comme caissier directeur, et que c'est un inconnu qui a fait ce grand bien… nous aimons mieux croire que c'est à vous qu'on le doit ; c'est plus naturel !
« D'ailleurs il y a une fameuse trompette pour répéter à tout bout de champ que c'est vous qu'on doit bénir ; cette trompette est Mme Pipelet, qui répète à chacun qu'il n'y a que son roi des locataires (excusez, monsieur Rodolphe, elle vous appelle toujours ainsi) qui puisse avoir fait cette œuvre charitable, et son vieux chéri d'Alfred est toujours de son avis. Quant à lui, il est si fier et si content de son poste de gardien de la banque qu'il dit que les poursuites de M. Cabrion lui seraient maintenant indifférentes. Pour en finir avec votre famille de reconnaissants, monseigneur, j'ajouterai que Germain a lu dans les journaux que le nommé Martial, un colon d'Algérie, avait été cité avec de grands éloges pour le courage qu'il avait montré en repoussant à la tête de ses métayers une attaque d'Arabes pillards, et que sa femme, aussi intrépide que lui, avait été légèrement blessée à ses côtés, où elle tirait des coups de fusil, comme un vrai grenadier. Depuis ce temps-là, dit-on dans le journal, on l'a baptisée Mme Carabine.
« Excusez de cette longue lettre, monseigneur ; mais j'ai pensé que vous ne seriez pas fâché d'avoir par nous des nouvelles de tous ceux dont vous avez été la providence… Je vous écris de la ferme de Bouqueval, où nous sommes depuis le printemps avec notre bonne mère. Germain part le matin pour ses affaires, et il revient le soir. À l'automne, nous retournerons habiter Paris. Comme c'est drôle, monsieur Rodolphe, moi qui n'aimais pas la campagne, je l'adore maintenant… Je m'explique ça, parce que Germain l'aime beaucoup. À propos de la ferme, monsieur Rodolphe, vous qui savez sans doute où est cette bonne petite Goualeuse, si vous en avez l'occasion, dites-lui qu'on se souvient toujours d'elle comme de ce qu'il y a de plus doux et de meilleur au monde, et que, pour moi, je ne pense jamais à notre bonheur sans me dire : « Puisque M. Rodolphe était aussi le M. Rodolphe de cette chère Fleur-de-Marie, grâce à lui elle doit être heureuse comme nous autres », et ça me fait trouver mon bonheur encore meilleur.
« Mon Dieu, mon Dieu, comme je bavarde ! Qu'est-ce que vous allez dire, monseigneur ? Mais bah ! vous êtes si bon… Et puis, voyez-vous, c'est votre faute si je gazouille autant et aussi joyeusement que papa Crétu et Ramonette, qui n'osent plus lutter maintenant de chant avec moi. Allez, monsieur Rodolphe, je vous en réponds, je les mets sur les dents.
« Vous ne nous refuserez pas notre demande, n'est-ce pas, monseigneur ? Si vous donnez un nom à notre petite fille chérie, il nous semble que ça lui portera bonheur, que ce sera comme sa bonne étoile. Tenez, monsieur Rodolphe, quelquefois, moi et mon bon Germain, nous nous félicitons presque d'avoir connu la peine, parce que nous sentons doublement combien notre enfant sera heureuse de ne pas savoir ce que c'est que la misère par où nous avons passé.
« Si je finis en vous disant, monsieur Rodolphe, que nous tâchons de secourir par-ci par-là de pauvres gens selon nos moyens, ce n'est pas pour nous vanter, mais pour que vous sachiez que nous ne gardons pas pour nous seuls tout le bonheur que vous nous avez donné. D'ailleurs nous disons toujours à ceux que nous secourons : « Ce n'est pas nous qu'il faut remercier et bénir… c'est M. Rodolphe, l'homme le meilleur, le plus généreux qu'il y ait au monde. » Et ils vous prennent pour une espèce de saint, si ce n'est plus.
« Adieu, monseigneur. Croyez que, lorsque notre petite fille commencera à épeler, le premier mot qu'elle lira sera votre nom, monsieur Rodolphe ; et puis après, ceux-ci, que vous avez fait écrire sur ma corbeille de noces :
Travail et sagesse – Honneur et bonheur.
« Grâce à ces quatre mots-là, à notre tendresse et à nos soins, nous espérons, monseigneur, que notre enfant sera toujours digne de prononcer le nom de celui qui a été notre providence et celle de tous les malheureux qu'il a connus.
« Pardon, monseigneur ; c'est que j'ai, en finissant, comme de grosses larmes dans les yeux… mais c'est de bonnes larmes… Excusez, s'il vous plaît… ce n'est pas ma faute, mais je n'y vois plus bien clair, et je griffonne…
« J'ai l'honneur, monseigneur, de vous saluer avec autant de respect que de reconnaissance.
« RIGOLETTE, femme GERMAIN.
« P. S. Ah ! mon Dieu ! monseigneur, en relisant ma lettre, je m'aperçois que j'ai mis bien des fois monsieur Rodolphe. Vous me pardonnerez, n'est-ce pas ? Vous savez bien que, sous un nom ou sous un autre, nous vous respectons et nous vous bénissons la même chose, monseigneur.
V. Les souvenirs
– Chère petite Rigolette ! dit Clémence attendrie par la lecture que venait de faire Rodolphe. Cette lettre naïve est remplie de sensibilité.
– Sans doute, reprit Rodolphe ; on ne pouvait mieux placer un bienfait. Notre protégée est douée d'un excellent naturel ; c'est un cœur d'or, et notre chère enfant l'apprécie comme nous, ajouta-t-il en s'adressant à sa fille.
Puis, frappé de sa pâleur et de son accablement, il s'écria :
– Mais qu'as-tu donc ?
– Hélas !… quel douloureux contraste entre ma position et celle de Rigolette… « Travail et sagesse. Honneur et bonheur », ces quatre mots disent tout ce qu'a été… tout ce que doit être sa vie… Jeune fille laborieuse et sage, épouse chérie, heureuse mère, femme honorée… telle est sa destinée ! tandis que moi…
– Grand dieu ! Que dis-tu ?
– Grâce… mon bon père ; ne m'accusez pas d'ingratitude… mais, malgré votre ineffable tendresse, malgré celle de ma seconde mère, malgré les respects et les splendeurs dont je suis entourée… malgré votre puissance souveraine, ma honte est incurable… Rien ne peut anéantir le passé… Encore une fois, pardonnez-moi, mon père… je vous l'ai caché jusqu'à présent… mais le souvenir de ma dégradation première me désespère et me tue…
– Clémence, vous l'entendez !… s'écria Rodolphe avec désespoir.
– Mais, malheureuse enfant ! dit Clémence en prenant affectueusement la main de Fleur-de-Marie dans les siennes, notre tendresse, l'affection de ceux qui vous entourent, et que vous méritez, tout ne vous prouve-t-il pas que ce passé ne doit plus être pour vous qu'un vain et mauvais songe ?
– Oh ! fatalité… fatalité ! reprit Rodolphe. Maintenant je maudis mes craintes, mon silence : cette funeste idée, depuis longtemps enracinée dans son esprit, y a fait à notre insu d'affreux ravages, et il est trop tard pour combattre cette déplorable erreur… Ah ! je suis bien malheureux !
– Courage, mon ami, dit Clémence à Rodolphe ; vous le disiez tout à l'heure, il vaut mieux connaître l'ennemi qui nous menace… Nous savons maintenant la cause du chagrin de notre enfant, nous en triompherons, parce que nous aurons pour nous la raison, la justice et notre tendresse.
– Et puis enfin parce qu'elle verra que son affliction, si elle était incurable, rendrait la nôtre incurable aussi, reprit Rodolphe ; car en vérité ce serait à désespérer de toute justice humaine et divine, si cette infortunée n'avait fait que changer de tourments.
Après un assez long silence, pendant lequel Fleur-de-Marie parut se recueillir, elle prit d'une main la main de Rodolphe, de l'autre celle de Clémence et leur dit d'une voix profondément altérée :
– Écoutez-moi, mon bon père… et vous aussi, ma tendre mère… ce jour est solennel… Dieu a voulu, et je l'en remercie, qu'il me fût impossible de vous cacher davantage ce que je ressens… Avant peu d'ailleurs je vous aurais fait l'aveu que vous allez entendre, car toute souffrance a son terme… et, si cachée que fût la mienne, je n'aurais pu vous la taire plus longtemps.
– Ah !… je comprends tout, s'écria Rodolphe ; il n'y a plus d'espoir pour elle.
– J'espère dans l'avenir, mon père, et cet espoir me donne la force de vous parler ainsi.
– Et que peux-tu espérer de l'avenir… pauvre enfant, puisque ton sort présent ne te cause que chagrins et amertume ?
– Je vais vous le dire, mon père… mais avant, permettez-moi de vous rappeler le passé… de vous avouer devant Dieu qui m'entend ce que j'ai ressenti jusqu'ici.
– Parle… parle, nous t'écoutons, dit Rodolphe, en s'asseyant avec Clémence auprès de Fleur-de-Marie.
– Tant que je suis restée à Paris… auprès de vous, mon père, dit Fleur-de-Marie, j'ai été si heureuse, oh ! si complètement heureuse, que ces beaux jours ne seraient pas trop payés par des années de souffrances… Vous le voyez… j'ai du moins connu le bonheur.
– Pendant quelques jours peut-être…
– Oui ; mais quelle félicité pure et sans mélange ! Vous m'entouriez, comme toujours, des soins les plus tendres ! Je me livrais sans crainte aux élans de reconnaissance et d'affection qui à chaque instant emportaient mon cœur vers vous… L'avenir m'éblouissait : un père à adorer, une seconde mère à chérir doublement, car elle devait remplacer la mienne… que je n'avais jamais connue… Et puis… je dois tout avouer, mon orgueil s'exaltait malgré moi, tant j'étais honorée de vous appartenir. Lorsque le petit nombre de personnes de votre maison qui, à Paris, avaient occasion de me parler, m'appelaient Altesse… je ne pouvais m'empêcher d'être fière de ce titre. Si alors je pensais quelquefois vaguement au passé, c'était pour me dire : « Moi, jadis, si avilie, je suis la fille chérie d'un prince souverain que chacun bénit et révère ; moi, jadis si misérable, je jouis de toutes les splendeurs du luxe et d'une existence presque royale ! » Hélas ! que voulez-vous, mon père, ma fortune était si imprévue… votre puissance m'entourait d'un si splendide éclat, que j'étais excusable, peut-être de me laisser aveugler ainsi.
– Excusable !… mais rien de plus naturel, pauvre ange aimé. Quel mal de t'enorgueillir d'un rang qui était le tien ? De jouir des avantages de la position que je t'avais rendue ? Aussi dans ce temps-là, je me le rappelle bien, tu étais d'une gaieté charmante ; que de fois je t'ai vue tomber dans mes bras comme accablée par la félicité, et me dire avec un accent enchanteur ces mots qu'hélas ! je ne dois plus entendre : « Mon père… c'est trop… trop de bonheur ! » Malheureusement ce sont ces souvenirs-là… vois-tu, qui m'ont endormi dans une sécurité trompeuse ; et plus tard je ne me suis pas assez inquiété des causes de ta mélancolie…
– Mais dites-nous donc, mon enfant, reprit Clémence, qui a pu changer en tristesse cette joie si pure, si légitime, que vous éprouviez d'abord ?
– Hélas ! une circonstance bien funeste et bien imprévue !…
– Quelle circonstance ?…
– Vous vous rappelez, mon père…, dit Fleur-de-Marie, ne pouvant vaincre un frémissement d'horreur, vous vous rappelez la scène terrible qui a précédé notre départ de Paris… lorsque votre voiture a été arrêtée près de la barrière ?
– Oui…, répondit tristement Rodolphe. Brave Chourineur !… Après m'avoir encore une fois sauvé la vie, il est mort là… devant nous… en disant : « Le ciel est juste… j'ai tué, on me tue !… »
– Eh bien !… mon père, au moment où ce malheureux expirait, savez-vous qui j'ai vu… me regarder fixement ?… Oh ! ce regard… ce regard… il m'a toujours poursuivie depuis, ajouta Fleur-de-Marie en frissonnant.
– Quel regard ? De qui parles-tu ? s'écria Rodolphe.
– De l'ogresse du tapis-franc…, murmura Fleur-de-Marie.
– Ce monstre ! tu l'as revu ? Et où cela ?
– Vous ne l'avez pas aperçue dans la taverne où est mort le Chourineur ? Elle se trouvait parmi les femmes qui l'entouraient.
– Ah ! maintenant, dit Rodolphe avec accablement, je comprends… Déjà frappée de terreur par le meurtre du Chourineur, tu auras cru voir quelque chose de providentiel dans cette affreuse rencontre ! ! !
– Il n'est que trop vrai, mon père ; à la vue de l'ogresse, je ressentis un froid mortel ; il me sembla que sous son regard mon cœur, jusqu'alors rayonnant de bonheur et d'espoir, se glaçait tout à coup. Oui, rencontrer cette femme au moment même où le Chourineur mourait en disant : « Le ciel est juste !… » cela me parut un blâme providentiel de mon orgueilleux oubli du passé, que je devais expier à force d'humiliation et de repentir.
– Mais le passé, on te l'a imposé ; tu n'en peux répondre devant Dieu !
– Vous avez été contrainte… enivrée… malheureuse enfant.
– Une fois précipitée malgré toi dans cet abîme, tu ne pouvais plus en sortir, malgré tes remords, ton épouvante et ton désespoir, grâce à l'atroce indifférence de cette société dont tu étais victime. Tu te voyais à jamais enchaînée dans cet antre ; il a fallu, pour t'en arracher, le hasard qui t'a placée sur mon chemin.
– Et puis enfin, mon enfant, votre père vous le dit, vous étiez victime et non complice de cette infamie ! s'écria Clémence.
– Mais cette infamie… je l'ai subie… ma mère, reprit douloureusement Fleur-de-Marie. Rien ne peut anéantir ces affreux souvenirs… Sans cesse ils me poursuivent, non plus comme autrefois au milieu des paisibles habitants d'une ferme, ou des femmes dégradées, mes compagnes de Saint-Lazare… mais ils me poursuivront jusque dans ce palais… peuplé de l'élite de l'Allemagne… Ils me poursuivent enfin jusque dans les bras de mon père, jusque sur les marches de son trône.
Et Fleur-de-Marie fondit en larmes.
Rodolphe et Clémence restèrent muets devant cette effrayante expression d'un remords invincible ; ils pleuraient aussi, car ils sentaient l'impuissance de leurs consolations.
– Depuis lors, reprit Fleur-de-Marie en essuyant ses larmes, à chaque instant du jour, je me dis avec une honte amère : « On m'honore, on me révère ; les personnes les plus éminentes, les plus vénérables, m'entourent de respects ; aux yeux de toute une cour, la sœur d'un empereur a daigné rattacher mon bandeau sur mon front… et j'ai vécu dans la fange de la Cité, tutoyée par des voleurs et des assassins ! »
« Oh ! mon père, pardonnez-moi ; mais plus ma position s'est élevée… plus j'ai été frappée de la dégradation profonde où j'étais tombée ; à chaque hommage qu'on me rend, je me sens coupable d'une profanation ; songez-y donc, mon Dieu ! après avoir été ce que j'ai été… souffrir que des vieillards s'inclinent devant moi… souffrir que de nobles jeunes filles, que des femmes justement respectées se trouvent flattées de m'entourer… souffrir enfin que des princesses, doublement augustes et par l'âge et par leur caractère sacerdotal, me comblent de prévenances et d'éloges… cela n'est-il pas impie et sacrilège ! Et puis, si vous saviez, mon père, ce que j'ai souffert, ce que je souffre encore chaque jour en me disant : « Si Dieu voulait que le passé fût connu… avec quel mépris mérité on traiterait celle qu'à cette heure on élève si haut !… » Quelle juste et effrayante punition !
– Mais, malheureuse enfant, ma femme et moi nous connaissons le passé… nous sommes dignes de notre rang, et pourtant nous te chérissons… nous t'adorons.
– Vous avez pour moi l'aveugle tendresse d'un père et d'une mère…
– Tout le bien que tu as fait depuis ton séjour ici ? Et cette institution belle et sainte, cet asile ouvert par toi aux orphelines et aux pauvres filles abandonnées, ces soins admirables d'intelligence et de dévouement dont tu les entoures ? Ton insistance à les appeler tes sœurs, à vouloir qu'elles t'appellent ainsi, puisque en effet tu les traites en sœurs ?… n'est-ce donc rien pour la rédemption de fautes qui ne furent pas les tiennes ?… Enfin l'affection que te témoigne la digne abbesse de Sainte-Hermangilde, qui ne te connaît que depuis ton arrivée ici, ne la dois-tu pas absolument à l'élévation de ton esprit, à la beauté de ton âme, à ta piété sincère ?
– Tant que les louanges de l'abbesse de Sainte-Hermangilde ne s'adressent qu'à ma conduite présente, j'en jouis sans scrupule, mon père ; mais lorsqu'elle cite mon exemple aux demoiselles nobles qui sont en religion dans l'abbaye, mais lorsque celles-ci voient en moi un modèle de toutes les vertus, je me sens mourir de confusion, comme si j'étais complice d'un mensonge indigne.
Après un assez long silence, Rodolphe reprit avec un abattement douloureux :
– Je le vois, il faut désespérer de te persuader : les raisonnements sont impuissants contre une conviction d'autant plus inébranlable qu'elle a sa source dans un sentiment généreux et élevé, puisque à chaque instant tu jettes un regard sur le passé. Le contraste de ces souvenirs et de ta position présente doit être en effet pour toi un supplice continuel… Pardon, à mon tour, pauvre enfant.
– Vous, mon bon père, me demander pardon !… Et de quoi, grand Dieu ?
– De n'avoir pas prévu tes susceptibilités… D'après l'excessive délicatesse de ton cœur, j'aurais dû les deviner… Et pourtant… que pouvais-je faire ?… Il était de mon devoir de te reconnaître solennellement pour ma fille… alors ces respects, dont l'hommage t'est si douloureux, venaient nécessairement t'entourer…
« Oui, mais j'ai eu un tort… j'ai été, vois-tu, trop orgueilleux de toi… j'ai trop voulu jouir du charme que ta beauté, que ton esprit, que ton caractère inspiraient à tous ceux qui t'approchaient… J'aurais dû cacher mon trésor… vivre presque dans la retraite avec Clémence et toi… renoncer à ces fêtes, à ces réceptions nombreuses où j'aimais tant à te voir briller… croyant follement t'élever si haut… si haut… que le passé disparaîtrait entièrement à tes yeux… Mais hélas ! le contraire est arrivé… et, comme tu me l'as dit, plus tu t'es élevée, plus l'abîme dont je t'ai retirée t'a paru sombre et profond…
« Encore une fois, c'est ma faute… j'avais pourtant cru bien faire !… dit Rodolphe en essuyant ses larmes, mais je me suis trompé… Et puis, je me suis cru pardonné trop tôt… la vengeance de Dieu n'est pas satisfaite… elle me poursuit encore dans le bonheur de ma fille !…
Quelques coups discrètement frappés à la porte du salon qui précédait l'oratoire de Fleur-de-Marie interrompirent ce triste entretien.
Rodolphe se leva et entr'ouvrit la porte.
Il vit Murph, qui lui dit :
– Je demande pardon à Votre Altesse Royale de venir la déranger ; mais un courrier du prince d'Herkaüsen-Oldenzaal vient d'apporter cette lettre qui, dit-il, est très-importante et doit être sur-le-champ remise à Votre Altesse Royale.
– Merci, mon bon Murph. Ne t'éloigne pas, lui dit Rodolphe avec un soupir ; tout à l'heure j'aurai besoin de causer avec toi.
Et le prince, ayant fermé la porte, resta un moment dans le salon pour y lire la lettre que Murph venait de lui remettre.
Elle était ainsi conçue :
« Monseigneur,
« Puis-je espérer que les liens de parenté qui m'attachent à Votre Altesse Royale et que l'amitié dont elle a toujours daigné m'honorer excuseront une démarche qui serait d'une grande témérité si elle ne m'était pas imposée par une conscience d'honnête homme ?
« Il y a quinze mois, monseigneur, vous reveniez de France, ramenant avec vous une fille d'autant plus chérie que vous l'aviez crue perdue pour toujours, tandis qu'au contraire elle n'avait jamais quitté sa mère, que vous avez épousée à Paris in extremis, afin de légitimer la naissance de la princesse Amélie, qui est ainsi l'égale des autres Altesses de la Confédération germanique.
« Sa naissance est donc souveraine, sa beauté incomparable, son cœur est aussi digne de sa naissance que son esprit est digne de sa beauté, ainsi que me l'a écrit ma sœur l'abbesse de Sainte-Hermangilde, qui a souvent l'honneur de voir la fille bien-aimée de Votre Altesse Royale.
« Maintenant, monseigneur, j'aborderai franchement le sujet de cette lettre, puisque malheureusement une maladie grave me retient à Oldenzaal, et m'empêche de se rendre auprès de Votre Altesse Royale.
« Pendant le temps que mon fils a passé à Gerolstein, il a vu presque chaque jour la princesse Amélie, il l'aime éperdument, mais il lui a toujours caché son amour.
« J'ai cru devoir, monseigneur, vous en instruire. Vous avez daigné accueillir paternellement mon fils et l'engager à revenir, au sein de votre famille, vivre de cette intimité qui lui était si précieuse ; j'aurais indignement manqué à la loyauté en dissimulant à Votre Altesse Royale une circonstance qui doit modifier l'accueil qui était réservé à mon fils.
« Je sais qu'il serait insensé à nous d'oser espérer nous allier plus étroitement encore à la famille de Votre Altesse Royale.
« Je sais que la fille dont vous êtes à bon droit si fier, monseigneur, doit prétendre à de hautes destinées.
« Mais je sais aussi que vous êtes le plus tendre des pères, et que, si vous jugiez jamais mon fils digne de vous appartenir et de faire le bonheur de la princesse Amélie, vous ne seriez pas arrêté par les graves disproportions qui rendent pour nous une telle fortune inespérée.
« Il ne m'appartient pas de faire l'éloge d'Henri, monseigneur ; mais j'en appelle aux encouragements et aux louanges que vous avez si souvent daigné lui accorder.
« Je n'ose et ne puis vous en dire davantage, monseigneur ; mon émotion est trop profonde.
« Quelle que soit votre détermination, veuillez croire que nous nous y soumettrons avec respect, et que je serai toujours fidèle aux sentiments profondément dévoués avec lesquels j'ai l'honneur d'être
« de Votre Altesse Royale
« le très-humble et obéissant serviteur,
« GUSTAVE-PAUL, « prince d'Herkaüsen-Oldenzaal
VI. Aveux
Après la lecture de la lettre du prince, père d'Henri, Rodolphe resta quelque temps triste et pensif ; puis, un rayon d'espoir éclairant son front, il revint auprès de sa fille, à qui Clémence prodiguait en vain les plus tendres consolations.
– Mon enfant, tu l'as dit toi-même, Dieu a voulu que ce jour fût celui des explications solennelles, dit Rodolphe à Fleur-de-Marie, je ne prévoyais pas qu'une nouvelle et grave circonstance dût encore justifier tes paroles.
– De quoi s'agit-il, mon père ?
– Mon ami, qu'y a-t-il ?
– De nouveaux sujets de crainte.
– Pour qui donc, mon père ?
– Pour toi.
– Pour moi ?
– Tu ne nous as avoué que la moitié de tes chagrins, pauvre enfant.
– Soyez assez bon pour vous expliquer, mon père, dit Fleur-de-Marie en rougissant.
– Maintenant je le puis, je n'ai pu le faire plus tôt, ignorant que tu désespérais à ce point de ton sort. Écoute, ma fille chérie, tu te crois, ou plutôt tu es bien malheureuse. Lorsqu'au commencement de notre entretien tu m'as parlé des espérances qui te restaient, j'ai compris… mon cœur a été brisé… car il s'agissait pour moi de te perdre à jamais, de te voir t'enfermer dans un cloître, de te voir descendre vivante dans un tombeau. Tu voudrais entrer au couvent…
– Mon père…
– Mon enfant, est-ce vrai ?
– Oui, si vous me le permettez, répondit Fleur-de-Marie d'une voix étouffée.
– Nous quitter ! s'écria Clémence.
– L'abbaye de Sainte-Hermangilde est bien rapprochée de Gerolstein : je vous verrai souvent, vous et mon père.
– Songez donc que de tels vœux sont éternels, ma chère enfant. Vous n'avez pas dix-huit ans, et peut-être un jour…
– Oh ! je ne me repentirai jamais de la résolution que je prends : je ne trouverai le repos et l'oubli que dans la solitude d'un cloître, si toutefois mon père, et vous, ma seconde mère, vous me continuez votre affection.
– Les devoirs, les consolations de la vie religieuse pourraient, en effet, dit Rodolphe, sinon guérir, du moins calmer les douleurs de ta pauvre âme abattue et déchirée. Et, quoiqu'il s'agisse de la moitié du bonheur de ma vie, il se peut que j'approuve ta résolution. Je sais ce que tu souffres, et je ne dis pas que le renoncement au monde ne doive pas être le terme fatalement logique de ta triste existence.
– Quoi ! vous aussi, Rodolphe ! s'écria Clémence.
– Permettez-moi, mon amie, d'exprimer toute ma pensée, reprit Rodolphe. Puis, s'adressant à sa fille : Mais avant de prendre cette détermination extrême, il faut examiner si un autre avenir ne serait pas plus selon tes vœux et selon les nôtres. Dans ce cas, aucun sacrifice ne me coûterait pour assurer ton avenir.
Fleur-de-Marie et Clémence firent un mouvement de surprise ; Rodolphe reprit en regardant fixement sa fille :
– Que penses-tu… de ton cousin le prince Henri ?
Fleur-de-Marie tressaillit et devint pourpre.
Après un moment d'hésitation elle se jeta dans les bras du prince en pleurant.
– Tu l'aimes, pauvre enfant !
– Vous ne me l'aviez jamais demandé, mon père ! répondit Fleur-de-Marie en essuyant ses yeux.
– Mon ami, nous ne nous étions pas trompés, dit Clémence.
– Ainsi, tu l'aimes…, ajouta Rodolphe en prenant les mains de sa fille dans les siennes ; tu l'aimes bien, mon enfant chérie ?
– Oh ! si vous saviez, reprit Fleur-de-Marie, ce qu'il m'en a coûté de vous cacher ce sentiment dès que je l'ai eu découvert dans mon cœur. Hélas ! à la moindre question de votre part, je vous aurais tout avoué… Mais la honte me retenait et m'aurait toujours retenue.
– Et crois-tu qu'Henri connaisse ton amour pour lui ? dit Rodolphe.
– Grand Dieu ! mon père, je ne le pense pas ! s'écria Fleur-de-Marie avec effroi.
– Et lui… crois-tu qu'il t'aime ?
– Non, mon père… non… Oh ! j'espère que non… il souffrirait trop.
– Et comment cet amour est-il venu, mon ange aimé ?
– Hélas ! presque à mon insu… Vous vous souvenez d'un portrait de page ?
– Qui se trouve dans l'appartement de l'abbesse de Sainte-Hermangilde… c'était le portrait d'Henri.
– Oui, mon père… Croyant cette peinture d'une autre époque, un jour, en votre présence, je ne cachai pas à la supérieure que j'étais frappée de la beauté de ce portrait. Vous me dîtes alors, en plaisantant, que ce tableau représentait un de nos parents d'autrefois, qui, très-jeune encore, avait montré un grand courage et d'excellentes qualités. La grâce de cette figure, jointe à ce que vous me dîtes du noble caractère de ce parent, ajouta encore à ma première impression… Depuis ce jour, souvent je m'étais plu à me rappeler ce portrait, et cela sans le moindre scrupule, croyant qu'il s'agissait d'un de nos cousins mort depuis longtemps… Peu à peu, je m'habituai à ces douces pensées… sachant qu'il ne m'était pas permis d'aimer sur cette terre…, ajouta Fleur-de-Marie avec une expression navrante, et en laissant de nouveau couler ses larmes. Je me fis de ces rêveries bizarres une sorte de mélancolique intérêt, moitié sourire et moitié larmes ; je regardai ce joli page des temps passés comme un fiancé d'outre-tombe… que je retrouverais peut-être un jour dans l'éternité ; il me semblait qu'un tel amour était seul digne d'un cœur qui vous appartenait tout entier, mon père… Mais pardonnez-moi ces tristes enfantillages.
– Rien de plus touchant, au contraire, pauvre enfant ! dit Clémence profondément émue.
– Maintenant, reprit Rodolphe, je comprends pourquoi tu m'as reproché un jour, d'un air chagrin, de t'avoir trompée sur ce portrait.
– Hélas ! oui, mon père… Jugez de ma confusion, lorsque plus tard la supérieure m'apprit que ce portrait était celui de son neveu, l'un de nos parents… Alors, mon trouble fut extrême, je tâchai d'oublier mes premières impressions, mais, plus j'y tâchais, plus elles s'enracinaient dans mon cœur, par suite même de la persévérance de mes efforts… Malheureusement encore, souvent je vous entendis, mon père, vanter le cœur, l'esprit, le caractère du prince Henri…
– Tu l'aimais déjà, mon enfant chérie, alors que tu n'avais encore vu que son portrait et entendu parler que de ses rares qualités.
– Sans l'aimer, mon père, je sentais pour lui un attrait que je me reprochais amèrement ; mais je me consolais en pensant que personne au monde ne saurait ce triste secret, qui me couvrait de honte à mes propres yeux. Oser aimer… moi… moi… et puis ne pas me contenter de votre tendresse, de celle de ma seconde mère ! Ne vous devais-je pas assez pour employer toutes les forces, toutes les ressources de mon cœur à vous chérir tous deux ?… Oh ! croyez-moi, parmi mes reproches, ces derniers furent les plus douloureux. Enfin, pour la première fois je vis mon cousin… à cette grande fête que vous donniez à l'archiduchesse Sophie ; le prince Henri ressemblait d'une manière si saisissante à son portrait que je le reconnus tout d'abord… Le soir même, mon père, vous m'avez présenté à mon cousin, en autorisant entre nous l'intimité que permet la parenté.
– Eh bientôt vous vous êtes aimés ?
– Ah ! mon père, il exprimait son respect, son attachement, son admiration pour vous avec tant d'éloquence… vous m'aviez dit vous-même tant de bien de lui !…
– Il le méritait… Il n'est pas de caractère plus élevé, il n'est pas de meilleur et de plus valeureux cœur.
– Ah ! de grâce, mon père… ne le louez pas ainsi… Je suis déjà si malheureuse !…
– Et moi, je tiens à te bien convaincre de toutes les rares qualités de ton cousin… Ce que je te dis t'étonne… Je le conçois, mon enfant… Continue…
– Je sentais le danger que je courais en voyant le prince Henri chaque jour, et je ne pouvais me soustraire à ce danger. Malgré mon aveugle confiance en vous, mon père, je n'osais vous exprimer mes craintes. Je mis tout mon courage à cacher cet amour ; pourtant, je vous l'avoue, mon père, malgré mes remords, souvent, dans cette fraternelle intimité de chaque jour, oubliant le passé, j'éprouvai des éclairs de bonheur inconnu jusqu'alors, mais bientôt suivis, hélas ! de sombres désespoirs, dès que je retombais sous l'influence de mes tristes souvenirs… Car, hélas ! s'ils me poursuivaient au milieu des hommages et des respects de personnes presque indifférentes, jugez, jugez… mon père, de mes tortures, lorsque le prince Henri me prodiguait les louanges les plus délicates… m'entourait d'une adoration candide et pieuse, mettant, disait-il, l'attachement fraternel qu'il ressentait pour moi sous la sainte protection de sa mère, qu'il avait perdue bien jeune. Du moins, ce doux nom de sœur qu'il me donnait, je tâchais de le mériter, en conseillant mon cousin sur son avenir, selon mes faibles lumières, en m'intéressant à tout ce qui le touchait, en me promettant de toujours vous demander pour lui votre bienveillant appui… Mais souvent, aussi, que de tourments, que de pleurs dévorés, lorsque par hasard le prince Henri m'interrogeait sur mon enfance, sur ma première jeunesse… Oh ! tromper… toujours tromper… toujours craindre… toujours mentir, toujours trembler devant le regard de celui qu'on aime et qu'on respecte, comme le criminel tremble devant le regard inexorable de son juge !… Oh ! mon père ! j'étais coupable, je le sais, je n'avais pas le droit d'aimer ; mais j'expiais ce triste amour par bien des douleurs… Que vous dirai-je ? Le départ du prince Henri, en me causant un nouveau et violent chagrin, m'a éclairée… J'ai vu que je l'aimais plus encore que je ne croyais… Aussi, ajouta Fleur-de-Marie avec accablement, et comme si cette confession eût épuisé ses forces, bientôt je vous aurais fait cet aveu, car ce fatal amour a comblé la mesure de ce que je souffre… Dites, maintenant que vous savez tout, dites, mon père, est-il pour moi un autre avenir que celui du cloître ?
– Il en est un autre, mon enfant… oui… et cet avenir est aussi doux et aussi riant, aussi heureux que celui du couvent est morne et sinistre !
– Que dites-vous, mon père ?
– Écoute-moi à mon tour… Tu sens bien que je t'aime trop, que ma tendresse est trop clairvoyante pour que ton amour et celui d'Henri m'aient échappé ; au bout de quelques jours, je fus certain qu'il t'aimait, plus encore peut-être que tu ne l'aimes…
– Mon père… non… non… c'est impossible, il ne m'aime pas à ce point.
– Il t'aime, te dis-je… Il t'aime avec passion, avec délire.
– Ô mon Dieu ! Mon Dieu !
– Écoute encore… lorsque je t'ai fait cette plaisanterie du portrait, j'ignorais qu'Henri dût venir bientôt voir sa tante à Gerolstein. Lorsqu'il y vint, je cédai au penchant qu'il m'a toujours inspiré ; je l'invitai à nous voir souvent… Jusqu'alors, je l'avais traité comme mon fils, je ne changeai rien à ma manière d'être envers lui… Au bout de quelques jours, Clémence et moi nous ne pûmes douter de l'attrait que vous éprouviez l'un pour l'autre… Si ta position était plus douloureuse, ma pauvre enfant, la mienne aussi était pénible, et surtout d'une délicatesse extrême… Comme père, sachant les rares et excellentes qualités d'Henri, je ne pouvais qu'être profondément heureux de votre attachement, car jamais je n'aurais pu rêver un époux plus digne de toi.
– Ah ! mon père… pitié ! pitié !
– Mais, comme homme d'honneur, je songeais au triste passé de mon enfant… Aussi, loin d'encourager les espérances d'Henri, dans plusieurs entretiens je lui donnai des conseils absolument contraires à ceux qu'il aurait dû attendre de moi si j'avais songé à lui accorder ta main. Dans des conjonctures si délicates, comme père et comme homme d'honneur, je devais garder une neutralité rigoureuse, ne pas encourager l'amour de ton cousin, mais le traiter avec la même affabilité que par le passé… Tu as été jusqu'ici si malheureuse, mon enfant chérie, que, te voyant pour ainsi dire te ranimer sous l'influence de ce noble et pur amour, pour rien au monde je n'aurais voulu te ravir ces joies divines et rares. En admettant même que cet amour dût être brisé plus tard… tu aurais au moins connu quelques jours d'innocent bonheur… Et puis, enfin… cet amour pouvait assurer ton repos à venir…
– Mon repos ?
– Écoute encore… Le père d'Henri, le prince Paul, vient de m'écrire ; voici sa lettre… Quoiqu'il regarde cette alliance comme une faveur inespérée… il me demande ta main pour son fils, qui, me dit-il, éprouve pour toi l'amour le plus respectueux et le plus passionné.
– Ô mon Dieu ! Mon Dieu ! dit Fleur-de-Marie, en cachant son visage dans ses mains, j'aurais pu être si heureuse !
– Courage, ma fille bien-aimée ! Si tu le veux, ce bonheur est à toi ! s'écria tendrement Rodolphe.
– Oh ! jamais !… Jamais !… Oubliez-vous ?…
– Je n'oublie rien… Mais que demain tu entres au couvent, non-seulement je te perds à jamais… mais tu me quittes pour une vie de larmes et d'austérités… Eh bien ! te perdre pour te perdre… qu'au moins je te sache heureuse et mariée à celui que tu aimes… et qui t'adore.
– Mariée avec lui… moi, mon père !…
– Oui… mais à la condition que, sitôt après votre mariage, contracté ici la nuit, sans d'autres témoins que Murph pour toi et que le baron de Graün pour Henri, vous partirez tous deux pour aller dans quelque tranquille retraite de Suisse ou d'Italie, vivre inconnus, en riches bourgeois. Maintenant, ma fille chérie, sais-tu pourquoi je me résigne à t'éloigner de moi ? Sais-tu pourquoi je désire qu'Henri quitte son titre une fois hors de l'Allemagne ? C'est que je suis sûr qu'au milieu d'un bonheur solitaire, concentrée dans une existence dépouillée de tout faste, peu à peu tu oublieras cet odieux passé, qui t'est surtout pénible parce qu'il contraste amèrement avec les cérémonieux hommages dont à chaque instant tu es entourée.
– Rodolphe a raison, s'écria Clémence. Seule avec Henri, continuellement heureuse de son bonheur et du vôtre, il ne vous restera pas le temps de songer à vos chagrins d'autrefois, mon enfant.
– Puis, comme il me serait impossible d'être longtemps sans te voir, chaque année Clémence et moi nous irons vous visiter.
– Et un jour… lorsque la plaie dont vous souffrez tant, pauvre petite, sera cicatrisée… lorsque vous aurez trouvé l'oubli dans le bonheur… et ce moment arrivera plus tôt que vous ne le pensez… vous reviendrez près de nous pour ne plus nous quitter !
– L'oubli dans le bonheur !… murmura Fleur-de-Marie qui, malgré elle, se laissait bercer par ce songe enchanteur.
– Oui… oui, mon enfant, reprit Clémence, lorsqu'à chaque instant du jour vous vous verrez bénie, respectée, adorée par l'époux de votre choix, par l'homme dont votre père vous a mille fois vanté le cœur noble et généreux… aurez-vous le loisir de songer au passé ? Et, lors même que vous y songeriez… comment ce passé vous attristerait-il ? Comment vous empêcherait-il de croire à la radieuse félicité de votre mari ?
– Enfin c'est vrai… car dis-moi, mon enfant, reprit Rodolphe, qui pouvait à peine contenir des larmes de joie en voyant sa fille ébranlée, en présence de l'idolâtrie de ton mari pour toi… lorsque tu auras la conscience et la preuve du bonheur qu'il te doit… quels reproches pourras-tu te faire ?
– Mon père…, dit Fleur-de-Marie, oubliant le passé pour cette espérance ineffable, tant de bonheur me serait-il encore réservé ?
– Ah ! j'en étais bien sûr ! s'écria Rodolphe dans un élan de joie triomphante, est-ce qu'après tout un père qui le veut… ne peut pas rendre au bonheur son enfant adorée ?…
– Elle mérite tant… que nous devions être exaucés, mon ami, dit Clémence en partageant le ravissement du prince.
– Épouser Henri… et un jour… passer ma vie entre lui… ma seconde mère… et mon père…, répéta Fleur-de-Marie, subissant de plus en plus la douce ivresse de ces pensées.
– Oui, mon ange aimé, nous serons tous heureux !… Je vais répondre au père d'Henri que je consens au mariage, s'écria Rodolphe en serrant Fleur-de-Marie dans ses bras avec une émotion indicible. Rassure-toi, notre séparation sera passagère… les nouveaux devoirs que le mariage va t'imposer raffermiront encore tes pas dans cette voie d'oubli et de félicité où tu vas marcher désormais… car, enfin, si un jour tu es mère, ce ne sera pas seulement pour toi qu'il te faudra être heureuse…
– Ah ! s'écria Fleur-de-Marie avec un cri déchirant, car ce mot de mère la réveilla du songe enchanteur qui la berçait, mère !… moi ? Oh ! jamais ! Je suis indigne de ce saint nom… Je mourrais de honte devant mon enfant… si je n'étais pas morte de honte devant son père… en lui faisant l'aveu du passé…
– Que dit-elle ? mon Dieu ! s'écria Rodolphe, foudroyé par ce brusque changement…
– Moi mère ! reprit Fleur-de-Marie avec une amertume désespérée, moi respectée, moi bénie par un enfant innocent et candide ! Moi autrefois l'objet du mépris de tous ! Moi profaner ainsi le nom sacré de mère… oh ! jamais… Misérable folle que j'étais de me laisser entraîner à un espoir indigne !…
– Ma fille, par pitié, écoute-moi.
Fleur-de-Marie se leva droite, pâle, et belle de la majesté d'un malheur incurable.
– Mon père… nous oublions qu'avant de m'épouser… le prince Henri doit connaître ma vie passée.
– Je ne l'avais pas oublié, s'écria Rodolphe ; il doit tout savoir… il saura tout…
– Et vous ne voulez pas que je meure… de me voir ainsi dégradée à ses yeux ?
– Mais il saura aussi quelle irrésistible fatalité t'a jetée dans l'abîme… mais il saura ta réhabilitation.
– Et il sentira enfin, reprit Clémence en serrant Fleur-de-Marie dans ses bras, que lorsque je vous appelle ma fille… il peut sans honte vous appeler sa femme…
– Et moi… ma mère… j'aime trop… j'estime trop le prince Henri pour jamais lui donner une main qui a été touchée par les bandits de la Cité…
Peu de temps après cette scène douloureuse, on lisait dans la Gazette officielle de Gerolstein :
« Hier a eu lieu, en l'abbaye grand-ducale de Sainte-Hermangilde, en présence de Son Altesse Royale le grand-duc régnant et de toute la cour, la prise de voile de très-haute et très-puissante princesse Son Altesse Amélie de Gerolstein.
« Le noviciat a été reçu par l'illustrissime et révérendissime seigneur monseigneur Charles-Maxime, archevêque duc d'Oppenheim ; monseigneur Annibal-André Montano, des princes de Delphes, évêque de Ceuta in partibus infidelium et nonce apostolique, y a donné le salut et la bénédiction papale.
« Le sermon a été prononcé par le révérendissime seigneur Pierre d'Asfeld, chanoine du chapitre de Cologne, comte du Saint-Empire romain.
« VENI, CREATOR OPTIME. »
VII. La profession
RODOLPHE À CLÉMENCE
Gerolstein, 12 janvier 1842[5]
En me rassurant complètement aujourd'hui sur la santé de votre père, mon amie, vous me faites espérer que vous pourrez, avant la fin de cette semaine, le ramener ici. Je l'avais prévenu que dans la résidence de Rosenfeld, située au milieu des forêts, il serait exposé, malgré toutes les précautions possibles, à l'âpre rigueur de nos froids ; malheureusement sa passion pour la chasse a rendu nos conseils inutiles. Je vous en conjure, Clémence, dès que votre père pourra supporter le mouvement de la voiture, partez aussitôt ; quittez ce pays sauvage et cette sauvage demeure, seulement habitable pour ces vieux Germains au corps de fer dont la race a disparu.
Je tremble qu'à votre tour vous ne tombiez malade ; les fatigues de ce voyage précipité, les inquiétudes auxquelles vous avez été en proie jusqu'à votre arrivée auprès de votre père, toutes ces causes ont dû réagir cruellement sur vous. Que n'ai-je pu vous accompagner !…
Clémence, je vous en supplie, pas d'imprudence ; je sais combien vous êtes vaillante et dévouée… je sais de quels soins empressés vous allez entourer votre père ; mais il serait aussi désespéré que moi si votre santé s'altérait pendant ce voyage. Je déplore doublement la maladie du comte, car elle vous éloigne de moi dans un moment où j'aurais puisé bien des consolations dans votre tendresse…
La cérémonie de la profession de notre pauvre enfant est toujours fixée à demain… à demain 13 janvier, époque fatale… C'est le TREIZE JANVIER que j'ai tiré l'épée contre mon père…
Ah ! mon amie… je m'étais cru pardonné trop tôt… L'enivrant espoir de passer ma vie auprès de vous et de ma fille m'avait fait oublier que ce n'était pas moi, mais elle, qui avait été punie jusqu'à présent, et que mon châtiment était encore à venir.
Et il est venu… lorsqu'il y a six mois l'infortunée nous a dévoilé la double torture de son cœur : sa honte incurable du passé… jointe à son malheureux amour pour Henri…
Ces deux amers et brûlants ressentiments exaltés l'un par l'autre, devaient, par une logique fatale, amener son inébranlable résolution de prendre le voile. Vous le savez, mon amie, en combattant ce dessein de toutes les forces de notre adoration pour elle, nous ne pouvions nous dissimuler que sa digne et courageuse conduite eût été la nôtre. Que répondre à ces mots terribles : « J'aime trop le prince Henri pour lui donner une main touchée par les bandits de la Cité » ?
Elle a dû se sacrifier à ses nobles scrupules, au souvenir ineffaçable de sa honte ! Elle l'a fait vaillamment… Elle a renoncé aux splendeurs du monde, elle est descendue des marches d'un trône pour s'agenouiller, vêtue de bure, sur la dalle d'une église ; elle a croisé ses mains sur sa poitrine, courbé sa tête angélique… ses beaux cheveux blonds que j'aimais tant, et que je conserve comme un trésor, sont tombés tranchés par le fer…
Ô mon amie, vous savez notre émotion déchirante à ce moment lugubre et solennel ; cette émotion est, à cette heure, aussi poignante que par le passé… En vous écrivant ces mots, je pleure comme un enfant.
Je l'ai vue ce matin ; quoiqu'elle m'ait paru moins pâle que d'habitude, et qu'elle prétende ne pas souffrir… sa santé m'inquiète, mortellement. Hélas ! lorsque, sous le voile et le bandeau qui entourent son noble front, je vois ses traits amaigris qui ont la froide blancheur du marbre, et qui font paraître ses grands yeux bleus plus grands encore, je ne puis m'empêcher de songer au doux et pur éclat dont brillait sa beauté lors de notre mariage. Jamais, n'est-ce pas ? nous ne l'avions vue plus charmante… notre bonheur semblait rayonner sur son délicieux visage.
Comme je vous le disais, je l'ai vue ce matin ; elle n'est pas prévenue que la princesse Juliane se démet volontairement en sa faveur de sa dignité abbatiale : demain donc, jour de sa profession, notre enfant sera élue abbesse, puisqu'il y a unanimité parmi les demoiselles nobles de la communauté pour lui conférer cette dignité[6].
Depuis le commencement de son noviciat, il n'y a qu'une voix sur sa piété, sur sa charité, sur sa religieuse exactitude à remplir toutes les règles de son ordre, dont elle exagère malheureusement les austérités… Elle a exercé dans ce couvent l'influence qu'elle exerce partout, sans y prétendre et en l'ignorant, ce qui en augmente la puissance…
Son entretien de ce matin m'a confirmé ce dont je me doutais ; elle n'a pas trouvé dans la solitude du cloître et dans la pratique sévère de la vie monastique le repos et l'oubli… elle se félicite pourtant de sa résolution, qu'elle considère comme l'accomplissement d'un devoir impérieux ; mais elle souffre toujours, car elle n'est pas née pour ces contemplations mystiques, au milieu desquelles certaines personnes, oubliant toutes les affections, tous les souvenirs terrestres, se perdent en ravissements ascétiques.
Non, Fleur-de-Marie croit, elle prie, elle se soumet à la rigoureuse et dure observance de son ordre ; elle prodigue les consolations les plus évangéliques, les soins les plus humbles aux pauvres femmes malades qui sont traitées dans l'hospice de l'abbaye. Elle a refusé jusqu'à l'aide d'une sœur converse pour le modeste ménage de cette triste cellule froide et nue où nous avons remarqué avec un si douloureux étonnement, vous vous le rappelez, mon amie, les branches desséchées de son petit rosier, suspendues au-dessous de son christ. Elle est enfin l'exemple chéri, le modèle vénéré de la communauté… Mais elle me l'a avoué ce matin, en se reprochant cette faiblesse avec amertume, elle n'est pas tellement absorbée par la pratique et par les austérités de la vie religieuse, que le passé ne lui apparaisse sans cesse non-seulement tel qu'il a été… mais tel qu'il aurait pu être.
– Je m'en accuse, mon père, me disait-elle avec cette calme et douce résignation que vous lui connaissez, je m'en accuse, mais je ne puis m'empêcher de songer souvent, que, si Dieu avait voulu m'épargner la dégradation qui a flétri à jamais mon avenir, j'aurais pu vivre toujours auprès de vous, aimée de l'époux de votre choix. Malgré moi, ma vie se partage entre ces douloureux regrets et les effroyables souvenirs de la Cité. En vain je prie Dieu de me délivrer de ces obsessions, de remplir uniquement mon cœur de son pieux amour, de ses saintes espérances, de me prendre enfin tout entière, puisque je veux me donner tout entière à lui… il n'exauce pas mes vœux… sans doute parce que mes préoccupations terrestres me rendent indigne d'entrer en communication avec lui.
– Mais alors, m'écriai-je, saisi d'une folle lueur d'espérance, il en est temps encore, aujourd'hui ton noviciat finit, mais c'est seulement demain qu'aura lieu ta profession solennelle ; tu es encore libre, renonce à cette vie si rude et si austère qui ne t'offre pas les consolations que tu attendais ; souffrir pour souffrir, viens souffrir dans nos bras, notre tendresse adoucira tes chagrins.
Secouant tristement la tête, elle me répondit avec cette inflexible justesse de raisonnement qui nous a si souvent frappés :
– Sans doute, mon bon père, la solitude est bien triste pour moi… pour moi déjà si habituée à vos tendresses de chaque instant. Sans doute je suis poursuivie par d'amers regrets, de navrants souvenirs ; mais au moins j'ai la conscience d'accomplir un devoir… mais je comprends, mais je sais que partout ailleurs qu'ici je serais déplacée ; je me retrouverais dans cette condition si cruellement fausse… dont j'ai déjà tant souffert… et pour moi… et pour vous… car j'ai ma fierté aussi. Votre fille sera ce qu'elle doit être… fera ce qu'elle doit faire, subira ce qu'elle doit subir… Demain tous sauraient de quelle fange vous m'avez tirée… qu'en me voyant repentante au pied de la croix on me pardonnerait peut-être le passé en faveur de mon humilité présente… Et il n'en serait pas ainsi, n'est-ce pas ? mon bon père, si l'on me voyait, comme il y a quelques mois, briller au milieu des splendeurs de votre cour. D'ailleurs, satisfaire aux justes et sévères exigences du monde, c'est me satisfaire moi-même ; aussi je remercie et je bénis Dieu de toute la puissance de mon âme, en songeant que lui seul pouvait offrir à votre fille un asile et une position dignes d'elle et de vous… une position enfin qui ne formât pas un affligeant contraste avec ma dégradation première… et pût mériter le seul respect qui me soit dû… celui que l'on accorde au repentir et à l'humilité sincères.
Hélas ! Clémence… que répondre à cela ?…
Fatalité ! Fatalité ! Car cette malheureuse enfant est douée, si cela peut se dire, d'une inexorable logique en tout ce qui touche les délicatesses du cœur et de l'honneur. Avec un esprit et une âme pareils, il ne faut pas songer à pallier, à tourner les positions fausses ; il faut en subir les implacables conséquences…
Je l'ai quittée, comme toujours, le cœur brisé.
Sans fonder le moindre espoir sur cette entrevue, qui sera la dernière avant sa profession, je m'étais dit : « Aujourd'hui encore elle peut renoncer au cloître. » Mais vous le voyez, mon amie, sa volonté est irrévocable, et je dois, hélas ! en convenir avec elle et répéter ses paroles : « Dieu seul pouvait lui offrir un asile et une position dignes d'elle et de moi. »
Encore une fois, sa résolution est admirablement convenable et logique au point de vue de la société où nous vivons… Avec l'exquise susceptibilité de Fleur-de-Marie, il n'y a pas pour elle d'autre condition possible. Mais, je vous l'ai dit bien souvent, mon amie, si des devoirs sacrés, plus sacrés encore que ceux de la famille, ne me retenaient pas au milieu de ce peuple qui m'aime et dont je suis un peu la providence, je serais allé avec vous, ma fille, Henri et Murph, vivre heureux et obscur dans quelque retraite ignorée. Alors, loin des lois impérieuses d'une société impuissante à guérir les maux qu'elle a faits, nous aurions bien forcé cette malheureuse enfant au bonheur et à l'oubli… tandis qu'ici, au milieu de cet éclat, de ce cérémonial, si restreint qu'il fût, c'était impossible… Mais encore une fois… fatalité ! fatalité ! je ne puis abdiquer mon pouvoir sans compromettre le bonheur de ce peuple, qui compte sur moi… Braves et dignes gens ! qu'ils ignorent toujours ce que leur fidélité me coûte !…
Adieu, tendrement adieu, ma bien-aimée Clémence. Il m'est presque consolant de vous voir aussi affligée que moi du sort de mon enfant, car ainsi je puis dire notre chagrin, et il n'y a pas d'égoïsme dans ma souffrance.
Quelquefois je me demande avec effroi ce que je serais devenu sans vous au milieu de circonstances si douloureuses… Souvent aussi ces pensées m'apitoient encore davantage sur le sort de Fleur-de-Marie… Car vous me restez, vous… Et à elle, que lui reste-t-il ?
Adieu encore, et tristement adieu, noble amie, bon ange des jours mauvais. Revenez bientôt ; cette absence vous pèse autant qu'à moi…
À vous ma vie et mon amour !… âme et cœur, à vous !
R.
Je vous envoie cette lettre par un courrier ; à moins de changement imprévu, je vous en expédierai une autre demain, sitôt après la triste cérémonie. Mille vœux et espoirs à votre père pour son prompt rétablissement. J'oubliais de vous donner des nouvelles du pauvre Henri. Son état s'améliore et ne donne plus de si graves inquiétudes. Son excellent père, malade lui-même, a retrouvé des forces pour le soigner, pour le veiller ; miracle d'amour paternel qui ne nous étonne pas, nous autres.
Ainsi donc, amie, à demain… demain, jour sinistre et néfaste pour moi !
À vous encore, à vous toujours.
R.
Abbaye de Sainte-Hermangilde, quatre heures du matin.
Rassurez-vous, Clémence, rassurez-vous, quoique l'heure à laquelle je vous écris cette lettre et le lieu d'où elle est datée doivent vous effrayer…
Grâce à Dieu, le danger est passé ; mais la crise a été terrible…
Hier, après vous avoir écrit, agité par je ne sais quel funeste pressentiment, me rappelant la pâleur, l'air souffrant de ma fille, l'état de faiblesse où elle languit depuis quelque temps, songeant enfin qu'elle devait passer en prières, dans une immense et glaciale église, presque toute cette nuit qui précède sa profession, j'ai envoyé Murph et David à l'abbaye demander à la princesse Juliane de leur permettre de rester jusqu'à demain dans la maison extérieure qu'Henri habitait ordinairement. Ainsi ma fille pouvait avoir de prompts secours et moi de ses nouvelles si, comme je le craignais, les forces lui manquaient pour accomplir cette rigoureuse… je ne veux pas dire cruelle… obligation de rester une nuit de janvier en prières par un froid excessif. J'avais aussi écrit à Fleur-de-Marie que, tout en respectant l'exercice de ses devoirs religieux, je la suppliais de songer à sa santé et de faire sa veillée de prières dans sa cellule et non dans l'église. Voici ce qu'elle m'a répondu :
« Mon bon père, je vous remercie du plus profond de mon cœur de cette nouvelle et tendre preuve de votre intérêt. N'ayez aucune inquiétude ; je me crois en état d'accomplir mon devoir. Votre fille, mon bon père, ne peut témoigner ni crainte ni faiblesse. La règle est telle, je dois m'y conformer. En résultât-il quelques souffrances physiques, c'est avec joie que je les offrirais à Dieu. Vous m'approuverez, je l'espère, vous qui avez toujours pratiqué le renoncement et le devoir avec tant de courage. Adieu, mon bon père, je ne vous dirai pas que je vais prier pour vous. En priant Dieu, je vous prie toujours, car il m'est impossible de ne pas vous confondre avec la divinité que j'implore. Vous avez été pour moi sur la terre ce que Dieu, si je le mérite, sera pour moi dans le ciel.
« Daignez bénir ce soir votre fille par la pensée, mon bon père… Elle sera demain l'épouse du Seigneur.
« Elle vous baise la main avec un pieux respect.
« Sœur AMÉLIE »
Cette lettre, que je ne pus lire sans fondre en larmes, me rassura pourtant quelque peu ; je devais, moi aussi, accomplir une veillée sinistre.
La nuit venue, j'allai m'enfermer dans le pavillon que j'ai fait construire non loin du monument élevé au souvenir de mon père, en expiation de cette nuit fatale…
Vers une heure du matin, j'entendis la voix de Murph ; je frissonnai d'épouvante. Il arrivait en toute hâte du couvent.
Que vous dirai-je, mon amie ? Ainsi que je l'avais prévu, la malheureuse enfant, malgré son courage et sa volonté, n'a pas eu la force d'accomplir entièrement cette pratique barbare, dont il avait été impossible à la princesse Juliane de la dispenser, la règle étant formelle à ce sujet.
À huit heures du soir, Fleur-de-Marie s'est agenouillée sur la pierre de cette église. Jusqu'à plus de minuit elle a prié. Mais, à cette heure, succombant à sa faiblesse, à cet horrible froid, à son émotion, car elle a longuement et silencieusement pleuré, elle s'est évanouie. Deux religieuses, qui, par ordre de la princesse Juliane, avaient partagé sa veillée, vinrent la relever et la transportèrent dans sa cellule.
David fut à l'instant prévenu. Murph monta en voiture, accourut me chercher. Je volai au couvent ; je fus reçu par la princesse Juliane. Elle me dit que David craignait que ma vue ne fît une trop vive impression sur ma fille ; que son évanouissement, dont elle était revenue, ne présentait rien de très-alarmant, ayant été causé seulement par une grande faiblesse.
D'abord une horrible pensée me vint. Je crus qu'on voulait me cacher quelque grand malheur, ou du moins me préparer à l'apprendre ; mais la supérieure me dit : « Je vous l'affirme, monseigneur, la princesse Amélie est hors de danger ; un léger cordial que le docteur David lui a fait prendre a ranimé ses forces. »
Je ne pouvais douter de ce que m'affirmait l'abbesse ; je la crus, et j'attendis des nouvelles de ma fille avec une douloureuse impatience.
Au bout d'un quart d'heure d'angoisses, David revint. Grâce à Dieu, elle allait mieux, et elle avait voulu continuer sa veillée de prières dans l'église, en consentant seulement à s'agenouiller sur un coussin. Et, comme je me révoltais et m'indignais de ce que la supérieure et lui eussent accédé à son désir, ajoutant que je m'y opposais formellement, il me répondit qu'il eût été dangereux de contrarier la volonté de ma fille dans un moment où elle était sous l'influence d'une vive émotion nerveuse, et que d'ailleurs il était convenu avec la princesse Juliane que la pauvre enfant quitterait l'église à l'heure des matines pour prendre un peu de repos et se préparer à la cérémonie.
– Elle est donc maintenant à l'église ? lui dis-je.
– Oui, monseigneur ; mais avant une demi-heure elle l'aura quittée.
Je me fis aussitôt conduire à notre tribune du nord, d'où l'on domine tout le chœur.
Là, au milieu des ténèbres de cette vaste église, seulement éclairée par la pâle clarté de la lampe du sanctuaire, je la vis, près de la grille, agenouillée, les mains jointes, et priant encore avec ferveur.
Moi aussi je m'agenouillai en pensant à mon enfant.
Trois heures sonnèrent ; deux sœurs assises dans les stalles, qui ne l'avaient pas quittée des yeux, vinrent lui parler bas. Au bout de quelques moments elle se signa, se releva et traversa le chœur d'un pas assez ferme ; et pourtant, mon amie, lorsqu'elle passa sous la lampe, son visage me parut aussi blanc que le long voile qui flottait autour d'elle.
Je sortis aussitôt de la tribune, voulant d'abord aller la rejoindre ; mais je craignis qu'une nouvelle émotion l'empêchât de goûter quelques moments de repos. J'envoyai David savoir comment elle se trouvait : il revint me dire qu'elle se sentait mieux et qu'elle allait tâcher de dormir un peu.
Je reste à l'abbaye pour la cérémonie qui aura lieu ce matin.
Je pense maintenant, mon amie, qu'il est inutile de vous envoyer cette lettre incomplète. Je la terminerai demain, en vous racontant les événements de cette triste journée.
À bientôt donc, mon amie. Je suis brisé de douleur, plaignez-moi.
Dernier chapitre. Le 13 janvier
RODOLPHE À CLÉMENCE.
Treize janvier… anniversaire maintenant doublement sinistre ! ! !
Mon amie… nous la perdons à jamais !
Tout est fini… tout !
Écoutez ce récit :
Il est donc vrai… on éprouve une volupté atroce à raconter une horrible douleur.
Hier je me plaignais du hasard qui vous retenait loin de moi… aujourd'hui, Clémence, je me félicite de ce que vous n'êtes pas ici : vous souffririez trop…
Ce matin, je sommeillais à peine, j'ai été éveillé par le son des cloches… j'ai tressailli d'effroi… cela m'a semblé funèbre… on eût dit un glas de funérailles.
En effet… ma fille est morte pour nous… morte, entendez-vous… Dès aujourd'hui, Clémence… il vous faut commencer à porter son deuil dans votre cœur, dans votre cœur toujours pour elle si maternel.
Que notre enfant soit ensevelie sous le marbre d'un tombeau ou sous la voûte d'un cloître… pour nous… quelle est la différence ?
Dès aujourd'hui, entendez-vous, Clémence, il faut la regarder comme morte… D'ailleurs… elle est d'une si grande faiblesse… sa santé, altérée par tant de chagrins, par tant de secousses, est si chancelante… Pourquoi pas aussi cette autre mort, plus complète encore ? La fatalité n'est pas lasse…
Et puis d'ailleurs… d'après ma lettre d'hier, vous devez comprendre que cela serait peut-être plus heureux pour elle… qu'elle fût morte.
Morte… ces cinq lettres ont une physionomie étrange… ne trouvez-vous pas ?… quand on les écrit à propos d'une fille idolâtrée… d'une fille si belle… si charmante, d'une bonté si angélique… Dix-huit ans à peine… et morte au monde !…
Au fait… pour nous et pour elle, à quoi bon végéter souffrante dans la morne tranquillité de ce cloître ? Qu'importe qu'elle vive, si elle est perdue pour nous ? Elle doit tant l'aimer, la vie… que la fatalité lui a faite !…
Ce que je dis là est affreux… il y a un égoïsme barbare dans l'amour paternel !…
À midi, sa profession a eu lieu avec une pompe solennelle.
Caché derrière les rideaux de notre tribune, j'y ai assisté…
J'ai ressenti, mais avec encore plus d'intensité, toutes les poignantes émotions que nous avions éprouvées lors de son noviciat…
Chose bizarre ! elle est adorée, on croit généralement qu'elle est attirée vers la vie religieuse par une irrésistible vocation, on devrait voir dans sa profession un événement heureux pour elle, et, au contraire, une accablante tristesse pesait sur la foule.
Au fond de l'église, parmi le peuple… j'ai vu deux sous-officiers de mes gardes, deux vieux et rudes soldats, baisser la tête et pleurer…
On eût dit qu'il y avait dans l'air un douloureux pressentiment… Du moins s'il était fondé, il n'est réalisé qu'à demi…
La profession terminée, on a ramené notre enfant dans la salle du chapitre, où devait avoir lieu la nomination de la nouvelle abbesse…
Grâce à mon privilège souverain, j'allai dans cette salle attendre Fleur-de-Marie au retour du chœur.
Elle rentra bientôt…
Son émotion, sa faiblesse étaient si grandes que deux sœurs la soutenaient…
Je fus effrayé, moins encore de sa pâleur et de la profonde altération de ses traits que de l'expression de son sourire… Il me parut empreint d'une sorte de satisfaction sinistre…
Clémence… je vous le dis… peut-être bientôt nous faudra-t-il du courage… bien du courage… Je sens pour ainsi dire en moi que notre enfant est mortellement frappée…
… Après tout, sa vie serait si malheureuse…
Voilà deux fois que je me dis, en pensant à la mort possible de ma fille… que cette mort mettrait du moins un terme à sa cruelle existence… Cette pensée est un horrible symptôme… Mais, si ce malheur doit nous frapper, il vaut mieux y être préparé, n'est-ce pas, Clémence ?
Se préparer à un pareil malheur… c'est en savourer peu à peu et d'avance les lentes angoisses… C'est un raffinement de douleurs inouï… Cela est mille fois plus affreux que le coup qui vous frappe imprévu… Au moins la stupeur, l'anéantissement vous épargnent une partie de cet atroce déchirement…
Mais les usages de la compassion veulent qu'on vous prépare… Probablement je n'agirais pas autrement moi-même, pauvre amie… si j'avais à vous apprendre le funeste événement dont je vous parle… Ainsi épouvantez-vous… si vous remarquez que je vous entretiens d'elle… avec des ménagements, des détours d'une tristesse désespérée, après vous avoir annoncé que sa santé ne me donnait pourtant pas de graves inquiétudes.
Oui, épouvantez-vous, si je vous parle comme je vous écris maintenant… car, quoique je l'aie quittée assez calme il y a une heure pour venir terminer cette lettre, je vous le répète, Clémence, il me semble ressentir en moi qu'elle est plus souffrante qu'elle ne le paraît… Fasse le ciel que je me trompe, et que je prenne pour des pressentiments la désespérante tristesse que m'a inspirée cette cérémonie lugubre !
Fleur-de-Marie entra donc dans la grande salle du chapitre.
Toutes les stalles furent successivement occupées par les religieuses.
Elle alla modestement se mettre à la dernière place de la rangée de gauche ; elle s'appuyait sur le bras d'une des sœurs, car elle semblait toujours bien faible.
Au haut de la salle, la princesse Juliane était assise, ayant d'un côté la grande prieure, de l'autre une seconde dignitaire, tenant à la main la crosse d'or, symbole de l'autorité abbatiale.
Il se fit un profond silence, la princesse se leva, prit sa crosse en main et dit d'une voix grave et émue :
– Mes chères filles, mon grand âge m'oblige de confier à des mains plus jeunes cet emblème de mon pouvoir spirituel, et elle montra sa crosse. J'y suis autorisée par une bulle de notre Saint-Père ; je présenterai donc à la bénédiction de monseigneur l'archevêque d'Oppenheim et à l'approbation de S. A. R. le grand-duc, notre souverain, celle de vous, mes chères filles, qui par vous aura été désignée pour me succéder. Notre grande prieure va vous faire connaître le résultat de l'élection, et à celle-là que vous aurez élue je remettrai ma crosse et mon anneau.
Je ne quittai pas ma fille des yeux.
Debout dans sa stalle, les deux mains jointes sur sa poitrine, les yeux baissés, à demi enveloppée de son voile blanc et des longs plis traînants de sa robe noire, elle se tenait immobile et pensive, elle n'avait pas un moment supposé qu'on pût l'élire ; son élévation n'avait été confiée qu'à moi par l'abbesse.
La grande prieure prit un registre et lut :
– Chacune de nos chères sœurs ayant été, suivant la règle, invitée, il y a huit jours, à déposer son vote entre les mains de notre sainte mère et à tenir son choix secret jusqu'à ce moment ; au nom de notre sainte mère, je déclare qu'une de vous, mes chères sœurs, a par sa piété exemplaire, par ses vertus angéliques, mérité le suffrage unanime de la communauté, et celle-là est notre sœur Amélie, de son vivant très-haute et très-puissante princesse de Gerolstein.
À ces mots, une sorte de murmure de douce surprise et d'heureuse satisfaction circula dans la salle ; tous les regards des religieuses se fixèrent sur ma fille avec une expression de tendre sympathie ; malgré mes accablantes préoccupations, je fus moi-même vivement ému de cette nomination qui, faite isolément et secrètement, offrait néanmoins une si touchante unanimité.
Fleur-de-Marie, stupéfaite, devint encore plus pâle ; ses genoux tremblaient si fort qu'elle fut obligée de s'appuyer d'une main sur le rebord de la stalle.
L'abbesse reprit d'une voix haute et grave :
– Mes chères filles, c'est bien sœur Amélie que vous croyez la plus digne et la plus méritante de vous toutes ? C'est bien elle que vous reconnaissez pour votre supérieure spirituelle ? Que chacune de vous me réponde à son tour, mes chères filles.
Et chaque religieuse répondit à haute voix :
– Librement et volontairement j'ai choisi et je choisis sœur Amélie pour ma sainte mère et supérieure.
Saisie d'une émotion inexprimable, ma pauvre enfant tomba à genoux, joignit les deux mains et resta ainsi jusqu'à ce que chaque vote fût émis.
Alors l'abbesse, déposant la crosse et l'anneau entre les mains de la grande prieure, s'avança vers ma fille pour la prendre par la main et la conduire au siège abbatial.
Mon amie, ma tendre amie, je me suis interrompu un moment ; il m'a fallu reprendre courage pour achever de vous raconter cette scène déchirante…
– Relevez-vous, ma chère fille, lui dit l'abbesse, venez prendre la place qui vous appartient ; vos vertus évangéliques, et non votre rang, vous l'ont gagnée.
En disant ces mots, la vénérable princesse se pencha vers ma fille pour l'aider à se relever.
Fleur-de-Marie fit quelques pas en tremblant, puis arrivant au milieu de la salle du chapitre elle s'arrêta, et dit d'une voix dont le calme et la fermeté m'étonnèrent :
– Pardonnez-moi, sainte mère… je voudrais parler à mes sœurs.
– Montez d'abord, ma chère fille, sur votre siège abbatial, dit la princesse ; c'est de là que vous devez leur faire entendre votre voix.
– Cette place, sainte mère… ne peut être la mienne, répondit Fleur-de-Marie d'une voix haute et tremblante.
– Que dites-vous, ma chère fille ?
– Une si haute dignité n'est pas faite pour moi, sainte mère.
– Mais les vœux de toutes vos sœurs vous y appellent.
– Permettez-moi, sainte mère, de faire ici à deux genoux une confession solennelle, mes sœurs verront bien, et vous aussi, sainte mère, que la condition la plus humble n'est pas encore assez humble pour moi.
– Votre modestie vous abuse, ma chère fille, dit la supérieure avec bonté, croyant en effet que la malheureuse enfant cédait à un sentiment de modestie exagéré ; mais moi je devinai ces aveux que Fleur-de-Marie allait faire. Saisi d'effroi, je m'écriai d'une voix suppliante :
– Mon enfant… je t'en conjure…
À ces mots… vous dire, mon amie, tout ce que je lus dans le profond regard que Fleur-de-Marie me jeta serait impossible… Ainsi que vous le saurez dans un instant, elle m'avait compris. Oui, elle avait compris que je devais partager la honte de cette horrible révélation… Elle avait compris qu'après de tels aveux on pouvait m'accuser… moi, de mensonge… car j'avais toujours dû laisser croire que jamais Fleur-de-Marie n'avait quitté sa mère…
À cette pensée, la pauvre enfant s'était crue coupable envers moi d'une noire ingratitude… Elle n'eut pas la force de continuer, elle se tut et baissa la tête avec accablement…
– Encore une fois, ma chère fille, reprit l'abbesse, votre modestie vous trompe… l'unanimité du choix de vos sœurs vous prouve combien vous êtes digne de me remplacer… Par cela même que vous avez pris part aux joies du monde, votre renoncement à ces joies n'en est que plus méritoire… Ce n'est pas S. A. la princesse Amélie qui est élue, c'est sœur Amélie… Pour nous, votre vie a commencé du jour où vous avez mis le pied dans la maison du Seigneur… et c'est cette exemplaire et sainte vie que nous récompensons… Je vous dirai plus, ma chère fille ; avant d'entrer au bercail votre existence aurait été aussi égarée qu'elle a été au contraire pure et louable… que les vertus évangéliques dont vous nous avez donné l'exemple depuis votre séjour ici expieraient et rachèteraient encore aux yeux du Seigneur un passé si coupable qu'il fût… D'après cela, ma chère fille, jugez si votre modestie doit être rassurée.
Ces paroles de l'abbesse furent, comme vous le pensez, mon amie, d'autant plus précieuses pour Fleur-de-Marie qu'elle croyait le passé ineffaçable. Malheureusement, cette scène l'avait profondément émue, et, quoiqu'elle affectât du calme et de la fermeté, il me sembla que ses traits s'altéraient d'une manière inquiétante… Par deux fois elle tressaillit en passant sur son front sa pauvre main amaigrie.
– Je crois vous avoir convaincue, ma chère fille, reprit la princesse Juliane, et vous ne voudrez pas causer à vos sœurs un vif chagrin en refusant cette marque de leur confiance et de leur affection.
– Non, sainte mère, dit-elle avec une expression qui me frappa, et d'une voix de plus en plus faible, je crois maintenant pouvoir accepter… Mais, comme je me sens bien fatiguée et un peu souffrante, si vous le permettiez, sainte mère, la cérémonie de ma consécration n'aurait lieu que dans quelques jours…
– Il sera fait comme vous le désirez, ma chère fille… mais en attendant que votre dignité soit bénie et consacrée… prenez cet anneau… venez à votre place… nos chères sœurs vous rendront hommage selon notre règle.
Et la supérieure, glissant son anneau pastoral au doigt de Fleur-de-Marie, la conduisit au siège abbatial.
Ce fut un spectacle simple et touchant.
Auprès de ce siège où elle s'assit, se tenaient, d'un côté, la grande prieure, portant la crosse d'or ; de l'autre, la princesse Juliane. Chaque religieuse alla s'incliner devant notre enfant et lui baiser respectueusement la main.
Je voyais à chaque instant son émotion augmenter, ses traits se décomposer davantage ; enfin cette scène fut sans doute au-dessus de ses forces… car elle s'évanouit avant que la procession des sœurs fût terminée…
Jugez de mon épouvante !… Nous la transportâmes dans l'appartement de l'abbesse…
David n'avait pas quitté le couvent ; il accourut, lui donna les premiers soins. Puisse-t-il ne m'avoir pas trompé ! mais il m'a assuré que ce nouvel accident n'avait pour cause qu'une extrême faiblesse causée par le jeûne, les fatigues et la privation de sommeil que ma fille s'était imposés pendant son rude et long noviciat…
Je l'ai cru, parce que en effet ses traits angéliques, quoique d'une effrayante pâleur, ne trahissaient aucune souffrance lorsqu'elle reprit connaissance… Je fus même frappé de la sérénité qui rayonnait sur son beau front. De nouveau cette quiétude m'effraya : il me sembla qu'elle cachait le secret espoir d'une délivrance prochaine…
La supérieure était retournée au chapitre pour clore la séance, je restai seul avec ma fille.
Après m'avoir regardé en silence pendant quelques moments, elle me dit :
– Mon bon père… pourrez-vous oublier mon ingratitude ? Pourrez-vous oublier qu'au moment où j'allais faire cette pénible confession vous m'avez demandé grâce ?
– Tais-toi… je t'en supplie.
– Et je n'avais pas songé, reprit-elle avec amertume, qu'en disant à la face de tous de quel abîme de dépravation vous m'aviez retirée… c'était révéler un secret que vous aviez gardé par tendresse pour moi… c'était vous accuser publiquement, vous, mon père, d'une dissimulation à laquelle vous ne vous étiez résigné que pour m'assurer une vie éclatante et honorée… Oh ! pourrez-vous me pardonner ?
Au lieu de lui répondre, je collai mes lèvres sur son front, elle sentit couler mes larmes…
Après avoir baisé mes mains à plusieurs reprises, elle me dit :
– Maintenant, je me sens mieux, mon bon père… maintenant que me voici, ainsi que le dit notre règle, morte au monde… je voudrais faire quelques dispositions en faveur de plusieurs personnes… mais, comme tout ce que je possède est à vous… m'y autorisez-vous, mon père ?…
– Peux-tu en douter ?… Mais je t'en supplie, lui dis-je, n'aie pas de ces pensées sinistres… Plus tard tu t'occuperas de ce soin… n'as-tu pas le temps ?
– Sans doute, mon bon père, j'ai encore bien du temps à vivre, ajouta-t-elle avec un accent qui, je ne sais pourquoi, me fit de nouveau tressaillir. Je la regardai plus attentivement ; aucun changement dans ses traits ne justifia mon inquiétude. Oui, j'ai encore bien du temps à vivre, reprit-elle, mais je ne devrai plus m'occuper des choses terrestres… car, aujourd'hui, je renonce à tout ce qui m'attache au monde… Je vous en prie, ne me refusez pas…
– Ordonne… je ferai ce que tu désires…
– Je voudrais que ma tendre mère gardât toujours dans le petit salon où elle se tient habituellement… mon métier à broder… avec la tapisserie que j'avais commencée…
– Tes désirs seront remplis, mon enfant. Ton appartement est resté comme il était le jour où tu as quitté le palais ; car tout ce qui t'a appartenu est pour nous l'objet d'un culte religieux… Clémence sera profondément touchée de ta pensée…
– Quant à vous, mon bon père, prenez, je vous en prie, mon grand fauteuil d'ébène, où j'ai tant pensé, tant rêvé…
– Il sera placé à côté du mien, dans mon cabinet de travail, et je t'y verrai chaque jour assise près de moi, comme tu t'y asseyais si souvent, lui dis-je sans pouvoir retenir mes larmes.
– Maintenant, je voudrais laisser quelques souvenirs de moi à ceux qui m'ont témoigné tant d'intérêt quand j'étais malheureuse. À Mme Georges je voudrais donner l'écritoire dont je me servais dernièrement. Ce don aura quelque à-propos, ajouta-t-elle avec son doux sourire, car c'est elle qui, à la ferme, a commencé de m'apprendre à écrire. Quant au vénérable curé de Bouqueval, qui m'a instruite dans la religion, je lui destine le beau christ de mon oratoire…
– Bien, mon enfant.
– Je désirerais aussi envoyer mon bandeau de perles à ma bonne petite Rigolette… C'est un bijou simple qu'elle pourra porter sur ses beaux cheveux noirs… Et puis, si cela était possible, puisque vous savez où se trouvent Martial et la Louve en Algérie, je voudrais que cette courageuse femme qui m'a sauvé la vie eût ma croix d'or émaillée… Ces différents gages de souvenir, mon bon père, seraient remis à ceux à qui je les envoie « de la part de Fleur-de-Marie ».
– J'exécuterai tes volontés… Tu n'oublies personne ?…
– Je ne crois pas, mon bon père…
– Cherche bien… Parmi ceux qui t'aiment n'y a-t-il pas quelqu'un de bien malheureux ? d'aussi malheureux que ta mère et moi… quelqu'un enfin qui regrette aussi douloureusement que nous ton entrée au couvent ?
La pauvre enfant me comprit, me serra la main, une légère rougeur colora un instant son pâle visage.
Allant au-devant d'une question qu'elle craignait sans doute de me faire, je lui dis :
– Il va mieux… on ne craint plus pour ses jours…
– Et son père ?
– Il se ressent de l'amélioration de la santé de son fils… il va mieux aussi… Et à Henri ? Que lui donnes-tu ?… Un souvenir de toi lui serait une consolation si chère et si précieuse !…
– Mon père… offrez-lui mon prie-Dieu… Hélas ! je l'ai bien souvent arrosé de mes larmes, en demandant au ciel la force d'oublier Henri, puisque j'étais indigne de son amour…
– Combien il sera heureux de voir que tu as eu une pensée pour lui !…
– Quant à la maison d'asile pour les orphelines et les jeunes filles abandonnées de leurs parents, je désirerais, mon bon père, que…
Ici la lettre de Rodolphe était interrompue par ces mots presque illisibles :
« Clémence… Murph terminera cette lettre ; je n'ai plus la tête à moi ; je suis fou… Ah ! le 13 JANVIER ! ! ! »
La fin de cette lettre, de l'écriture de Murph, était ainsi conçue :
Madame,
D'après les ordres de Son Altesse Royale, je complète ce triste récit. Les deux lettres de monseigneur auront dû préparer Votre Altesse Royale à l'accablante nouvelle qu'il me reste à lui apprendre.
Il y a trois heures, monseigneur était occupé à écrire à Votre Altesse Royale ; j'attendais dans une pièce voisine qu'il me remît la lettre pour l'expédier aussitôt par un courrier. Tout à coup j'ai vu entrer la princesse Juliane d'un air consterné. « Où est Son Altesse Royale ? me dit-elle d'une voix émue. – Princesse, monseigneur écrit à Mme la grande-duchesse des nouvelles de la journée. – Sir Walter, il faut apprendre à monseigneur un événement terrible… Vous êtes son ami… veuillez l'en instruire… De vous, ce coup lui sera moins terrible…
Je compris tout ; je crus plus prudent de me charger de cette funeste révélation… La supérieure ayant ajouté que la princesse Amélie s'éteignait lentement, et que monseigneur, devait se hâter de venir recevoir les derniers soupirs de sa fille, je n'avais malheureusement pas le temps d'employer des ménagements. J'entrai dans le salon ; Son Altesse Royale s'aperçut de ma pâleur. « Tu viens m'apprendre un malheur !… – Un irréparable malheur, monseigneur… Du courage !… – Ah ! mes pressentiments ! !… » s'écria-t-il. Et, sans ajouter un mot, il courut au cloître. Je le suivis.
De l'appartement de la supérieure, la princesse Amélie avait été transportée dans sa cellule après sa dernière entrevue avec monseigneur. Une des sœurs la veillait ; au bout d'une heure, elle s'aperçut que la voix de la princesse Amélie, qui lui parlait par intervalles, s'affaiblissait et s'oppressait de plus en plus. La sœur s'empressa d'aller prévenir la supérieure. Le docteur David fut appelé ; il crut remédier à cette nouvelle perte de forces par un cordial, mais en vain ; le pouls était à peine sensible… Il reconnut avec désespoir que, des émotions réitérées ayant probablement usé le peu de forces de la princesse Amélie, il ne restait aucun espoir de la sauver.
Ce fut alors que monseigneur arriva ; la princesse Amélie venait de recevoir les derniers sacrements, une lueur de connaissance lui restait encore ; dans une de ses mains, croisées sur son sein, elle tenait les débris de son petit rosier…
Monseigneur tomba agenouillé à son chevet ; il sanglotait.
– Ma fille !… mon enfant chérie !… s'écria-t-il d'une voix déchirante.
La princesse Amélie l'entendit, tourna légèrement la tête vers lui… ouvrit les yeux… tâcha de sourire, et dit d'une voix défaillante :
– Mon bon père… pardon… aussi à Henri… à ma bonne mère… pardon…
Ce furent ses derniers mots…
Après une heure d'une agonie pour ainsi dire paisible… elle rendit son âme à Dieu…
Lorsque sa fille eut rendu le dernier soupir, monseigneur ne dit pas un mot… son calme et son silence étaient effrayants… il ferma les paupières de la princesse, la baisa plusieurs fois au front, prit pieusement les débris du petit rosier et sortit de la cellule.
Je le suivis ; il revint dans la maison extérieure du cloître, et, me montrant la lettre qu'il avait commencé d'écrire à Votre Altesse Royale, et à laquelle il voulut en vain ajouter quelques mots, car sa main tremblait convulsivement, il me dit :
– Il m'est impossible d'écrire… Je suis anéanti… ma tête se perd ! Écris à la grande-duchesse que je n'ai plus de fille !…
J'ai exécuté les ordres de monseigneur.
Qu'il me soit permis, comme à son plus vieux serviteur, de supplier Votre Altesse Royale de hâter son retour… autant que la santé de M. le comte d'Orbigny le permettra. La présence seule de Votre Altesse Royale pourrait calmer le désespoir de monseigneur… Il veut chaque nuit veiller sur sa fille jusqu'au jour où elle sera ensevelie dans la chapelle grand-ducale.
J'ai accompli ma triste tâche, madame ; veuillez excuser l'incohérence de cette lettre, et recevoir l'expression du respectueux dévouement avec lequel j'ai l'honneur d'être de Votre Altesse Royale,
Le très-obéissant serviteur,
WALTER MURPH.
La veille du service funèbre de la princesse Amélie, Clémence arriva à Gerolstein avec son père.
Rodolphe ne fut pas seul le jour des funérailles de Fleur-de-Marie.
Fin de l'épilogue.
Fin des Mystères de Paris
Source: Wikisource
I. Gerolstein
LE PRINCE HENRI D'HERKAUSEN-OLDENZAAL AU COMTE MAXIMILIEN KAMINETZ
Oldenzaal, 25 août 1840
J'arrive de Gerolstein, où j'ai passé trois mois auprès du grand-duc et de sa famille ; je croyais trouver une lettre m'annonçant votre arrivée à Oldenzaal, mon cher Maximilien. Jugez de ma surprise, de mon chagrin, lorsque j'apprends que vous êtes encore retenu en Hongrie pour plusieurs semaines.
Depuis quatre mois je n'ai pu vous écrire, ne sachant où vous adresser mes lettres, grâce à votre manière originale et aventureuse de voyager ; vous m'aviez pourtant formellement promis à Vienne, au moment de notre séparation, de vous trouver le 1er août à Oldenzaal. Il me faut donc renoncer au plaisir de vous voir, et pourtant jamais je n'aurais eu plus besoin d'épancher mon cœur dans le vôtre, mon bon Maximilien, mon plus vieil ami, car, quoique bien jeunes encore, notre amitié est ancienne : elle date de notre enfance.
Que vous dirai-je ? Depuis trois mois une révolution complète s'est opérée en moi… Je touche à l'un de ces instants qui décident de l'existence d'un homme… Jugez si votre présence, si vos conseils me manquent !
Mais vous ne me manquerez pas longtemps, quels que soient les intérêts qui vous retiennent en Hongrie ; vous viendrez, Maximilien, vous viendrez, je vous en conjure, car j'aurai besoin sans doute de puissantes consolations… et je ne puis aller vous chercher. Mon père dont la santé est de plus en plus chancelante, m'a rappelé de Gerolstein. Il s'affaiblit chaque jour davantage ; il m'est impossible de le quitter…
J'ai tant à vous dire que je serai prolixe : il me faut vous raconter l'époque la plus pleine, la plus romanesque de ma vie…
Étrange et triste hasard ! Pendant cette époque nous sommes fatalement restés éloignés l'un de l'autre, nous, les inséparables, nous, les deux frères, nous, les deux plus fervents apôtres de la trois fois sainte amitié ! Nous, enfin, si fiers de prouver que le Carlos et le Posa de notre Schiller ne sont pas des idéalistes, et que, comme ces divines créations du grand poëte, nous savons goûter les suaves délices d'un tendre et mutuel attachement !
Oh ! mon ami, que n'êtes-vous là ! Que n'étiez-vous là ! Depuis trois mois mon cœur déborde d'émotions à la fois d'une douceur ou d'une tristesse inexprimables. Et j'étais seul, et je suis seul… Plaignez-moi, vous qui connaissez ma sensibilité quelquefois si bizarrement expansive, vous qui souvent avez vu mes yeux se mouiller de larmes au naïf récit d'une action généreuse, au simple aspect d'un beau soleil couchant, ou d'une nuit d'été paisible et étoilée ! Vous souvenez-vous, l'an passé, lors de notre excursion aux ruines d'Oppenfeld… au bord du grand lac… nos rêveries silencieuses pendant cette magnifique soirée si remplie de calme, de poésie et de sérénité ?
Bizarre contraste !… C'était trois jours avant ce duel sanglant où je n'ai pas voulu vous prendre pour second, car j'aurais trop souffert pour vous, si j'avais été blessé sous vos yeux… Ce duel, où, pour une querelle de jeu, mon second, à moi, a malheureusement tué ce jeune Français, le vicomte de Saint-Remy… À propos, savez-vous ce qu'est devenue cette dangereuse sirène que M. de Saint-Remy avait amenée à Oppenfeld, et qui se nommait, je crois, Cecily David ?
Mon ami, vous devez sourire de pitié en me voyant m'égarer ainsi parmi de vagues souvenirs du passé, au lieu d'arriver aux graves confidences que je vous annonce ; c'est que, malgré moi, je recule l'instant de ces confidences ; je connais votre sévérité, et j'ai peur d'être grondé, oui, grondé, parce qu'au lieu d'agir avec réflexion, avec sagesse (une sagesse de vingt et un ans, hélas !), j'ai agi follement, ou plutôt je n'ai pas agi… je me suis laissé aveuglément emporter au courant qui m'entraînait… et c'est seulement depuis mon retour de Gerolstein que je me suis, pour ainsi dire, éveillé du songe enchanteur qui m'a bercé pendant trois mois… et ce réveil est funeste…
Allons, mon ami, mon bon Maximilien, je prends mon grand courage. Écoutez-moi avec indulgence… Je commence en baissant les yeux, je n'ose vous regarder… car, en lisant ces lignes, vos traits doivent être devenus si graves, si sévères… homme stoïque !
Ayant obtenu un congé de six mois, je quittai Vienne, et je restai ici quelque temps auprès de mon père ; sa santé étant bonne alors, il me conseilla d'aller visiter mon excellente tante, la princesse Juliane, supérieure de l'abbaye de Gerolstein. Je vous ai dit, je crois, mon ami, que mon aïeule était cousine germaine de l'aïeul du grand-duc actuel, et que ce dernier, Gustave-Rodolphe, grâce à cette parenté, a toujours bien voulu nous traiter, moi et mon père, très-affectueusement de cousins. Vous savez aussi, je crois, que, pendant un assez long voyage que le prince fit dernièrement en France, il chargea mon père de l'administration du grand-duché.
Ce n'est nullement par orgueil, vous le pensez, mon ami, que je vous parle de ces circonstances ; c'est pour vous expliquer les causes de l'extrême intimité dans laquelle j'ai vécu avec le grand-duc et sa famille pendant mon séjour à Gerolstein.
Vous souvenez-vous que l'an passé, lors de notre voyage des bords du Rhin, on nous apprit que le prince avait retrouvé en France et épousé in extremis Mme la comtesse Mac-Gregor, afin de légitimer la naissance d'une fille qu'il avait eue d'elle lors d'une première union secrète, plus tard cassée pour vice de forme et parce qu'elle avait été contractée malgré la volonté du grand-duc alors régnant ?
Cette jeune fille, ainsi solennellement reconnue, est cette charmante princesse Amélie[2] dont lord Dudley, qui l'avait vue à Gerolstein il y a maintenant une année environ, nous parlait cet hiver, à Vienne, avec un enthousiasme que nous accusions d'exagération… Étrange hasard !… Qui m'eût dit alors !…
Mais, quoique vous ayez sans doute maintenant à peu près deviné mon secret, laissez-moi suivre la marche des événements sans l'intervertir…
Le couvent de Sainte-Hermangilde, dont ma tante est abbesse, est à peine éloigné d'un demi-quart de lieue de Gerolstein, car les jardins de l'abbaye touchent aux faubourgs de la ville ; une charmante maison, complètement isolée du cloître, avait été mise à ma disposition par ma tante, qui m'aime, vous le savez, avec une tendresse maternelle.
Le jour de mon arrivée, elle m'apprit qu'il y avait le lendemain réception solennelle et fête à la cour, le grand-duc devant ce jour-là officiellement annoncer son prochain mariage avec Mme la marquise d'Harville, arrivée depuis peu à Gerolstein, accompagnée de son père, M. le comte d'Orbigny[3].
Les uns blâmaient le prince de n'avoir pas recherché encore cette fois une alliance souveraine (la grande-duchesse dont le prince était veuf appartenait à la maison de Bavière), d'autres, au contraire, et ma tante était du nombre, le félicitaient d'avoir préféré à des vues d'ambitieuses convenances une jeune et aimable femme qu'il adorait et qui appartenait à la plus haute noblesse de France. Vous savez d'ailleurs, mon ami, que ma tante a toujours eu pour le grand-duc Rodolphe l'attachement le plus profond ; mieux que personne elle pouvait apprécier les éminentes qualités du prince.
– Mon cher enfant, me dit-elle, à propos de cette réception solennelle où je devais me rendre le lendemain de mon arrivée, mon cher enfant, ce que vous verrez de plus merveilleux dans cette fête sera sans contredit la perle de Gerolstein.
– De qui voulez-vous parler, ma bonne tante ?
– De la princesse Amélie…
– La fille du grand-duc ? En effet, lord Dudley nous en avait parlé à Vienne avec un enthousiasme que nous avions taxé d'exagération poétique.
– À mon âge, avec mon caractère et dans ma position, reprit ma tante, on s'exalte assez peu ; aussi vous croirez à l'impartialité de mon jugement, mon cher enfant ! Eh bien ! je vous dis, moi, que de ma vie je n'ai rien connu de plus enchanteur que la princesse Amélie. Je vous parlerais de son angélique beauté, si elle n'était pas douée d'un charme inexprimable qui est encore supérieur à la beauté. Figurez-vous la candeur dans la dignité et la grâce dans la modestie. Dès le premier jour où le grand-duc m'a présentée à elle, j'ai senti pour cette jeune princesse une sympathie involontaire. Du reste, je ne suis pas la seule : l'archiduchesse Sophie est à Gerolstein depuis quelques jours ; c'est bien la plus fière et la plus hautaine princesse que je sache…
– Il est vrai, ma tante, son ironie est terrible, peu de personnes échappent à ses mordantes plaisanteries. À Vienne on la craignait comme le feu… La princesse Amélie aurait-elle trouvé grâce devant elle ?
– L'autre jour elle vint ici après avoir visité la maison d'asile placée sous la surveillance de la jeune princesse. Savez-vous une chose ? me dit cette redoutable archiduchesse avec sa brusque franchise ; j'ai l'esprit singulièrement tourné à la satire, n'est-ce pas ? Eh bien ! si je vivais longtemps avec la fille du grand-duc, je deviendrais, j'en suis sûre, inoffensive… tant sa bonté est pénétrante et contagieuse.
– Mais c'est donc une enchanteresse que ma cousine ? dis-je à ma tante en souriant.
– Son plus puissant attrait, à mes yeux du moins, reprit ma tante, est ce mélange de douceur, de modestie et de dignité dont je vous ai parlé, et qui donne à son visage angélique l'expression la plus touchante.
– Certes, ma tante, la modestie est une rare qualité chez une princesse si jeune, si belle et si heureuse.
– Songez encore, mon cher enfant, qu'il est d'autant mieux à la princesse Amélie de jouir sans ostentation vaniteuse de la haute position qui lui est incontestablement acquise, que son élévation est récente[4].
– Et dans son entretien avec vous, ma tante, la princesse a-t-elle fait quelque allusion à sa fortune passée ?
– Non ; mais lorsque, malgré mon grand âge, je lui parlai avec le respect qui lui est dû, puisque Son Altesse est la fille de notre souverain, son trouble ingénu, mêlé de reconnaissance et de vénération pour moi, m'a profondément émue ; car sa réserve, remplie de noblesse et d'affabilité, me prouvait que le présent ne l'enivrait pas assez pour qu'elle oubliât le passé, et qu'elle rendait à mon âge ce que j'accordais à son rang.
– Il faut, en effet, dis-je à ma tante, un tact exquis pour observer ces nuances si délicates.
– Aussi, mon cher enfant, plus j'ai vu la princesse Amélie, plus je me suis félicitée de ma première impression. Depuis qu'elle est ici, ce qu'elle a fait de bonnes œuvres est incroyable, et cela avec une réflexion, une maturité de jugement qui me confondent chez une personne de son âge. Jugez-en : à sa demande, le grand-duc a fondé à Gerolstein un établissement pour les petites filles orphelines de cinq ou six ans, et pour les jeunes filles orphelines aussi abandonnées, qui ont atteint seize ans, âge si fatal pour les infortunées que rien ne défend contre la séduction du vice ou l'obsession du besoin. Ce sont des religieuses nobles de mon abbaye qui enseignent et dirigent les pensionnaires de cette maison. En allant la visiter, j'ai eu souvent occasion de juger de l'adoration que ces pauvres créatures déshéritées ont pour la princesse Amélie. Chaque jour elle va passer quelques heures dans cet établissement, placé sous sa protection spéciale ; et, je vous le répète, mon enfant, ce n'est pas seulement du respect, de la reconnaissance, que les pensionnaires et les religieuses ressentent pour Son Altesse, c'est presque du fanatisme.
– Mais c'est un ange que la princesse Amélie, dis-je à ma tante.
– Un ange, oui, un ange, reprit-elle, car vous ne pouvez vous imaginer avec quelle attendrissante bonté elle traite ses protégées, de quelle pieuse sollicitude elle les entoure. Jamais je n'ai vu ménager avec plus de délicatesse la susceptibilité du malheur ; on dirait qu'une irrésistible sympathie attire surtout la princesse vers cette classe de pauvres abandonnées. Enfin, le croiriez-vous ? elle, fille d'un souverain, n'appelle jamais autrement ces jeunes filles que mes sœurs.
À ces derniers mots de ma tante, je vous l'avoue, Maximilien, une larme me vint aux yeux. Ne trouvez-vous pas en effet belle et sainte la conduite de cette jeune princesse ? Vous connaissez ma sincérité, je vous jure que je vous rapporte et que je vous rapporterai toujours presque textuellement les paroles de ma tante.
– Puisque la princesse, lui dis-je, est si merveilleusement douée, j'éprouverai un grand trouble lorsque demain je lui serai présenté ; vous connaissez mon insurmontable timidité, vous savez que l'élévation du caractère m'impose encore plus que le rang : je suis donc certain de paraître à la princesse aussi stupide qu'embarrassé ; j'en prends mon parti d'avance.
– Allons, allons, me dit ma tante en souriant, elle aura pitié de vous, mon cher enfant, d'autant plus que vous ne serez pas pour elle une nouvelle connaissance.
– Moi, ma tante ?
– Sans doute.
– Et comment cela ?
– Vous vous souvenez que, lorsqu'à l'âge de seize ans vous avez quitté Oldenzaal pour faire un voyage en Russie et en Angleterre avec votre père, j'ai fait faire de vous un portrait dans le costume que vous portiez au premier bal costumé donné par feu la grande-duchesse.
– Oui, ma tante, un costume de page allemand du XVIe siècle.
– Notre excellent peintre Fritz Mocker, tout en reproduisant fidèlement vos traits, n'avait pas seulement retracé un personnage du XVIe siècle ; mais, par un caprice d'artiste, il s'était plu à imiter jusqu'à la manière et jusqu'à la vétusté des tableaux peints à cette époque. Quelques jours après son arrivée en Allemagne, la princesse Amélie, étant venue me voir avec son père, remarqua votre portrait et me demanda naïvement quelle était cette charmante figure des temps passés. Son père sourit, me fit un signe, et lui répondit : « Ce portrait est celui d'un de nos cousins, qui aurait maintenant, vous le voyez, à son costume, ma chère Amélie, quelque trois cents ans, mais qui, bien jeune, avait déjà témoigné d'une rare intrépidité et d'un cœur excellent ; ne porte-t-il pas, en effet, la bravoure dans le regard et la bonté dans le sourire ? »
(Je vous en supplie, Maximilien, ne haussez pas les épaules avec un impatient dédain en me voyant écrire de telles choses à propos de moi-même ; cela me coûte, vous devez le croire ; mais la suite de ce récit vous prouvera que ces puérils détails, dont je sens le ridicule amer, sont malheureusement indispensables. Je ferme cette parenthèse, et je continue.)
– La princesse Amélie, reprit ma tante, dupe de cette innocente plaisanterie, partagea l'avis de son père sur l'expression douce et fière de votre physionomie, après avoir plus attentivement considéré le portrait. Plus tard, lorsque j'allai la voir à Gerolstein, elle me demanda, en souriant, des nouvelles de son cousin des temps passés. Je lui avouai alors notre supercherie, lui disant que le beau page du XVIe siècle était simplement mon neveu, le prince Henri d'Herkaüsen-Oldenzaal, actuellement âgé de vingt et un ans, capitaine aux gardes de S. M. l'empereur d'Autriche, et en tout, sauf le costume, fort ressemblant à son portrait. À ces mots, la princesse Amélie, ajouta ma tante, rougit et redevint sérieuse, comme elle l'est presque toujours. Depuis elle ne m'a naturellement jamais reparlé du tableau. Néanmoins, vous voyez, mon cher enfant, que vous ne serez pas complètement étranger et un nouveau visage pour votre cousine, comme dit le grand-duc. Ainsi donc, rassurez-vous, et soutenez l'honneur de votre portrait, ajouta ma tante en souriant.
Cette conversation avait eu lieu, je vous l'ai dit, mon cher Maximilien, la veille du jour où je devais être présenté à la princesse ma cousine ; je quittai ma tante, et je rentrai chez moi.
Je ne vous ai jamais caché mes plus secrètes pensées, bonnes ou mauvaises ; je vais donc vous avouer à quelles absurdes et folles imaginations je me laissai entraîner après l'entretien que je viens de vous rapporter.
II. Gerolstein (suite)
LE PRINCE HENRI D'HERKAUSEN-OLDENZAAL AU COMTE MAXIMILIEN KAMINETZ
Vous m'avez dit bien des fois, mon cher Maximilien, que j'étais dépourvu de toute vanité ; je le crois, j'ai besoin de le croire pour continuer ce récit sans m'exposer à passer à vos yeux pour un présomptueux.
Lorsque je fus seul chez moi, me rappelant l'entretien de ma tante, je ne pus m'empêcher de songer, avec une secrète satisfaction, que la princesse Amélie, ayant remarqué ce portrait de moi fait depuis six ou sept ans, avait quelques jours après demandé, en plaisantant, des nouvelles de son cousin des temps passés.
Rien n'était plus sot que de baser le moindre espoir sur une circonstance aussi insignifiante, j'en conviens ; mais, je vous l'ai dit, je serai comme toujours, envers vous, de la plus entière franchise : eh bien ! cette insignifiante circonstance me ravit. Sans doute, les louanges que j'avais entendu donner à la princesse Amélie par une femme aussi grave, aussi austère que ma tante, en élevant davantage la princesse à mes yeux, me rendaient plus sensible encore la distinction qu'elle avait daigné m'accorder, ou plutôt qu'elle avait accordée à mon portrait. Pourtant, que vous dirai-je ! cette distinction éveilla en moi des espérances si folles que, jetant à cette heure un regard plus calme sur le passé, je me demande comment j'ai pu me laisser entraîner à ces pensées qui aboutissaient inévitablement à un abîme.
Quoique parent du grand duc et toujours parfaitement accueilli de lui, il m'était impossible de concevoir la moindre espérance de mariage avec la princesse, lors même qu'elle eût agréé mon amour, ce qui était plus qu'improbable. Notre famille tient honorablement à son rang, mais elle est pauvre, si on compare notre fortune aux immenses domaines du grand-duc, le prince le plus riche de la Confédération germanique ; et puis enfin j'avais vingt et un ans à peine, j'étais simple capitaine aux gardes, sans renom, sans position personnelle ; jamais en un mot, le grand-duc ne pouvait songer à moi pour sa fille.
Toutes ces réflexions auraient dû me préserver d'une passion que je n'éprouvais pas encore, mais dont j'avais pour ainsi dire le singulier pressentiment. Hélas ! je m'abandonnai au contraire à de nouvelles puérilités. Je portais au doigt une bague qui m'avait été autrefois donnée par Thécla (la bonne comtesse que vous connaissez) : quoique ce gage d'un amour étourdi, facile et léger, ne pût me gêner beaucoup, j'en fis héroïquement le sacrifice à mon amour naissant, et le pauvre anneau disparut dans les eaux rapides de la rivière qui coule sous mes fenêtres.
Vous dire la nuit que je passai est inutile : vous la devinez. Je savais la princesse Amélie blonde et d'une angélique beauté : je tâchai de m'imaginer ses traits, sa taille, son maintien, le son de sa voix, l'expression de son regard ; puis, songeant à mon portrait qu'elle avait remarqué, je me rappelai à regret que l'artiste maudit m'avait dangereusement flatté ; de plus, je comparais avec désespoir le costume pittoresque du page du XVIe siècle au sévère uniforme du capitaine aux gardes de Sa Majesté Impériale. Puis, à ces niaises préoccupations succédaient çà et là, je vous l'assure, mon ami, quelques pensées généreuses, quelques nobles élans de l'âme ; je me sentais ému, oh ! profondément ému, au ressouvenir de cette adorable bonté de la princesse Amélie, qui appelait les pauvres abandonnées qu'elle protégeait ses sœurs, m'avait dit ma tante.
Enfin, bizarre et inexplicable contraste ! j'ai, vous le savez, la plus humble opinion de moi-même… et j'étais cependant assez glorieux pour supposer que la vue de mon portrait avait frappé la princesse ; j'avais assez de bon sens pour comprendre qu'une distance infranchissable me séparait d'elle à jamais, et cependant je me demandais avec une véritable anxiété si elle ne me trouverait pas trop indigne de mon portrait. Enfin je ne l'avais jamais vue, j'étais convaincu d'avance qu'elle me remarquerait à peine… et cependant je me croyais le droit de lui sacrifier le gage de mon premier amour.
Je passai dans de véritables angoisses la nuit dont je vous parle et une partie du lendemain. L'heure de la réception arriva. J'essayai deux ou trois habits d'uniforme, les trouvant plus mal faits les uns que les autres, et je partis pour le palais grand-ducal très-mécontent de moi.
Quoique Gerolstein soit à peine éloigné d'un quart de lieue de l'abbaye de Sainte-Hermangilde, durant ce court trajet mille pensées m'assaillirent, toutes les puérilités dont j'avais été si occupé disparurent devant une idée grave, triste, presque menaçante ; un invincible pressentiment m'annonçait une de ces crises qui dominent la vie tout entière, une sorte de révélation me disait que j'allais aimer, aimer passionnément, aimer comme on n'aime qu'une fois ; et, pour comble de fatalité, cet amour, aussi hautement que dignement placé, devait être pour moi toujours malheureux.
Ces idées m'effrayèrent tellement que je pris tout à coup la sage résolution de faire arrêter ma voiture, de revenir à l'abbaye et d'aller rejoindre mon père, laissant à ma tante le soin d'excuser mon brusque départ auprès du grand-duc.
Malheureusement une de ces causes vulgaires dont les effets sont quelquefois immenses m'empêcha d'exécuter mon premier dessein. Ma voiture étant arrêtée à l'entrée de l'avenue qui conduit au palais, je me penchais à la portière pour donner à mes gens ordre de retourner, lorsque le baron et la baronne Koller, qui, comme moi, se rendaient à la cour, m'aperçurent et firent aussi arrêter leur voiture. Le baron, me voyant en uniforme, me dit : « Pourrai-je vous être bon à quelque chose, mon cher prince ? Que vous arrive-t-il ? Puisque vous allez au palais, montez avec nous, dans le cas où un accident serait arrivé à vos chevaux. »
Rien ne m'était plus facile, n'est-ce pas, mon ami que de trouver une défaite pour quitter le baron et regagner l'abbaye. Eh bien ! soit impuissance, soit secret désir d'échapper à la détermination salutaire que je venais de prendre, je répondis d'un air embarrassé que je donnais ordre à mon cocher de s'informer à la grille du palais si l'on y entrait par le pavillon neuf ou par la cour de marbre.
– On entre par la cour de marbre, mon cher prince, me répondit le baron, car c'est une réception de grand gala. Dites à votre voiture de suivre la mienne, je vous indiquerai le chemin.
Vous savez, Maximilien, combien je suis fataliste ; je voulais retourner à l'abbaye pour m'épargner les chagrins que je pressentais ; le sort s'y opposait, je m'abandonnai à mon étoile. Vous ne connaissez pas le palais grand-ducal de Gerolstein, mon ami ? Selon tous ceux qui ont visité les capitales d'Europe, il n'est pas, à l'exception de Versailles, une résidence royale dont l'ensemble et les abords soient d'un aspect plus majestueux. Si j'entre dans quelques détails à ce sujet, c'est qu'en me souvenant à cette heure de ces imposantes splendeurs, je me demande comment elles ne m'ont pas tout d'abord rappelé à mon néant ; car enfin la princesse Amélie était fille du souverain maître de ce palais, de ces gardes, de ces richesses merveilleuses.
La cour de marbre, vaste hémicycle, est ainsi appelée parce qu'à l'exception d'un large chemin de ceinture où circulent les voitures, elle est dallée de marbres de toutes couleurs, formant de magnifiques mosaïques au centre desquelles se dessine un immense bassin revêtu de brèche antique, alimenté par d'abondantes eaux qui tombent incessamment d'une large vasque de porphyre.
Cette cour d'honneur est circulairement entourée d'une rangée de statues de marbre blanc du plus haut style, portant des torchères de bronze doré d'où jaillissent des flots de gaz éblouissant. Alternant avec ces statues, des vases Médicis, exhaussés sur leurs socles richement sculptés, renfermaient d'énormes lauriers-roses, véritables buissons fleuris, dont le feuillage lustré, vu aux lumières, resplendissait d'une verdure métallique.
Les voitures s'arrêtaient au pied d'une double rampe à balustres qui conduisait au péristyle du palais ; au pied de cet escalier se tenaient en vedette, montés sur leurs chevaux noirs, deux cavaliers du régiment des gardes du grand-duc, qui choisit ces soldats parmi les sous-officiers les plus grands de son armée. Vous, mon ami, qui aimez tant les gens de guerre, vous eussiez été frappé de la tournure sévère et martiale de ces deux colosses, dont la cuirasse et le casque d'acier d'un profil antique, sans cimier ni crinière, étincelaient aux lumières ; ces cavaliers portaient l'habit bleu à collet jaune, le pantalon de daim blanc et les bottes fortes montant au-dessus du genou. Enfin pour vous, mon ami, qui aimez ces détails militaires, j'ajouterai qu'au haut de l'escalier, de chaque côté de la porte, deux grenadiers du régiment d'infanterie de la garde grand-ducale étaient en faction. Leur tenue, sauf la couleur de l'habit et les revers, ressemblait, m'a-t-on dit, à celle des grenadiers de Napoléon.
Après avoir traversé le vestibule où se tenaient, hallebarde en main, les suisses de livrée du prince, je montai un imposant escalier de marbre blanc qui aboutissait à un portique orné de colonnes de jaspe et surmonté d'une coupole peinte et dorée. Là se trouvaient deux longues files de valets de pied. J'entrai ensuite dans la salle des gardes, à la porte de laquelle se tenaient toujours un chambellan et un aide de camp de service, chargés de conduire auprès de Son Altesse Royale les personnes qui avaient droit à lui être particulièrement présentées. Ma parenté, quoique éloignée, me valut cet honneur : un aide de camp me précéda dans une longue galerie remplie d'hommes en habit de cour ou d'uniforme, et de femmes en grande parure.
Pendant que je traversais lentement cette foule brillante, j'entendis quelques paroles qui augmentèrent encore mon émotion : de tous côtés on admirait l'angélique beauté de la princesse Amélie, les traits charmants de la marquise d'Harville, et l'air véritablement impérial de l'archiduchesse Sophie, qui, récemment arrivée de Munich avec l'archiduc Stanislas, allait bientôt repartir pour Varsovie ; mais, tout en rendant hommage à l'altière dignité de l'archiduchesse, à la gracieuse distinction de la marquise d'Harville, on reconnaissait que rien n'était plus idéal que la figure enchanteresse de la princesse Amélie.
À mesure que j'approchais de l'endroit où se tenaient le grand-duc et sa fille, je sentais mon cœur battre avec violence. Au moment où j'arrivai à la porte de ce salon (j'ai oublié de vous dire qu'il y avait bal et concert à la cour), l'illustre Liszt venait de se mettre au piano ; aussi le silence le plus recueilli succéda-t-il au léger murmure des conversations. En attendant la fin du morceau, que le grand artiste jouait avec sa supériorité accoutumée, je restai dans l'embrasure d'une porte.
Alors, mon cher Maximilien, pour la première fois je vis la princesse Amélie. Laissez-moi vous dépeindre cette scène, car j'éprouve un charme indicible à rassembler ces souvenirs.
Figurez-vous, mon ami, un vaste salon meublé avec une somptuosité royale, éblouissant de lumières et tendu d'étoffe de soie cramoisie, sur laquelle courait un feuillage d'or brodé en relief. Au premier rang, sur de grands fauteuils dorés, se tenait l'archiduchesse Sophie (le prince lui faisait les honneurs de son palais) ; à sa gauche Mme la marquise d'Harville, et à sa droite la princesse Amélie ; debout derrière elles était le grand-duc, portant l'uniforme de colonel de ses gardes ; il semblait rajeuni par le bonheur et ne pas avoir plus de trente ans ; l'habit militaire faisait encore valoir l'élégance de sa taille et la beauté de ses traits ; auprès de lui était l'archiduc Stanislas en costume de feld-maréchal, puis venaient ensuite les dames d'honneur de la princesse Amélie, les femmes des grands dignitaires de la cour, et enfin ceux-ci.
Ai-je besoin de vous dire que la princesse Amélie, moins encore par son rang que par sa grâce et sa beauté, dominait cette foule étincelante ? Ne me condamnez pas, mon ami, sans lire ce portrait. Quoiqu'il soit mille fois encore au-dessous de la réalité, vous comprendrez mon adoration, vous comprendrez que dès que je la vis je l'aimai, et que la rapidité de cette passion ne put être égalée que par sa violence et son éternité.
La princesse Amélie, vêtue d'une simple robe de moire blanche, portait, comme l'archiduchesse Sophie, le grand cordon de l'ordre impérial de Saint-Népomucène, qui lui avait été récemment envoyé par l'impératrice. Un bandeau de perles, entourant son front noble et candide, s'harmonisait à ravir avec les deux grosses nattes de cheveux d'un blond cendré magnifique qui encadraient ses joues légèrement rosées ; ses bras charmants, plus blancs encore que les flots de dentelle d'où ils sortaient, étaient à demi cachés par des gants qui s'arrêtaient au-dessous de son coude à fossette ; rien de plus accompli que sa taille, rien de plus joli que son pied chaussé de satin blanc. Au moment où je la vis, ses grands yeux, du plus pur azur, étaient rêveurs ; je ne sais même si à cet instant elle subissait l'influence de quelque pensée sérieuse, ou si elle était vivement impressionnée par la sombre harmonie du morceau que jouait Liszt ; mais son demi-sourire me parut d'une douceur et d'une mélancolie indicibles. La tête légèrement baissée sur sa poitrine, elle effeuillait machinalement un gros bouquet d'œillets blancs et de roses qu'elle tenait à la main.
Jamais je ne pourrai vous exprimer ce que je ressentis alors : tout ce que m'avait dit ma tante de l'ineffable bonté de la princesse Amélie me revint à la pensée… Souriez, mon ami… mais malgré moi je sentis mes yeux devenir humides en voyant rêveuse, presque triste, cette jeune fille si admirablement belle, entourée d'honneurs, de respects, et idolâtrée par un père tel que le grand-duc.
Maximilien, je vous l'ai souvent dit : de même que je crois l'homme incapable de goûter certains bonheurs pour ainsi dire trop complets, trop immenses pour ses facultés bornées, de même aussi je crois certains êtres trop divinement doués pour ne pas quelquefois sentir avec amertume combien ils sont esseulés ici-bas, et pour ne pas alors regretter vaguement leur exquise délicatesse, qui les expose à tant de déceptions, à tant de froissements ignorés des natures moins choisies… Il me semblait qu'alors la princesse Amélie éprouvait la réaction d'une pensée pareille.
Tout à coup, par un hasard étrange (tout est fatalité dans ceci), elle tourna machinalement les yeux du côté où je me trouvais.
Vous savez combien l'étiquette et la hiérarchie des rangs sont scrupuleusement observées chez nous. Grâce à mon titre et aux liens de parenté qui m'attachent au grand-duc, les personnes au milieu desquelles je m'étais d'abord placé s'étaient peu à peu reculées, de sorte que je restai presque seul et très-en évidence au premier rang, dans l'embrasure de la porte de la galerie.
Il fallut cette circonstance pour que la princesse Amélie, sortant de sa rêverie, m'aperçût et me remarquât sans doute, car elle fit un léger mouvement de surprise, et rougit.
Elle avait vu mon portrait à l'abbaye, chez ma tante, elle me reconnaissait : rien de plus simple. La princesse m'avait à peine regardé pendant une seconde, mais ce regard me fit éprouver une commotion violente, profonde : je sentis mes joues en feu, je baissai les yeux et je restai quelques minutes sans oser les lever de nouveau sur la princesse… Lorsque je m'y hasardai, elle causait tout bas avec l'archiduchesse Sophie, qui semblait l'écouter avec le plus affectueux intérêt.
Liszt ayant mis un intervalle de quelques minutes entre les deux morceaux qu'il devait jouer, le grand-duc profita de ce moment pour lui exprimer son admiration de la manière la plus gracieuse. Le prince, revenant à sa place, m'aperçut, me fit un signe de tête rempli de bienveillance et dit quelques mots à l'archiduchesse en me désignant du regard. Celle-ci, après m'avoir un instant considéré, se retourna vers le grand-duc, qui ne put s'empêcher de sourire en lui répondant et en adressant la parole à sa fille. La princesse Amélie me parut embarrassée, car elle rougit de nouveau.
J'étais au supplice ; malheureusement l'étiquette ne me permettait pas de quitter la place où je me trouvais avant la fin du concert, qui recommença bientôt. Deux ou trois fois je regardai la princesse Amélie à la dérobée ; elle me sembla pensive et attristée ; mon cœur se serra ; je souffrais de la légère contrariété que je venais de lui causer involontairement, et que je croyais deviner. Sans doute le grand-duc lui avait demandé en plaisantant si elle me trouvait quelque ressemblance avec le portrait de son cousin des temps passés ; et, dans son ingénuité, elle se reprochait peut-être de n'avoir pas dit à son père qu'elle m'avait déjà reconnu. Le concert terminé, je suivis l'aide de camp de service ; il me conduisit auprès du grand-duc, qui voulut bien faire quelques pas au-devant de moi, me prit cordialement par le bras et dit à l'archiduchesse Sophie, en s'approchant d'elle :
– Je demande à Votre Altesse Impériale la permission de lui présenter mon cousin le prince Henri d'Herkaüsen-Oldenzaal.
– J'ai déjà vu le prince à Vienne, et je le retrouve ici avec plaisir, répondit l'archiduchesse, devant laquelle je m'inclinai profondément.
– Ma chère Amélie, reprit le prince en s'adressant à sa fille, je vous présente le prince Henri, votre cousin ; il est fils du prince Paul, l'un de mes plus vénérables amis, que je regrette bien de ne pas voir aujourd'hui à Gerolstein.
– Voudriez-vous, monsieur, faire savoir au prince Paul que je partage vivement les regrets de mon père, car je serai toujours bien heureuse de connaître ses amis, me répondit ma cousine avec une simplicité pleine de grâce…
Je n'avais jamais entendu le son de la voix de la princesse ; imaginez-vous, mon ami, le timbre le plus doux, le plus frais, le plus harmonieux, enfin un de ces accents qui font vibrer les cordes les plus délicates de l'âme.
– J'espère, mon cher Henri, que vous resterez quelque temps chez votre tante que j'aime, que je respecte comme ma mère, vous le savez, me dit le grand-duc avec bonté. Venez souvent nous voir en famille, à la fin de la matinée, sur les trois heures : si nous sortons, vous partagerez notre promenade ; vous savez que je vous ai toujours aimé, parce que vous êtes un des plus nobles cœurs que je connaisse.
– Je ne sais comment exprimer à Votre Altesse Royale ma reconnaissance pour le bienveillant accueil qu'elle daigne me faire.
– Eh bien ! pour me prouver votre reconnaissance, dit le prince en souriant, invitez votre cousine pour la deuxième contredanse, car la première appartient de droit à l'archiduc…
– Votre Altesse voudra-t-elle m'accorder cette grâce ?… dis-je à la princesse Amélie en m'inclinant devant elle.
– Appelez-vous simplement cousin et cousine, selon la bonne vieille coutume allemande, dit gaiement le grand-duc ; le cérémonial ne convient pas entre parents.
– Ma cousine me fera-t-elle l'honneur de danser cette contredanse avec moi ?
– Oui, mon cousin, me répondit la princesse Amélie.
III. Gerolstein (suite et fin)
LE PRINCE HENRI D'HERKAUSEN-OLDENZAAL AU COMTE MAXIMILIEN KAMINETZ
Je ne saurais vous dire, mon ami, combien je fus à la fois heureux et peiné de la paternelle cordialité du grand-duc ; la confiance qu'il me témoignait, l'affectueuse bonté avec laquelle il avait engagé sa fille et moi à substituer aux formules de l'étiquette ces appellations de famille d'une intimité si douce, tout me pénétrait de reconnaissance ; je me reprochais d'autant plus amèrement le charme fatal d'un amour qui ne devait ni ne pouvait être agréé par le prince.
Je m'étais promis, il est vrai (je n'ai pas failli à cette résolution) de ne jamais dire un mot qui pût faire soupçonner à ma cousine l'amour que je ressentais ; mais je craignais que mon émotion, que mes regards me trahissent… Malgré moi pourtant, ce sentiment, si muet, si caché qu'il dût être, me semblait coupable.
J'eus le temps de faire ces réflexions pendant que la princesse Amélie dansait la première contredanse avec l'archiduc Stanislas. Ici, comme partout, la danse n'est plus qu'une sorte de marche qui suit la mesure de l'orchestre ; rien ne pouvait faire valoir davantage la grâce sérieuse du maintien de ma cousine.
J'attendais avec un bonheur mêlé d'anxiété le moment d'entretien que la liberté du bal allait me permettre d'avoir avec elle. Je fus assez maître de moi pour cacher mon trouble lorsque j'allai la chercher auprès de la marquise d'Harville.
En songeant aux circonstances du portrait, je m'attendais à voir la princesse Amélie partager mon embarras ; je ne me trompais pas. Je me souviens presque mot pour mot de notre première conversation ; laissez-moi vous la rapporter, mon ami :
– Votre Altesse me permettra-t-elle, lui dis-je, de l'appeler ma cousine, ainsi que le grand-duc m'y autorise ?
– Sans doute, mon cousin, me répondit-elle avec grâce ; je suis toujours heureuse d'obéir à mon père.
– Et je suis d'autant plus fier de cette familiarité, ma cousine, que j'ai appris par ma tante à vous connaître, c'est-à-dire à vous apprécier.
– Souvent aussi mon père m'a parlé de vous, mon cousin, et ce qui vous étonnera peut-être, ajouta-t-elle timidement, c'est que je vous connaissais déjà, si cela peut se dire, de vue… Mme la supérieure de Sainte-Hermangilde, pour qui j'ai la plus respectueuse affection, nous avait un jour montré, à mon père, et à moi, un portrait…
– Où j'étais représenté en page du XVIe siècle ?
– Oui, mon cousin ; et mon père fit même la petite supercherie de me dire que ce portrait était celui d'un de nos parents du temps passé, en ajoutant d'ailleurs des paroles si bienveillantes pour ce cousin d'autrefois que notre famille doit se féliciter de le compter parmi nos parents d'aujourd'hui…
– Hélas ! ma cousine, je crains de ne pas plus ressembler au portrait moral que le grand-duc a daigné faire de moi qu'au page du XVIe siècle.
– Vous vous trompez, mon cousin, me dit naïvement la princesse ; car, à la fin du concert, en jetant par hasard les yeux du côté de la galerie, je vous ai reconnu tout de suite, malgré la différence du costume.
Puis, voulant changer sans doute un sujet de conversation qui l'embarrassait, elle me dit :
– Quel admirable talent que celui de M. Liszt, n'est-ce pas ?
– Admirable. Avec quel plaisir vous l'écoutiez !
– C'est qu'en effet il y a, ce me semble, un double charme dans la musique sans paroles : non-seulement on jouit d'une excellente exécution, mais on peut appliquer sa pensée du moment aux mélodies que l'on écoute, et qui en deviennent pour ainsi dire l'accompagnement… Je ne sais si vous me comprenez, mon cousin ?
– Parfaitement. Les pensées sont alors des paroles que l'on met mentalement sur l'air que l'on entend.
– C'est cela, c'est cela, vous me comprenez, dit-elle avec un mouvement de gracieuse satisfaction ; je craignais de mal expliquer ce que je ressentais tout à l'heure pendant cette mélodie si plaintive et si touchante.
– Grâce à Dieu, ma cousine, lui dis-je en souriant, vous n'avez aucune parole à mettre sur un air triste.
Soit que ma question fût indiscrète et qu'elle voulût éviter d'y répondre, soit qu'elle ne l'eût pas entendue, tout à coup la princesse Amélie me dit, en me montrant le grand-duc, qui, donnant le bras à l'archiduchesse Sophie, traversait alors la galerie où l'on dansait :
– Mon cousin, voyez donc mon père, comme il est beau !… Quel air noble et bon ! Comme tous les regards le suivent avec sollicitude ! Il me semble qu'on l'aime encore plus qu'on ne le révère…
– Ah ! m'écriai-je, ce n'est pas seulement ici, au milieu de sa cour, qu'il est chéri ! Si les bénédictions du peuple retentissaient dans la postérité, le nom de Rodolphe de Gerolstein serait justement immortel.
En parlant ainsi, mon exaltation était sincère ; car vous savez, mon ami, qu'on appelle, à bon droit, les États du prince le Paradis de l'Allemagne.
Il m'est impossible de vous peindre le regard reconnaissant que ma cousine jeta sur moi en m'entendant parler de la sorte.
– Apprécier ainsi mon père, me dit-elle avec émotion, c'est être bien digne de l'attachement qu'il vous porte.
– C'est que personne plus que moi ne l'aime et l'admire ! En outre des rares qualités qui font les grands princes, n'a-t-il pas le génie de la bonté, qui fait les princes adorés ?…
– Vous ne savez pas combien vous dites vrai !… s'écria la princesse encore plus émue.
– Oh ! je le sais, je le sais, et tous ceux qu'il gouverne le savent comme moi… On l'aime tant que l'on s'affligerait de ses chagrins comme on se réjouit de son bonheur ; l'empressement de tous à venir offrir leurs hommages à Mme la marquise d'Harville consacre à la fois et le choix de Son Altesse Royale et la valeur de la future grande-duchesse.
– Mme la marquise d'Harville est plus digne que qui que ce soit de l'attachement de mon père ; c'est le plus bel éloge que je puisse vous faire d'elle.
– Et vous pouvez sans doute l'apprécier justement : car vous l'avez probablement connue en France, ma cousine ?
À peine avais-je prononcé ces derniers mots, que je ne sais quelle soudaine pensée vint à l'esprit de la princesse Amélie ; elle baissa les yeux, et, pendant une seconde, ses traits prirent une expression de tristesse qui me rendit muet de surprise.
Nous étions alors à la fin de la contredanse, la dernière figure me sépara un instant de ma cousine ; lorsque je la reconduisis auprès de Mme d'Harville, il me sembla que ses traits étaient encore légèrement altérés…
Je crus et je crois encore que mon allusion au séjour de la princesse en France, lui ayant rappelé la mort de sa mère, lui causa l'impression pénible dont je viens de vous parler.
Pendant cette soirée, je remarquai une circonstance qui vous paraîtra puérile, mais qui m'a été une nouvelle preuve de l'intérêt que cette jeune fille inspire à tous. Son bandeau de perles s'étant un peu dérangé, l'archiduchesse Sophie, à qui elle donnait alors le bras, eut la bonté de vouloir lui replacer elle-même ce bijou sur le front. Or, pour qui connaît la hauteur proverbiale de l'archiduchesse, une telle prévenance de sa part semble à peine croyable. Du reste, la princesse Amélie, que j'observais attentivement à ce moment, parut à la fois si confuse, si reconnaissante, je dirais presque si embarrassée de cette gracieuse attention, que je crus voir briller une larme dans ses yeux.
Telle fut, mon ami, ma première soirée à Gerolstein. Si je vous l'ai racontée avec tant de détails, c'est que presque toutes ces circonstances ont eu plus tard pour moi leurs conséquences.
Maintenant, j'abrégerai ; je ne vous parlerai que de quelques faits principaux relatifs à mes fréquentes entrevues avec ma cousine et son père.
Le surlendemain de cette fête, je fus du très-petit nombre de personnes invitées à la célébration du mariage du grand-duc avec Mme la marquise d'Harville. Jamais je ne vis la physionomie de la princesse Amélie plus radieuse et plus sereine que pendant cette cérémonie. Elle contemplait son père et la marquise avec une sorte de religieux ravissement qui donnait un nouveau charme à ses traits ; on eût dit qu'ils reflétaient le bonheur ineffable du prince et de Mme d'Harville.
Ce jour-là, ma cousine fut très-gaie, très-causante. Je lui donnai le bras dans une promenade que l'on fit après dîner dans les jardins du palais, magnifiquement illuminés. Elle me dit, à propos du mariage de son père :
– Il me semble que le bonheur de ceux que nous chérissons nous est encore plus doux que notre propre bonheur ; car il y a toujours une nuance d'égoïsme dans la jouissance de notre félicité personnelle.
Si je vous cite entre mille cette réflexion de ma cousine, mon ami, c'est pour que vous jugiez du cœur de cette créature adorable, qui a, comme son père, le génie de la bonté.
Quelques jours après le mariage du grand-duc, j'eus avec lui une assez longue conversation ; il m'interrogea sur le passé, sur mes projets d'avenir ; il me donna les conseils les plus sages, les encouragements les plus flatteurs, me parla même de plusieurs de ses projets de gouvernement avec une confiance dont je fus aussi fier que flatté ; enfin, que vous dirai-je ? un moment, l'idée la plus folle me traversa l'esprit : je crus que le prince avait deviné mon amour, et que dans cet entretien il voulait m'étudier, me pressentir, et peut-être m'amener à un aveu…
Malheureusement, cet espoir insensé ne dura pas longtemps : le prince termina la conversation en me disant que le temps des grandes guerres était fini ; que je devais profiter de mon nom, de mes alliances, de l'éducation que j'avais reçue et de l'étroite amitié qui unissait mon père au prince de M. Premier ministre de l'empereur, pour parcourir la carrière diplomatique au lieu de la carrière militaire, ajoutant que toutes les questions qui se décidaient autrefois sur les champs de bataille se décideraient désormais dans les congrès ; que bientôt les traditions tortueuses et perfides de l'ancienne diplomatie feraient place à une politique large et humaine, en rapport avec les véritables intérêts des peuples, qui de jour en jour avaient davantage la conscience de leurs droits ; qu'un esprit élevé, loyal et généreux pourrait avoir avant quelques années un noble et grand rôle à jouer dans les affaires politiques, et faire ainsi beaucoup de bien. Il me proposait enfin le concours de sa souveraine protection pour me faciliter les abords de la carrière qu'il m'engageait instamment à parcourir.
Vous comprenez, mon ami, que si le prince avait eu le moindre projet sur moi, il ne m'eût pas fait de telles ouvertures. Je le remerciai de ses offres avec une vive reconnaissance, en ajoutant que je sentais tout le prix de ses conseils, et que j'étais décidé à les suivre.
J'avais d'abord mis la plus grande réserve dans mes visites au palais ; mais, grâce à l'insistance du grand-duc, j'y vins bientôt presque chaque jour vers les trois heures. On y vivait dans toute la charmante simplicité de nos cours germaniques. C'était la vie des grands châteaux d'Angleterre, rendue plus attrayante par la simplicité cordiale, la douce liberté des mœurs allemandes. Lorsque le temps le permettait, nous faisions de longues promenades à cheval avec le grand-duc, la grande-duchesse, ma cousine, et les personnes de leur maison. Lorsque nous restions au palais, nous nous occupions de musique, je chantais avec la grande-duchesse et ma cousine, dont la voix avait un timbre d'une pureté, d'une suavité sans égales, et que je n'ai jamais pu entendre sans me sentir remué jusqu'au fond de l'âme. D'autres fois, nous visitions en détail les merveilleuses collections de tableaux et d'objets d'art, ou les admirables bibliothèques du prince, qui, vous le savez, est un des hommes les plus savants et les plus éclairés de l'Europe ; assez souvent je revenais dîner au palais, et, les jours d'Opéra, j'accompagnais au théâtre la famille grand-ducale.
Chaque jour passait comme un songe ; peu à peu ma cousine me traita avec une familiarité toute fraternelle ; elle ne me cachait pas le plaisir qu'elle éprouvait à me voir, elle me confiait tout ce qui l'intéressait ; deux ou trois fois elle me pria de l'accompagner lorsqu'elle allait avec la grande-duchesse visiter ses jeunes orphelines ; souvent aussi elle me parlait de mon avenir avec une maturité de raison, avec un intérêt sérieux et réfléchi qui me confondait de la part d'une jeune fille de son âge ; elle aimait aussi beaucoup à s'informer de mon enfance, de ma mère, hélas ! toujours si regrettée. Chaque fois que j'écrivais à mon père, elle me priait de la rappeler à son souvenir ; puis, comme elle brodait à ravir, elle me remit un jour pour lui une charmante tapisserie à laquelle elle avait longtemps travaillé. Que vous dirai-je, mon ami ? un frère et une sœur, se retrouvant après de longues années de séparation, n'eussent pas joui d'une intimité plus douce. Du reste, lorsque, par le plus grand des hasards, nous restions seuls, l'arrivée d'un tiers ne pouvait jamais changer le sujet ou même l'accent de notre conversation.
Vous vous étonnerez peut-être, mon ami, de cette fraternité entre deux jeunes gens, surtout en songeant aux aveux que je vous fais ; mais plus ma cousine me témoignait de confiance et de familiarité, plus je m'observais, plus je me contraignais, de peur de voir cesser cette adorable familiarité. Et puis, ce qui augmentait encore ma réserve, c'est que la princesse mettait dans ses relations avec moi tant de franchise, tant de noble confiance, et surtout si peu de coquetterie, que je suis presque certain qu'elle a toujours ignoré ma violente passion. Il me reste un léger doute à ce sujet, à propos d'une circonstance que je vous raconterai tout à l'heure.
Si cette intimité fraternelle avait dû toujours durer, peut-être ce bonheur m'eût suffi ; mais par cela même que j'en jouissais avec délices, je songeais que bientôt mon service ou la carrière que le prince m'engageait à parcourir m'appellerait à Vienne ou à l'étranger ; je songeais enfin que prochainement peut-être le grand-duc penserait à marier sa fille d'une manière digne d'elle…
Ces pensées me devinrent d'autant plus pénibles que le moment de mon départ approchait. Ma cousine remarqua bientôt le changement qui s'était opéré en moi. La veille du jour où je la quittai, elle me dit que depuis quelque temps, elle me trouvait sombre, préoccupée. Je tâchai d'éluder ces questions, j'attribuai ma tristesse à un vague ennui.
– Je ne puis vous croire, me dit-elle ; mon père vous traite presque comme un fils, tout le monde vous aime ; vous trouver malheureux serait de l'ingratitude.
– Eh bien ! lui dis-je sans pouvoir vaincre mon émotion, ce n'est pas de l'ennui, c'est du chagrin, oui, c'est un profond chagrin que j'éprouve.
– Et pourquoi ? Que vous est-il arrivé ? me demanda-t-elle avec intérêt.
– Tout à l'heure, ma cousine, vous m'avez dit que votre père me traitait comme un fils… qu'ici tout le monde m'aimait… Eh bien ! avant peu il me faudra renoncer à ces affections si précieuses, il faudra enfin… quitter Gerolstein, et je vous l'avoue, cette pensée me désespère.
– Et le souvenir de ceux qui nous sont chers… n'est-ce donc rien, mon cousin ?
– Sans doute… mais les années, mais les événements amènent tant de changements imprévus !
– Il est du moins des affections qui ne sont pas changeantes : celle que mon père vous a toujours témoignée… celle que je ressens pour vous est de ce nombre, vous le savez bien ; on est frère et sœur… pour ne jamais s'oublier, ajouta-t-elle en levant sur moi ses grands yeux bleus humides de larmes.
Ce regard me bouleversa, je fus sur le point de me trahir ; heureusement je me contins.
– Il est vrai que les affections durent, lui dis-je avec embarras ; mais les positions changent… Ainsi, ma cousine, quand je reviendrai dans quelques années, croyez-vous qu'alors cette intimité, dont j'apprécie tout le charme, puisse encore durer ?
– Pourquoi ne durerait-elle pas ?
– C'est qu'alors vous serez sans doute mariée, ma cousine… vous aurez d'autres devoirs… et vous aurez oublié votre pauvre frère.
Je vous le jure, mon ami, je ne lui dis rien de plus ; j'ignore encore si elle vit dans ces mots un aveu qui l'offensa, ou si elle fut comme moi douloureusement frappée des changements inévitables que l'avenir devait nécessairement apporter à nos relations ; mais, au lieu de me répondre, elle resta un moment silencieuse, accablée ; puis, se levant brusquement, la figure pâle, altérée, elle sortit après avoir regardé pendant quelques secondes la tapisserie de la jeune comtesse d'Oppenheim, une de ses dames d'honneur, qui travaillait dans l'embrasure d'une des fenêtres du salon où avait lieu notre entretien.
Le soir même de ce jour, je reçus de mon père une nouvelle lettre qui me rappelait précipitamment ici. Le lendemain matin j'allai prendre congé du grand-duc ; il me dit que ma cousine était un peu souffrante, qu'il se chargerait de mes adieux pour elle ; il me serra paternellement dans ses bras, regrettant, ajouta-t-il, mon prompt départ, et surtout que ce départ fût causé par les inquiétudes que me donnait la santé de mon père ; puis, me rappelant avec la plus grande bonté ses conseils au sujet de la nouvelle carrière qu'il m'engageait très-instamment à embrasser, il ajouta qu'au retour de mes missions, ou pendant mes congés, il me reverrait toujours à Gerolstein avec un vif plaisir.
Heureusement, à mon arrivée ici, je trouvai l'état de mon père un peu amélioré ; il est encore alité, et toujours d'une grande faiblesse, mais il ne me donne plus d'inquiétude sérieuse. Malheureusement il s'est aperçu de mon abattement, de ma sombre taciturnité ; plusieurs fois, mais en vain, il m'a déjà supplié de lui confier la cause de mon morne chagrin. Je n'oserais, malgré son aveugle tendresse pour moi ; vous savez sa sévérité au sujet de tout ce qui lui paraît manquer de franchise et de loyauté.
Hier je le veillais ; seul auprès de lui, le croyant endormi, je n'avais pu retenir mes larmes, qui coulaient silencieusement en songeant à mes beaux jours de Gerolstein. Il me vit pleurer, car il sommeillait à peine, et j'étais complètement absorbé par ma douleur ; il m'interrogea avec la plus touchante bonté ; j'attribuai ma tristesse aux inquiétudes que m'avait données sa santé, mais, il ne fut pas dupe de cette défaite.
Maintenant que vous savez tout, mon bon Maximilien, dites, mon sort est-il assez désespéré ?… Que faire ?… Que résoudre ?…
Ah ! mon ami, je ne puis vous dire mon angoisse. Que va-t-il arriver, mon Dieu ?… Tout est à jamais perdu ! Je suis le plus malheureux des hommes, si mon père ne renonce pas à son projet.
Voici ce qui vient d'arriver :
Tout à l'heure, je terminais cette lettre, lorsqu'à mon grand étonnement, mon père, que je croyais couché, est entré dans son cabinet, où je vous écrivais ; il vit sur son bureau mes quatre premières grandes pages déjà remplies, j'étais à la fin de celle-ci.
– À qui écris-tu si longuement ? me demanda-t-il en souriant.
– À Maximilien, mon père.
– Oh ! me dit-il avec une expression d'affectueux reproche, je sais qu'il a toute ta confiance… Il est bien heureux, lui !
Il prononça ces derniers mots d'un ton si douloureusement navré que, touché de son accent, je lui répondis en lui donnant ma lettre presque sans réflexion :
– Lisez, mon père…
Mon ami, il a tout lu. Savez-vous ce qu'il m'a dit ensuite, après être resté quelque temps méditatif ?
– Henri, je vais écrire au grand-duc ce qui s'est passé pendant votre séjour à Gerolstein.
– Mon père, je vous en conjure, ne faites pas cela.
– Ce que vous racontez à Maximilien est-il scrupuleusement vrai ?
– Oui, mon père.
– En ce cas, jusqu'ici votre conduite a été loyale… Le prince l'appréciera. Mais il ne faut pas qu'à l'avenir vous vous montriez indigne de sa noble confiance, ce qui arriverait si, abusant de son offre, vous retourniez plus tard à Gerolstein dans l'intention peut-être de vous faire aimer de sa fille.
– Mon père… pouvez-vous penser… ?
– Je pense que vous aimez avec passion, et que la passion est tôt ou tard une mauvaise conseillère.
– Comment ! mon père, vous écrirez au prince que…
– Que vous aimez éperdument votre cousine.
– Au nom du ciel ! mon père, je vous en supplie, n'en faites rien !
– Aimez-vous votre cousine ?
– Je l'aime avec idolâtrie, mais…
Mon père m'interrompit.
– En ce cas, je vais écrire au grand-duc et lui demander pour vous la main de sa fille…
– Mais, mon père, une telle prétention est insensée de ma part !
– Il est vrai… Néanmoins je dois faire franchement cette demande au prince, en lui exposant les raisons qui m'imposent cette démarche. Il vous a accueilli avec la plus loyale hospitalité, il s'est montré pour vous d'une bonté paternelle, il serait indigne de moi et de vous de le tromper. Je connais l'élévation de son âme, il sera sensible à mon procédé d'honnête homme ; s'il refuse de vous donner sa fille, comme cela est presque indubitable, il saura du moins qu'à l'avenir, si vous retourniez à Gerolstein, vous ne devez plus vivre avec elle dans la même intimité. Vous m'avez, mon enfant, ajouta mon père avec bonté, librement montré la lettre que vous écriviez à Maximilien. Je suis maintenant instruit de tout ; il est de mon devoir d'écrire au grand-duc… et je vais lui écrire à l'instant même.
Vous le savez, mon ami, mon père est le meilleur des hommes, mais il est d'une inflexible ténacité de volonté lorsqu'il s'agit de ce qu'il regarde comme son devoir ; jugez de mes angoisses, de mes craintes. Quoique la démarche qu'il va tenter soit, après tout, franche et honorable, elle ne m'en inquiète pas moins. Comment le grand-duc accueillera-t-il cette folle demande ? N'en sera-t-il pas choqué, et la princesse Amélie ne sera-t-elle pas aussi blessée que j'aie laissé mon père prendre une résolution pareille sans son agrément ?
Ah ! mon ami, plaignez-moi, je ne sais que penser. Il me semble que je contemple un abîme et que le vertige me saisit…
Je termine à la hâte cette longue lettre ; bientôt je vous écrirai. Encore une fois, plaignez-moi, car en vérité je crains de devenir fou si la fièvre qui m'agite dure longtemps encore. Adieu, adieu, tout à vous de cœur et à toujours.
HENRI D'H. O.
Maintenant nous conduirons le lecteur au palais de Gerolstein, habité par Fleur-de-Marie depuis son retour de France.
IV. La princesse Amélie
L'appartement occupé par Fleur-de-Marie (nous ne l'appellerons la princesse Amélie qu'officiellement) dans le palais grand-ducal avait été meublé, par les soins de Rodolphe, avec un goût et une élégance extrêmes.
Du balcon de l'oratoire de la jeune fille on découvrait au loin les deux tours du couvent de Sainte-Hermangilde, qui, dominant d'immenses massifs de verdure, étaient elles-mêmes dominées par une haute montagne boisée, au pied de laquelle s'élevait l'abbaye. Par une belle matinée d'été, Fleur-de-Marie laissait errer ses regards sur ce splendide paysage qui s'étendait au loin. Coiffée en cheveux, elle portait une robe montante d'étoffe printanière blanche à petites raies bleues ; un large col de batiste très-simple, rabattu sur ses épaules, laissait voir les deux bouts et le nœud d'une petite cravate de soie du même bleu que la ceinture de sa robe.
Assise dans un grand fauteuil d'ébène sculpté, à haut dossier de velours cramoisi, le coude soutenu par un des bras de ce siège, la tête un peu baissée, elle appuyait sa joue sur le revers de sa petite main blanche, légèrement veinée d'azur.
L'attitude languissante de Fleur-de-Marie, sa pâleur, la fixité de son regard, l'amertume de son demi-sourire révélaient une mélancolie profonde.
Au bout de quelques moments, un soupir profond, douloureux, souleva son sein. Laissant alors retomber la main où elle appuyait sa joue, elle inclina davantage encore sa tête sur sa poitrine. On eût dit que l'infortunée se courbait sous le poids de quelque grand malheur.
À cet instant une femme d'un âge mûr, d'une physionomie grave et distinguée, vêtue avec une élégante simplicité, entra presque timidement dans l'oratoire et toussa légèrement pour attirer l'attention de Fleur-de-Marie.
Celle-ci, sortant de sa rêverie, releva vivement la tête et dit en saluant avec un mouvement plein de grâce :
– Que voulez-vous, ma chère comtesse ?
– Je viens prévenir Votre Altesse que monseigneur la prie de l'attendre ; car il va se rendre ici dans quelques minutes, répondit la dame d'honneur de la princesse Amélie avec une formalité respectueuse.
– Aussi je m'étonnais de n'avoir pas encore embrassé mon père aujourd'hui ; j'attends avec tant d'impatience sa visite de chaque matin !… Mais j'espère que je ne dois pas à une indisposition de Mlle d'Harneim le plaisir de vous voir deux jours de suite au palais, ma chère comtesse ?
– Que Votre Altesse n'ait aucune inquiétude à ce sujet ; Mlle d'Harneim m'a priée de la remplacer aujourd'hui ; demain elle aura l'honneur de reprendre son service auprès de Votre Altesse, qui daignera peut-être excuser ce changement.
– Certainement, car je n'y perdrai rien ; après avoir eu le plaisir de vous voir deux jours de suite, ma chère comtesse, j'aurai pendant deux autres jours Mlle d'Harneim auprès de moi.
– Votre Altesse nous comble, répondit la dame d'honneur en s'inclinant de nouveau ; son extrême bienveillance m'encourage à lui demander une grâce !
– Parlez… parlez ; vous connaissez mon empressement à vous être agréable…
– Il est vrai que depuis longtemps Votre Altesse m'a habituée à ses bontés ; mais il s'agit d'un sujet tellement pénible, que je n'aurais pas le courage de l'aborder, s'il ne s'agissait d'une action très-méritante ; aussi j'ose compter sur l'indulgence extrême de Votre Altesse.
– Vous n'avez nullement besoin de mon indulgence, ma chère comtesse ; je suis toujours très-reconnaissante des occasions que l'on me donne de faire un peu de bien.
– Il s'agit d'une pauvre créature qui malheureusement avait quitté Gerolstein avant que Votre Altesse eût fondé son œuvre si utile et si charitable pour les jeunes filles orphelines ou abandonnées, que rien ne défend contre les mauvaises passions.
– Et qu'a-t-elle fait ? Que réclamez-vous pour elle ?
– Son père, homme très-aventureux, avait été chercher fortune en Amérique, laissant sa femme et sa fille dans une existence assez précaire. La mère mourut ; la fille, âgée de seize ans à peine, livrée à elle-même, quitta le pays pour suivre à Vienne un séducteur, qui la délaissa bientôt. Ainsi que cela arrive toujours, ce premier pas dans le sentier du vice conduisit cette malheureuse à un abîme d'infamie ; en peu de temps elle devint, comme tant d'autres misérables, l'opprobre de son sexe…
Fleur-de-Marie baissa les yeux, rougit et ne put cacher un léger tressaillement qui n'échappa pas à sa dame d'honneur. Celle-ci, craignant d'avoir blessé la chaste susceptibilité de la princesse en l'entretenant d'une telle créature, reprit avec embarras :
– Je demande mille pardons à Votre Altesse, je l'ai choquée sans doute, en attirant son attention sur une existence si flétrie ; mais l'infortunée manifeste un repentir si sincère… que j'ai cru pouvoir solliciter pour elle un peu de pitié.
– Et vous avez eu raison. Continuez… je vous en prie, dit Fleur-de-Marie en surmontant sa douloureuse émotion ; tous les égarements sont en effet dignes de pitié, lorsque le repentir leur succède.
– C'est ce qui est arrivé dans cette circonstance, ainsi que je l'ai fait observer à Votre Altesse. Après deux années de cette vie abominable, la grâce toucha cette abandonnée… Saisie d'un tardif remords, elle est revenue ici. Le hasard a fait qu'en arrivant elle a été se loger dans une maison qui appartient à une digne veuve, dont la douceur et la pitié sont populaires. Encouragée par la pieuse bonté de la veuve, la pauvre créature lui a avoué ses fautes, ajoutant qu'elle ressentait une juste horreur pour sa vie passée, et qu'elle achèterait au prix de la pénitence la plus rude le bonheur d'entrer dans une maison religieuse où elle pourrait expier ses égarements et mériter leur rédemption. La digne veuve à qui elle fit cette confidence, sachant que j'avais l'honneur d'appartenir à Votre Altesse, m'a écrit pour me recommander cette malheureuse qui, par la toute-puissante intervention de Votre Altesse auprès de la princesse Juliane, supérieure de l'abbaye, pourrait espérer d'entrer sœur converse au couvent de Sainte-Hermangilde ; elle demande comme une faveur d'être employée aux travaux les plus pénibles, pour que sa pénitence soit plus méritoire. J'ai voulu entretenir plusieurs fois cette femme avant de me permettre d'implorer pour elle la pitié de Votre Altesse, et je suis fermement convaincue que son repentir sera durable. Ce n'est ni le besoin ni l'âge qui la ramène au bien ; elle a dix-huit ans à peine, elle est très-belle encore, et possède une petite somme d'argent qu'elle veut affecter à une œuvre charitable, si elle obtient la faveur qu'elle sollicite.
– Je me charge de votre protégée, dit Fleur-de-Marie en contenant difficilement son trouble, tant sa vie passée offrait de ressemblance avec celle de la malheureuse en faveur de qui on la sollicitait ; puis elle ajouta : Le repentir de cette infortunée est trop louable pour ne pas l'encourager.
– Je ne sais comment exprimer ma reconnaissance à Votre Altesse. J'osais à peine espérer qu'elle daignât s'intéresser si charitablement à une pareille créature…
– Elle a été coupable, elle se repent…, dit Fleur-de-Marie avec un accent de commisération et de tristesse indicible ; il est juste d'avoir pitié d'elle… Plus ses remords sont sincères, plus ils doivent être douloureux, ma chère comtesse…
– J'entends, je crois, monseigneur, dit tout à coup la dame d'honneur sans remarquer l'émotion profonde et croissante de Fleur-de-Marie.
En effet, Rodolphe entra dans un salon qui précédait l'oratoire, tenant à la main un énorme bouquet de roses.
À la vue du prince, la comtesse se retira discrètement. À peine eut-elle disparu que Fleur-de-Marie se jeta au cou de son père, appuya son front sur son épaule et resta ainsi quelques secondes sans parler.
– Bonjour… bonjour, mon enfant chérie, dit Rodolphe en serrant sa fille dans ses bras avec effusion sans s'apercevoir encore de sa tristesse. Vois donc ce buisson de roses… quelle belle moisson j'ai faite ce matin pour toi ! C'est ce qui m'a empêché de venir plus tôt. J'espère que je ne t'ai jamais apporté un plus magnifique bouquet… Tiens.
Et le prince, ayant toujours son bouquet à la main, fit un léger mouvement en arrière pour se dégager des bras de sa fille et la regarder ; mais, la voyant fondre en larmes, il jeta le bouquet sur une table, prit les mains de Fleur-de-Marie dans les siennes et s'écria :
– Tu pleures, mon Dieu ! qu'as-tu donc ?
– Rien… rien… mon bon père…, dit Fleur-de-Marie en essuyant ses larmes et tâchant de sourire à Rodolphe.
– Je t'en conjure, dis-moi ce que tu as… Qui peut t'avoir attristée ?
– Je vous assure, mon père, qu'il n'y a pas de quoi vous inquiéter… La comtesse était venue solliciter mon intérêt pour une pauvre femme si intéressante… si malheureuse… que malgré moi je me suis attendrie à son récit.
– Bien vrai ?… Ce n'est que cela…
– Ce n'est que cela, reprit Fleur-de-Marie en prenant sur une table les fleurs que Rodolphe avait jetées. Mais comme vous me gâtez ! ajouta-t-elle… quel bouquet magnifique ! Et quand je pense que chaque jour… vous m'en apportez un pareil… cueilli par vous…
– Mon enfant, dit Rodolphe en contemplant sa fille avec anxiété, tu me caches quelque chose… Ton sourire est douloureux, contraint. Je t'en conjure, dis-moi ce qui t'afflige… Ne t'occupe pas de ce bouquet.
– Oh ! vous le savez ce bouquet est ma joie de chaque matin, et puis j'aime tant les roses… Je les ai toujours tant aimées… Vous vous souvenez, ajouta-t-elle avec un sourire navrant, vous vous souvenez de mon pauvre petit rosier !… dont j'ai toujours gardé les débris…
À cette pénible allusion au temps passé, Rodolphe s'écria :
– Malheureuse enfant ! mes soupçons seraient-ils fondés ?… Au milieu de l'éclat qui t'environne, songerais-tu encore quelquefois à cet horrible temps ?… Hélas ! j'avais cru cependant te le faire oublier à force de tendresse !
– Pardon, pardon, mon père ! Ces paroles m'ont échappé. Je vous afflige…
– Je m'afflige, pauvre ange, dit tristement Rodolphe, parce que ces retours vers le passé doivent être affreux pour toi… parce qu'ils empoisonneraient ta vie si tu avais la faiblesse de t'y abandonner.
– Mon père… c'est par hasard… Depuis notre arrivée ici, c'est la première fois…
– C'est la première fois que tu m'en parles… oui… mais ce n'est peut-être pas la première fois que ces pensées te tourmentent… Je m'étais aperçu de tes accès de mélancolie, et quelquefois j'accusais le passé de causer ta tristesse… Mais, faute de certitude, je n'osais pas même essayer de combattre la funeste influence de ces ressouvenirs, de t'en montrer le néant, l'injustice ; car si ton chagrin avait eu une autre cause, si le passé avait été pour toi ce qu'il doit être, un vain et mauvais songe, je risquais d'éveiller en toi les idées pénibles que je voulais détruire…
– Combien vous êtes bon !… Combien ces craintes témoignent encore de votre ineffable tendresse !
– Que veux-tu… ma position était si difficile, si délicate… Encore une fois, je ne te disais rien, mais j'étais sans cesse préoccupé de ce qui te touchait… En contractant ce mariage qui comblait tous mes vœux, j'avais aussi cru donner une garantie de plus à ton repos. Je connaissais trop l'excessive délicatesse de ton cœur pour espérer que jamais… jamais tu ne songerais plus au passé ; mais je me disais que si par hasard ta pensée s'y arrêtait, tu devais, en te sentant maternellement chérie par la noble femme qui t'a connue et aimée au plus profond de ton malheur, tu devais, dis-je, regarder le passé comme suffisamment expié par tes atroces misères et être indulgente ou plutôt juste envers toi-même ; car enfin ma femme a droit par ses rares qualités aux respects de tous, n'est-ce pas ? Eh bien ! dès que tu es pour elle une fille, une sœur chérie, ne dois-tu pas être rassurée ? Son tendre attachement n'est-il pas une réhabilitation complète ? Ne te dit-il pas qu'elle sait comme toi que tu as été victime et non coupable, qu'on ne peut enfin te reprocher que le malheur… qui t'a accablée dès ta naissance ! Aurais-tu même commis de grandes fautes, ne seraient-elles pas mille fois expiées, rachetées par tout ce que tu as fait de bien, par tout ce qui s'est développé d'excellent et d'adorable en toi ?…
– Mon père…
– Oh ! je t'en prie, laisse-moi te dire ma pensée entière, puisqu'un hasard, qu'il faudra bénir sans doute, a amené cet entretien. Depuis longtemps je le désirais et je le redoutais à la fois… Dieu veuille qu'il ait un succès salutaire !… J'ai à te faire oublier tant d'affreux chagrins ; j'ai à remplir auprès de toi une mission si auguste, si sacrée, que j'aurais eu le courage de sacrifier à ton repos mon amour pour Mme d'Harville… mon amitié pour Murph, si j'avais pensé que leur présence t'eût trop douloureusement rappelé le passé.
– Oh ! mon bon père, pouvez-vous le croire ?… Leur présence, à eux, qui savent… ce que j'étais… et qui pourtant m'aiment tendrement, ne personnifie-t-elle pas au contraire l'oubli et le pardon ?… Enfin, mon père, ma vie entière n'eût-elle pas été désolée si pour moi vous aviez renoncé à votre mariage avec Mme d'Harville ?
– Oh ! je n'aurais pas été seul à vouloir ce sacrifice s'il avait dû assurer ton bonheur… Tu ne sais pas quel renoncement Clémence s'était déjà volontairement imposé ?… Car elle aussi comprend toute l'étendue de mes devoirs envers toi.
– Vos devoirs envers moi, mon Dieu ! Et qu'ai-je fait pour mériter autant ?
– Ce que tu as fait, pauvre ange aimé ?… Jusqu'au moment où tu m'as été rendue, ta vie n'a été qu'amertume, misère, désolation… et tes souffrances passées je me les reproche comme si je les avais causées ! Aussi, lorsque je te vois souriante, satisfaite, je me crois pardonné… Mon seul but, mon seul vœu est de te rendre aussi idéalement heureuse que tu as été infortunée, de t'élever autant que tu as été abaissée, car il me semble que les derniers vestiges du passé s'effacent lorsque les personnes les plus éminentes, les plus honorables, te rendent les respects qui te sont dus.
– À moi du respect ?… Non, non, mon père… mais à mon rang, ou plutôt à celui que vous m'avez donné.
– Oh ! ce n'est pas ton rang qu'on aime et qu'on révère… c'est toi, entends-tu bien, mon enfant chérie, c'est toi-même, c'est toi seule… Il est des hommages imposés par le rang, mais il en est aussi d'imposés par le charme et par l'attrait ! Tu ne sais pas distinguer ceux-là, toi, parce que tu t'ignores, parce que, par un prodige d'esprit et de tact qui me rend aussi fier qu'idolâtre de toi, tu apportes dans ces relations cérémonieuses, si nouvelles pour toi, un mélange de dignité, de modestie et de grâce, auquel ne peuvent résister les caractères les plus hautains…
– Vous m'aimez tant, mon père, et on vous aime tant, que l'on est sûr de vous plaire en me témoignant de la déférence.
– Oh ! la méchante enfant ! s'écria Rodolphe en interrompant sa fille et en l'embrassant avec tendresse. La méchante enfant, qui ne veut accorder aucune satisfaction à mon orgueil de père !
– Cet orgueil n'est-il pas aussi satisfait en vous attribuant à vous seul la bienveillance que l'on me témoigne, mon bon père ?
– Non, certainement, mademoiselle, dit le prince en souriant à sa fille pour chasser la tristesse dont il la voyait encore atteinte, non, mademoiselle, ce n'est pas la même chose ; car il ne m'est pas permis d'être fier de moi, et je puis et je dois être fier de vous… oui, fier. Encore une fois, tu ne sais pas combien tu es divinement douée… En quinze mois ton éducation s'est si merveilleusement accomplie que la mère la plus difficile serait enthousiaste de toi ; et cette éducation a encore augmenté l'influence presque irrésistible que tu exerces autour de toi sans t'en douter.
– Mon père… vos louanges me rendent confuse.
– Je dis la vérité, rien que la vérité. En veux-tu des exemples ? Parlons hardiment du passé : c'est un ennemi que je veux combattre corps à corps, il faut le regarder en face. Eh bien ! te souviens-tu de la Louve, de cette courageuse femme qui t'a sauvée ? Rappelle-toi cette scène de la prison que tu m'as racontée : une foule de détenues, plus stupides encore que méchantes, s'acharnaient à tourmenter une de leurs compagnes faible et infirme, leur souffre-douleur : tu parais, tu parles… et voilà qu'aussitôt ces furies, rougissant de leur lâche cruauté envers leur victime, se montrent aussi charitables qu'elles avaient été méchantes. N'est-ce donc rien, cela ? Enfin, est-ce, oui ou non, grâce à toi que la Louve, cette femme indomptable, a connu le repentir et désiré une vie honnête et laborieuse ? Va, crois-moi, mon enfant chérie, celle qui avait dominé la Louve et ses turbulentes compagnes par le seul ascendant de la bonté jointe à une rare élévation d'esprit, celle-là, quoique dans d'autres circonstances et dans une sphère tout opposée, devait par le même charme (n'allez pas sourire de ce rapprochement, mademoiselle) fasciner aussi l'altière archiduchesse Sophie et tout mon entourage ; car bons et méchants, grands et petits, subissent presque toujours l'influence des âmes supérieures… Je ne veux pas dire que tu sois née princesse dans l'acception aristocratique du mot, cela serait une pauvre flatterie à te faire, mon enfant… mais tu es de ce petit nombre d'êtres privilégiés qui sont nés pour dire à une reine ce qu'il faut pour la charmer et s'en faire aimer… et aussi pour dire à une pauvre créature, avilie et abandonnée, ce qu'il faut pour la rendre meilleure, la consoler et s'en faire adorer.
– Mon bon père… de grâce…
– Oh ! tant pis pour vous, mademoiselle, il y a trop longtemps que mon cœur déborde. Songe donc, avec mes craintes d'éveiller en toi les souvenirs de ce passé que je veux anéantir, que j'anéantirai à jamais dans ton esprit… je n'osais t'entretenir de ces comparaisons… de ces rapprochements qui te rendent si adorable à mes yeux. Que de fois Clémence et moi nous sommes-nous extasiés sur toi !… Que de fois, si attendrie que les larmes lui venaient aux yeux, elle m'a dit : « N'est-il pas merveilleux que cette chère enfant soit ce qu'elle est, après le malheur qui l'a poursuivie ? ou plutôt, reprenait Clémence, n'est-il pas merveilleux que, loin d'altérer cette noble et rare nature, l'infortune ait au contraire donné plus d'essor à ce qu'il y avait d'excellent en elle ?
À ce moment-là, la porte du salon s'ouvrit et Clémence, grande-duchesse de Gerolstein, entra, tenant une lettre à la main.
– Voici, mon ami, dit-elle à Rodolphe, une lettre de France. J'ai voulu vous l'apporter afin de dire bonjour à ma paresseuse enfant, que je n'ai pas encore vue ce matin, ajouta Clémence en embrassant tendrement Fleur-de-Marie.
– Cette lettre arrive à merveille, dit gaiement Rodolphe après l'avoir parcourue ; nous causions justement du passé… de ce monstre que nous allons incessamment combattre, ma chère Clémence… car il menace le repos et le bonheur de notre enfant.
– Serait-il vrai, mon ami ? Ces accès de mélancolie que nous avions remarqués…
– N'avaient pas d'autre cause que de méchants souvenirs ; mais heureusement nous connaissons maintenant notre ennemi… et nous en triompherons…
– Mais de qui donc est cette lettre, mon ami ? demanda Clémence.
– De la gentille Rigolette… la femme de Germain.
– Rigolette…, s'écria Fleur-de-Marie, quel bonheur d'avoir de ses nouvelles !
– Mon ami, dit tout bas Clémence à Rodolphe, en lui montrant Fleur-de-Marie du regard, ne craignez-vous pas que cette lettre… ne lui rappelle des idées pénibles ?
– Ce sont justement ces souvenirs que je veux anéantir, ma chère Clémence ; il faut les aborder hardiment, et je suis sûr que je trouverai dans la lettre de Rigolette d'excellentes armes contre eux… car cette bonne petite créature adorait notre enfant et l'appréciait comme elle devait l'être.
Et Rodolphe lut à haute voix la lettre suivante :
« Ferme de Bouqueval, 15 août 1841
« Monseigneur,
« Je prends la liberté de vous écrire encore pour vous faire part d'un bien grand bonheur qui nous est arrivé, et pour vous demander une nouvelle faveur, à vous à qui nous devons déjà tant, ou plutôt à qui nous devons le vrai paradis où nous vivons, moi, mon Germain et sa bonne mère.
« Voilà de quoi il s'agit, monseigneur : depuis dix jours je suis comme folle de joie, car il y a dix jours que j'ai un amour de petite fille ; moi je trouve que c'est tout le portrait de Germain ; lui, que c'est tout le mien ; notre chère maman Georges dit qu'elle nous ressemble à tous les deux ; le fait est qu'elle a de charmants yeux bleus comme Germain, et des cheveux noirs tout frisés comme moi. Par exemple, contre son habitude, mon mari est injuste, il veut toujours avoir notre petite sur ses genoux… tandis que moi, c'est mon droit, n'est-ce pas, monseigneur ?
– Braves et dignes jeunes gens ! Qu'ils doivent être heureux ! dit Rodolphe. Si jamais couple fut bien assorti… c'est celui-là.
– Et combien Rigolette mérite son bonheur ! dit Fleur-de-Marie.
– Aussi j'ai toujours béni le hasard qui me l'a fait rencontrer, dit Rodolphe ; et il continua :
« Mais, au fait, monseigneur, pardon de vous entretenir de ces gentilles querelles de ménage qui finissent toujours par un baiser… Du reste les oreilles doivent joliment vous tinter, monseigneur, car il ne se passe pas de jour que nous ne disions, en nous regardant nous deux Germain : « Sommes-nous heureux, mon Dieu ! sommes-nous heureux !… » et naturellement votre nom vient tout de suite après ces mots-là… Excusez ce griffonnage qu'il y a là, monseigneur, avec un pâté ; c'est que, sans y penser, j'avais écrit monsieur Rodolphe, comme je disais autrefois, et j'ai raturé. J'espère, à propos de cela, que vous trouverez que mon écriture a bien gagné, ainsi que mon orthographe ; car Germain me montre toujours, et je ne fais plus des grands bâtons en allant tout de travers, comme du temps où vous me tailliez mes plumes…
– Je dois avouer, dit Rodolphe, en riant, que ma petite protégée se fait un peu illusion, et je suis sûr que Germain s'occupe plutôt de baiser la main de son élève que de la diriger.
– Allons, mon ami, vous êtes injuste, dit Clémence en regardant la lettre ; c'est un peu gros, mais très-lisible.
– Le fait est qu'il y a progrès, reprit Rodolphe ; autrefois il lui aurait fallu huit pages pour contenir ce qu'elle écrit maintenant en deux.
Et il continua :
« C'est pourtant vrai que vous m'avez taillé des plumes, monseigneur ; quand nous y pensons, nous deux Germain, nous en sommes tout honteux, en nous rappelant que vous étiez si peu fiers… Ah ! mon Dieu ! voilà encore que je me surprends à vous parler d'autre chose que de ce que nous voulons vous demander, monseigneur ; car mon mari se joint à moi et c'est bien important ; nous y attachons une idée… vous allez voir.
« Nous vous supplions donc, monseigneur, d'avoir la bonté de nous choisir et de nous donner un nom pour notre petite fille chérie ; c'est convenu avec le parrain et la marraine, et ces parrain et marraine, savez-vous qui c'est, monseigneur ? Deux des personnes que vous et Mme la marquise d'Harville vous avez tirées de la peine pour les rendre bien heureuses, aussi heureuses que nous… En un mot, c'est Morel le lapidaire et Jeanne Duport, la sœur d'un pauvre prisonnier nommé Pique-Vinaigre, une digne femme que j'avais vue en prison quand j'allais y visiter mon pauvre Germain, et que plus tard Mme la marquise a fait sortir de l'hôpital.
« Maintenant, monseigneur, il faut que vous sachiez pourquoi nous avons choisi M. Morel pour parrain et Jeanne Duport pour marraine. Nous nous sommes dit, nous deux Germain : « Ça sera comme une manière de remercier encore M. Rodolphe de ses bontés que de prendre pour parrain et marraine de notre petite fille des dignes gens qui doivent tout à lui et à Mme la marquise… » sans compter que Morel le lapidaire et Jeanne Duport sont la crème des honnêtes gens… Ils sont de notre classe, et de plus, comme nous disons avec Germain, ils sont nos parents en bonheur, puisqu'ils sont comme nous de la famille de vos protégés, monseigneur.
– Ah ! mon père, ne trouvez-vous pas cette idée d'une délicatesse charmante ? dit Fleur-de-Marie avec émotion. Prendre pour parrain et marraine de leur enfant des personnes qui vous doivent tout, à vous et à ma seconde mère ?
– Vous avez raison, chère enfant, dit Clémence ; je suis on ne peut plus touchée de ce souvenir.
– Et moi je suis très-heureux d'avoir si bien placé mes bienfaits, dit Rodolphe en continuant sa lecture :
« Du reste, au moyen de l'argent que vous lui avez fait donner, monsieur Rodolphe, Morel est maintenant courtier en pierres fines ; il gagne de quoi bien élever sa famille et faire apprendre un état à ses enfants. La bonne et pauvre Louise va, je crois, se marier avec un digne ouvrier qui l'aime et la respecte comme elle doit l'être, car elle a été bien malheureuse, mais non coupable, et le fiancé de Louise a assez de cœur pour comprendre cela…
– J'étais bien sûr, s'écria Rodolphe en s'adressant à sa fille, de trouver dans la lettre de cette chère petite Rigolette des armes contre notre ennemi !… Tu entends, c'est l'expression du simple bon sens de cette âme honnête et droite… Elle dit de Louise : Elle a été malheureuse et non coupable, et son fiancé a assez de cœur pour comprendre cela.
Fleur-de-Marie, de plus en plus émue et attristée par la lecture de cette lettre, tressaillit du regard que son père attacha un moment sur elle en prononçant les derniers mots que nous avons soulignés.
Le prince continua :
« Je vous dirai encore, monseigneur, que Jeanne Duport, par la générosité de Mme la marquise, a pu se faire séparer de son mari, ce vilain homme qui lui mangeait tout et la battait ; elle a repris sa fille aînée auprès d'elle, et elle tient une petite boutique de passementerie où elle vend ce qu'elle fabrique avec ses enfants ; leur commerce prospère. Il n'y a pas non plus de gens plus heureux, et cela, grâce à qui ? grâce à vous, monseigneur, grâce à Mme la marquise, qui, tous deux, savez si bien donner, et donner si à propos.
« À propos de ça, Germain vous écrit comme d'ordinaire, monseigneur, à la fin du mois, au sujet de la Banque des travailleurs sans ouvrage et des prêts gratuits. Il n'y a presque jamais de remboursements en retard et on s'aperçoit déjà beaucoup du bien-être que cela répand dans le quartier. Au moins maintenant, de pauvres familles peuvent supporter la morte-saison du travail sans mettre leur linge et leurs matelas au mont-de-piété. Ainsi, quand l'ouvrage revient, faut voir avec quel cœur ils s'y mettent ; ils sont si fiers qu'on ait eu confiance dans leur travail et dans leur probité !… Dame ! ils n'ont que ça. Aussi comme ils vous bénissent de leur avoir fait prêter là-dessus ! Oui, monseigneur, ils vous bénissent, vous ; car, quoique vous disiez que vous n'êtes pour rien dans cette fondation, sauf la nomination de Germain comme caissier directeur, et que c'est un inconnu qui a fait ce grand bien… nous aimons mieux croire que c'est à vous qu'on le doit ; c'est plus naturel !
« D'ailleurs il y a une fameuse trompette pour répéter à tout bout de champ que c'est vous qu'on doit bénir ; cette trompette est Mme Pipelet, qui répète à chacun qu'il n'y a que son roi des locataires (excusez, monsieur Rodolphe, elle vous appelle toujours ainsi) qui puisse avoir fait cette œuvre charitable, et son vieux chéri d'Alfred est toujours de son avis. Quant à lui, il est si fier et si content de son poste de gardien de la banque qu'il dit que les poursuites de M. Cabrion lui seraient maintenant indifférentes. Pour en finir avec votre famille de reconnaissants, monseigneur, j'ajouterai que Germain a lu dans les journaux que le nommé Martial, un colon d'Algérie, avait été cité avec de grands éloges pour le courage qu'il avait montré en repoussant à la tête de ses métayers une attaque d'Arabes pillards, et que sa femme, aussi intrépide que lui, avait été légèrement blessée à ses côtés, où elle tirait des coups de fusil, comme un vrai grenadier. Depuis ce temps-là, dit-on dans le journal, on l'a baptisée Mme Carabine.
« Excusez de cette longue lettre, monseigneur ; mais j'ai pensé que vous ne seriez pas fâché d'avoir par nous des nouvelles de tous ceux dont vous avez été la providence… Je vous écris de la ferme de Bouqueval, où nous sommes depuis le printemps avec notre bonne mère. Germain part le matin pour ses affaires, et il revient le soir. À l'automne, nous retournerons habiter Paris. Comme c'est drôle, monsieur Rodolphe, moi qui n'aimais pas la campagne, je l'adore maintenant… Je m'explique ça, parce que Germain l'aime beaucoup. À propos de la ferme, monsieur Rodolphe, vous qui savez sans doute où est cette bonne petite Goualeuse, si vous en avez l'occasion, dites-lui qu'on se souvient toujours d'elle comme de ce qu'il y a de plus doux et de meilleur au monde, et que, pour moi, je ne pense jamais à notre bonheur sans me dire : « Puisque M. Rodolphe était aussi le M. Rodolphe de cette chère Fleur-de-Marie, grâce à lui elle doit être heureuse comme nous autres », et ça me fait trouver mon bonheur encore meilleur.
« Mon Dieu, mon Dieu, comme je bavarde ! Qu'est-ce que vous allez dire, monseigneur ? Mais bah ! vous êtes si bon… Et puis, voyez-vous, c'est votre faute si je gazouille autant et aussi joyeusement que papa Crétu et Ramonette, qui n'osent plus lutter maintenant de chant avec moi. Allez, monsieur Rodolphe, je vous en réponds, je les mets sur les dents.
« Vous ne nous refuserez pas notre demande, n'est-ce pas, monseigneur ? Si vous donnez un nom à notre petite fille chérie, il nous semble que ça lui portera bonheur, que ce sera comme sa bonne étoile. Tenez, monsieur Rodolphe, quelquefois, moi et mon bon Germain, nous nous félicitons presque d'avoir connu la peine, parce que nous sentons doublement combien notre enfant sera heureuse de ne pas savoir ce que c'est que la misère par où nous avons passé.
« Si je finis en vous disant, monsieur Rodolphe, que nous tâchons de secourir par-ci par-là de pauvres gens selon nos moyens, ce n'est pas pour nous vanter, mais pour que vous sachiez que nous ne gardons pas pour nous seuls tout le bonheur que vous nous avez donné. D'ailleurs nous disons toujours à ceux que nous secourons : « Ce n'est pas nous qu'il faut remercier et bénir… c'est M. Rodolphe, l'homme le meilleur, le plus généreux qu'il y ait au monde. » Et ils vous prennent pour une espèce de saint, si ce n'est plus.
« Adieu, monseigneur. Croyez que, lorsque notre petite fille commencera à épeler, le premier mot qu'elle lira sera votre nom, monsieur Rodolphe ; et puis après, ceux-ci, que vous avez fait écrire sur ma corbeille de noces :
Travail et sagesse – Honneur et bonheur.
« Grâce à ces quatre mots-là, à notre tendresse et à nos soins, nous espérons, monseigneur, que notre enfant sera toujours digne de prononcer le nom de celui qui a été notre providence et celle de tous les malheureux qu'il a connus.
« Pardon, monseigneur ; c'est que j'ai, en finissant, comme de grosses larmes dans les yeux… mais c'est de bonnes larmes… Excusez, s'il vous plaît… ce n'est pas ma faute, mais je n'y vois plus bien clair, et je griffonne…
« J'ai l'honneur, monseigneur, de vous saluer avec autant de respect que de reconnaissance.
« RIGOLETTE, femme GERMAIN.
« P. S. Ah ! mon Dieu ! monseigneur, en relisant ma lettre, je m'aperçois que j'ai mis bien des fois monsieur Rodolphe. Vous me pardonnerez, n'est-ce pas ? Vous savez bien que, sous un nom ou sous un autre, nous vous respectons et nous vous bénissons la même chose, monseigneur.
V. Les souvenirs
– Chère petite Rigolette ! dit Clémence attendrie par la lecture que venait de faire Rodolphe. Cette lettre naïve est remplie de sensibilité.
– Sans doute, reprit Rodolphe ; on ne pouvait mieux placer un bienfait. Notre protégée est douée d'un excellent naturel ; c'est un cœur d'or, et notre chère enfant l'apprécie comme nous, ajouta-t-il en s'adressant à sa fille.
Puis, frappé de sa pâleur et de son accablement, il s'écria :
– Mais qu'as-tu donc ?
– Hélas !… quel douloureux contraste entre ma position et celle de Rigolette… « Travail et sagesse. Honneur et bonheur », ces quatre mots disent tout ce qu'a été… tout ce que doit être sa vie… Jeune fille laborieuse et sage, épouse chérie, heureuse mère, femme honorée… telle est sa destinée ! tandis que moi…
– Grand dieu ! Que dis-tu ?
– Grâce… mon bon père ; ne m'accusez pas d'ingratitude… mais, malgré votre ineffable tendresse, malgré celle de ma seconde mère, malgré les respects et les splendeurs dont je suis entourée… malgré votre puissance souveraine, ma honte est incurable… Rien ne peut anéantir le passé… Encore une fois, pardonnez-moi, mon père… je vous l'ai caché jusqu'à présent… mais le souvenir de ma dégradation première me désespère et me tue…
– Clémence, vous l'entendez !… s'écria Rodolphe avec désespoir.
– Mais, malheureuse enfant ! dit Clémence en prenant affectueusement la main de Fleur-de-Marie dans les siennes, notre tendresse, l'affection de ceux qui vous entourent, et que vous méritez, tout ne vous prouve-t-il pas que ce passé ne doit plus être pour vous qu'un vain et mauvais songe ?
– Oh ! fatalité… fatalité ! reprit Rodolphe. Maintenant je maudis mes craintes, mon silence : cette funeste idée, depuis longtemps enracinée dans son esprit, y a fait à notre insu d'affreux ravages, et il est trop tard pour combattre cette déplorable erreur… Ah ! je suis bien malheureux !
– Courage, mon ami, dit Clémence à Rodolphe ; vous le disiez tout à l'heure, il vaut mieux connaître l'ennemi qui nous menace… Nous savons maintenant la cause du chagrin de notre enfant, nous en triompherons, parce que nous aurons pour nous la raison, la justice et notre tendresse.
– Et puis enfin parce qu'elle verra que son affliction, si elle était incurable, rendrait la nôtre incurable aussi, reprit Rodolphe ; car en vérité ce serait à désespérer de toute justice humaine et divine, si cette infortunée n'avait fait que changer de tourments.
Après un assez long silence, pendant lequel Fleur-de-Marie parut se recueillir, elle prit d'une main la main de Rodolphe, de l'autre celle de Clémence et leur dit d'une voix profondément altérée :
– Écoutez-moi, mon bon père… et vous aussi, ma tendre mère… ce jour est solennel… Dieu a voulu, et je l'en remercie, qu'il me fût impossible de vous cacher davantage ce que je ressens… Avant peu d'ailleurs je vous aurais fait l'aveu que vous allez entendre, car toute souffrance a son terme… et, si cachée que fût la mienne, je n'aurais pu vous la taire plus longtemps.
– Ah !… je comprends tout, s'écria Rodolphe ; il n'y a plus d'espoir pour elle.
– J'espère dans l'avenir, mon père, et cet espoir me donne la force de vous parler ainsi.
– Et que peux-tu espérer de l'avenir… pauvre enfant, puisque ton sort présent ne te cause que chagrins et amertume ?
– Je vais vous le dire, mon père… mais avant, permettez-moi de vous rappeler le passé… de vous avouer devant Dieu qui m'entend ce que j'ai ressenti jusqu'ici.
– Parle… parle, nous t'écoutons, dit Rodolphe, en s'asseyant avec Clémence auprès de Fleur-de-Marie.
– Tant que je suis restée à Paris… auprès de vous, mon père, dit Fleur-de-Marie, j'ai été si heureuse, oh ! si complètement heureuse, que ces beaux jours ne seraient pas trop payés par des années de souffrances… Vous le voyez… j'ai du moins connu le bonheur.
– Pendant quelques jours peut-être…
– Oui ; mais quelle félicité pure et sans mélange ! Vous m'entouriez, comme toujours, des soins les plus tendres ! Je me livrais sans crainte aux élans de reconnaissance et d'affection qui à chaque instant emportaient mon cœur vers vous… L'avenir m'éblouissait : un père à adorer, une seconde mère à chérir doublement, car elle devait remplacer la mienne… que je n'avais jamais connue… Et puis… je dois tout avouer, mon orgueil s'exaltait malgré moi, tant j'étais honorée de vous appartenir. Lorsque le petit nombre de personnes de votre maison qui, à Paris, avaient occasion de me parler, m'appelaient Altesse… je ne pouvais m'empêcher d'être fière de ce titre. Si alors je pensais quelquefois vaguement au passé, c'était pour me dire : « Moi, jadis, si avilie, je suis la fille chérie d'un prince souverain que chacun bénit et révère ; moi, jadis si misérable, je jouis de toutes les splendeurs du luxe et d'une existence presque royale ! » Hélas ! que voulez-vous, mon père, ma fortune était si imprévue… votre puissance m'entourait d'un si splendide éclat, que j'étais excusable, peut-être de me laisser aveugler ainsi.
– Excusable !… mais rien de plus naturel, pauvre ange aimé. Quel mal de t'enorgueillir d'un rang qui était le tien ? De jouir des avantages de la position que je t'avais rendue ? Aussi dans ce temps-là, je me le rappelle bien, tu étais d'une gaieté charmante ; que de fois je t'ai vue tomber dans mes bras comme accablée par la félicité, et me dire avec un accent enchanteur ces mots qu'hélas ! je ne dois plus entendre : « Mon père… c'est trop… trop de bonheur ! » Malheureusement ce sont ces souvenirs-là… vois-tu, qui m'ont endormi dans une sécurité trompeuse ; et plus tard je ne me suis pas assez inquiété des causes de ta mélancolie…
– Mais dites-nous donc, mon enfant, reprit Clémence, qui a pu changer en tristesse cette joie si pure, si légitime, que vous éprouviez d'abord ?
– Hélas ! une circonstance bien funeste et bien imprévue !…
– Quelle circonstance ?…
– Vous vous rappelez, mon père…, dit Fleur-de-Marie, ne pouvant vaincre un frémissement d'horreur, vous vous rappelez la scène terrible qui a précédé notre départ de Paris… lorsque votre voiture a été arrêtée près de la barrière ?
– Oui…, répondit tristement Rodolphe. Brave Chourineur !… Après m'avoir encore une fois sauvé la vie, il est mort là… devant nous… en disant : « Le ciel est juste… j'ai tué, on me tue !… »
– Eh bien !… mon père, au moment où ce malheureux expirait, savez-vous qui j'ai vu… me regarder fixement ?… Oh ! ce regard… ce regard… il m'a toujours poursuivie depuis, ajouta Fleur-de-Marie en frissonnant.
– Quel regard ? De qui parles-tu ? s'écria Rodolphe.
– De l'ogresse du tapis-franc…, murmura Fleur-de-Marie.
– Ce monstre ! tu l'as revu ? Et où cela ?
– Vous ne l'avez pas aperçue dans la taverne où est mort le Chourineur ? Elle se trouvait parmi les femmes qui l'entouraient.
– Ah ! maintenant, dit Rodolphe avec accablement, je comprends… Déjà frappée de terreur par le meurtre du Chourineur, tu auras cru voir quelque chose de providentiel dans cette affreuse rencontre ! ! !
– Il n'est que trop vrai, mon père ; à la vue de l'ogresse, je ressentis un froid mortel ; il me sembla que sous son regard mon cœur, jusqu'alors rayonnant de bonheur et d'espoir, se glaçait tout à coup. Oui, rencontrer cette femme au moment même où le Chourineur mourait en disant : « Le ciel est juste !… » cela me parut un blâme providentiel de mon orgueilleux oubli du passé, que je devais expier à force d'humiliation et de repentir.
– Mais le passé, on te l'a imposé ; tu n'en peux répondre devant Dieu !
– Vous avez été contrainte… enivrée… malheureuse enfant.
– Une fois précipitée malgré toi dans cet abîme, tu ne pouvais plus en sortir, malgré tes remords, ton épouvante et ton désespoir, grâce à l'atroce indifférence de cette société dont tu étais victime. Tu te voyais à jamais enchaînée dans cet antre ; il a fallu, pour t'en arracher, le hasard qui t'a placée sur mon chemin.
– Et puis enfin, mon enfant, votre père vous le dit, vous étiez victime et non complice de cette infamie ! s'écria Clémence.
– Mais cette infamie… je l'ai subie… ma mère, reprit douloureusement Fleur-de-Marie. Rien ne peut anéantir ces affreux souvenirs… Sans cesse ils me poursuivent, non plus comme autrefois au milieu des paisibles habitants d'une ferme, ou des femmes dégradées, mes compagnes de Saint-Lazare… mais ils me poursuivront jusque dans ce palais… peuplé de l'élite de l'Allemagne… Ils me poursuivent enfin jusque dans les bras de mon père, jusque sur les marches de son trône.
Et Fleur-de-Marie fondit en larmes.
Rodolphe et Clémence restèrent muets devant cette effrayante expression d'un remords invincible ; ils pleuraient aussi, car ils sentaient l'impuissance de leurs consolations.
– Depuis lors, reprit Fleur-de-Marie en essuyant ses larmes, à chaque instant du jour, je me dis avec une honte amère : « On m'honore, on me révère ; les personnes les plus éminentes, les plus vénérables, m'entourent de respects ; aux yeux de toute une cour, la sœur d'un empereur a daigné rattacher mon bandeau sur mon front… et j'ai vécu dans la fange de la Cité, tutoyée par des voleurs et des assassins ! »
« Oh ! mon père, pardonnez-moi ; mais plus ma position s'est élevée… plus j'ai été frappée de la dégradation profonde où j'étais tombée ; à chaque hommage qu'on me rend, je me sens coupable d'une profanation ; songez-y donc, mon Dieu ! après avoir été ce que j'ai été… souffrir que des vieillards s'inclinent devant moi… souffrir que de nobles jeunes filles, que des femmes justement respectées se trouvent flattées de m'entourer… souffrir enfin que des princesses, doublement augustes et par l'âge et par leur caractère sacerdotal, me comblent de prévenances et d'éloges… cela n'est-il pas impie et sacrilège ! Et puis, si vous saviez, mon père, ce que j'ai souffert, ce que je souffre encore chaque jour en me disant : « Si Dieu voulait que le passé fût connu… avec quel mépris mérité on traiterait celle qu'à cette heure on élève si haut !… » Quelle juste et effrayante punition !
– Mais, malheureuse enfant, ma femme et moi nous connaissons le passé… nous sommes dignes de notre rang, et pourtant nous te chérissons… nous t'adorons.
– Vous avez pour moi l'aveugle tendresse d'un père et d'une mère…
– Tout le bien que tu as fait depuis ton séjour ici ? Et cette institution belle et sainte, cet asile ouvert par toi aux orphelines et aux pauvres filles abandonnées, ces soins admirables d'intelligence et de dévouement dont tu les entoures ? Ton insistance à les appeler tes sœurs, à vouloir qu'elles t'appellent ainsi, puisque en effet tu les traites en sœurs ?… n'est-ce donc rien pour la rédemption de fautes qui ne furent pas les tiennes ?… Enfin l'affection que te témoigne la digne abbesse de Sainte-Hermangilde, qui ne te connaît que depuis ton arrivée ici, ne la dois-tu pas absolument à l'élévation de ton esprit, à la beauté de ton âme, à ta piété sincère ?
– Tant que les louanges de l'abbesse de Sainte-Hermangilde ne s'adressent qu'à ma conduite présente, j'en jouis sans scrupule, mon père ; mais lorsqu'elle cite mon exemple aux demoiselles nobles qui sont en religion dans l'abbaye, mais lorsque celles-ci voient en moi un modèle de toutes les vertus, je me sens mourir de confusion, comme si j'étais complice d'un mensonge indigne.
Après un assez long silence, Rodolphe reprit avec un abattement douloureux :
– Je le vois, il faut désespérer de te persuader : les raisonnements sont impuissants contre une conviction d'autant plus inébranlable qu'elle a sa source dans un sentiment généreux et élevé, puisque à chaque instant tu jettes un regard sur le passé. Le contraste de ces souvenirs et de ta position présente doit être en effet pour toi un supplice continuel… Pardon, à mon tour, pauvre enfant.
– Vous, mon bon père, me demander pardon !… Et de quoi, grand Dieu ?
– De n'avoir pas prévu tes susceptibilités… D'après l'excessive délicatesse de ton cœur, j'aurais dû les deviner… Et pourtant… que pouvais-je faire ?… Il était de mon devoir de te reconnaître solennellement pour ma fille… alors ces respects, dont l'hommage t'est si douloureux, venaient nécessairement t'entourer…
« Oui, mais j'ai eu un tort… j'ai été, vois-tu, trop orgueilleux de toi… j'ai trop voulu jouir du charme que ta beauté, que ton esprit, que ton caractère inspiraient à tous ceux qui t'approchaient… J'aurais dû cacher mon trésor… vivre presque dans la retraite avec Clémence et toi… renoncer à ces fêtes, à ces réceptions nombreuses où j'aimais tant à te voir briller… croyant follement t'élever si haut… si haut… que le passé disparaîtrait entièrement à tes yeux… Mais hélas ! le contraire est arrivé… et, comme tu me l'as dit, plus tu t'es élevée, plus l'abîme dont je t'ai retirée t'a paru sombre et profond…
« Encore une fois, c'est ma faute… j'avais pourtant cru bien faire !… dit Rodolphe en essuyant ses larmes, mais je me suis trompé… Et puis, je me suis cru pardonné trop tôt… la vengeance de Dieu n'est pas satisfaite… elle me poursuit encore dans le bonheur de ma fille !…
Quelques coups discrètement frappés à la porte du salon qui précédait l'oratoire de Fleur-de-Marie interrompirent ce triste entretien.
Rodolphe se leva et entr'ouvrit la porte.
Il vit Murph, qui lui dit :
– Je demande pardon à Votre Altesse Royale de venir la déranger ; mais un courrier du prince d'Herkaüsen-Oldenzaal vient d'apporter cette lettre qui, dit-il, est très-importante et doit être sur-le-champ remise à Votre Altesse Royale.
– Merci, mon bon Murph. Ne t'éloigne pas, lui dit Rodolphe avec un soupir ; tout à l'heure j'aurai besoin de causer avec toi.
Et le prince, ayant fermé la porte, resta un moment dans le salon pour y lire la lettre que Murph venait de lui remettre.
Elle était ainsi conçue :
« Monseigneur,
« Puis-je espérer que les liens de parenté qui m'attachent à Votre Altesse Royale et que l'amitié dont elle a toujours daigné m'honorer excuseront une démarche qui serait d'une grande témérité si elle ne m'était pas imposée par une conscience d'honnête homme ?
« Il y a quinze mois, monseigneur, vous reveniez de France, ramenant avec vous une fille d'autant plus chérie que vous l'aviez crue perdue pour toujours, tandis qu'au contraire elle n'avait jamais quitté sa mère, que vous avez épousée à Paris in extremis, afin de légitimer la naissance de la princesse Amélie, qui est ainsi l'égale des autres Altesses de la Confédération germanique.
« Sa naissance est donc souveraine, sa beauté incomparable, son cœur est aussi digne de sa naissance que son esprit est digne de sa beauté, ainsi que me l'a écrit ma sœur l'abbesse de Sainte-Hermangilde, qui a souvent l'honneur de voir la fille bien-aimée de Votre Altesse Royale.
« Maintenant, monseigneur, j'aborderai franchement le sujet de cette lettre, puisque malheureusement une maladie grave me retient à Oldenzaal, et m'empêche de se rendre auprès de Votre Altesse Royale.
« Pendant le temps que mon fils a passé à Gerolstein, il a vu presque chaque jour la princesse Amélie, il l'aime éperdument, mais il lui a toujours caché son amour.
« J'ai cru devoir, monseigneur, vous en instruire. Vous avez daigné accueillir paternellement mon fils et l'engager à revenir, au sein de votre famille, vivre de cette intimité qui lui était si précieuse ; j'aurais indignement manqué à la loyauté en dissimulant à Votre Altesse Royale une circonstance qui doit modifier l'accueil qui était réservé à mon fils.
« Je sais qu'il serait insensé à nous d'oser espérer nous allier plus étroitement encore à la famille de Votre Altesse Royale.
« Je sais que la fille dont vous êtes à bon droit si fier, monseigneur, doit prétendre à de hautes destinées.
« Mais je sais aussi que vous êtes le plus tendre des pères, et que, si vous jugiez jamais mon fils digne de vous appartenir et de faire le bonheur de la princesse Amélie, vous ne seriez pas arrêté par les graves disproportions qui rendent pour nous une telle fortune inespérée.
« Il ne m'appartient pas de faire l'éloge d'Henri, monseigneur ; mais j'en appelle aux encouragements et aux louanges que vous avez si souvent daigné lui accorder.
« Je n'ose et ne puis vous en dire davantage, monseigneur ; mon émotion est trop profonde.
« Quelle que soit votre détermination, veuillez croire que nous nous y soumettrons avec respect, et que je serai toujours fidèle aux sentiments profondément dévoués avec lesquels j'ai l'honneur d'être
« de Votre Altesse Royale
« le très-humble et obéissant serviteur,
« GUSTAVE-PAUL, « prince d'Herkaüsen-Oldenzaal
VI. Aveux
Après la lecture de la lettre du prince, père d'Henri, Rodolphe resta quelque temps triste et pensif ; puis, un rayon d'espoir éclairant son front, il revint auprès de sa fille, à qui Clémence prodiguait en vain les plus tendres consolations.
– Mon enfant, tu l'as dit toi-même, Dieu a voulu que ce jour fût celui des explications solennelles, dit Rodolphe à Fleur-de-Marie, je ne prévoyais pas qu'une nouvelle et grave circonstance dût encore justifier tes paroles.
– De quoi s'agit-il, mon père ?
– Mon ami, qu'y a-t-il ?
– De nouveaux sujets de crainte.
– Pour qui donc, mon père ?
– Pour toi.
– Pour moi ?
– Tu ne nous as avoué que la moitié de tes chagrins, pauvre enfant.
– Soyez assez bon pour vous expliquer, mon père, dit Fleur-de-Marie en rougissant.
– Maintenant je le puis, je n'ai pu le faire plus tôt, ignorant que tu désespérais à ce point de ton sort. Écoute, ma fille chérie, tu te crois, ou plutôt tu es bien malheureuse. Lorsqu'au commencement de notre entretien tu m'as parlé des espérances qui te restaient, j'ai compris… mon cœur a été brisé… car il s'agissait pour moi de te perdre à jamais, de te voir t'enfermer dans un cloître, de te voir descendre vivante dans un tombeau. Tu voudrais entrer au couvent…
– Mon père…
– Mon enfant, est-ce vrai ?
– Oui, si vous me le permettez, répondit Fleur-de-Marie d'une voix étouffée.
– Nous quitter ! s'écria Clémence.
– L'abbaye de Sainte-Hermangilde est bien rapprochée de Gerolstein : je vous verrai souvent, vous et mon père.
– Songez donc que de tels vœux sont éternels, ma chère enfant. Vous n'avez pas dix-huit ans, et peut-être un jour…
– Oh ! je ne me repentirai jamais de la résolution que je prends : je ne trouverai le repos et l'oubli que dans la solitude d'un cloître, si toutefois mon père, et vous, ma seconde mère, vous me continuez votre affection.
– Les devoirs, les consolations de la vie religieuse pourraient, en effet, dit Rodolphe, sinon guérir, du moins calmer les douleurs de ta pauvre âme abattue et déchirée. Et, quoiqu'il s'agisse de la moitié du bonheur de ma vie, il se peut que j'approuve ta résolution. Je sais ce que tu souffres, et je ne dis pas que le renoncement au monde ne doive pas être le terme fatalement logique de ta triste existence.
– Quoi ! vous aussi, Rodolphe ! s'écria Clémence.
– Permettez-moi, mon amie, d'exprimer toute ma pensée, reprit Rodolphe. Puis, s'adressant à sa fille : Mais avant de prendre cette détermination extrême, il faut examiner si un autre avenir ne serait pas plus selon tes vœux et selon les nôtres. Dans ce cas, aucun sacrifice ne me coûterait pour assurer ton avenir.
Fleur-de-Marie et Clémence firent un mouvement de surprise ; Rodolphe reprit en regardant fixement sa fille :
– Que penses-tu… de ton cousin le prince Henri ?
Fleur-de-Marie tressaillit et devint pourpre.
Après un moment d'hésitation elle se jeta dans les bras du prince en pleurant.
– Tu l'aimes, pauvre enfant !
– Vous ne me l'aviez jamais demandé, mon père ! répondit Fleur-de-Marie en essuyant ses yeux.
– Mon ami, nous ne nous étions pas trompés, dit Clémence.
– Ainsi, tu l'aimes…, ajouta Rodolphe en prenant les mains de sa fille dans les siennes ; tu l'aimes bien, mon enfant chérie ?
– Oh ! si vous saviez, reprit Fleur-de-Marie, ce qu'il m'en a coûté de vous cacher ce sentiment dès que je l'ai eu découvert dans mon cœur. Hélas ! à la moindre question de votre part, je vous aurais tout avoué… Mais la honte me retenait et m'aurait toujours retenue.
– Et crois-tu qu'Henri connaisse ton amour pour lui ? dit Rodolphe.
– Grand Dieu ! mon père, je ne le pense pas ! s'écria Fleur-de-Marie avec effroi.
– Et lui… crois-tu qu'il t'aime ?
– Non, mon père… non… Oh ! j'espère que non… il souffrirait trop.
– Et comment cet amour est-il venu, mon ange aimé ?
– Hélas ! presque à mon insu… Vous vous souvenez d'un portrait de page ?
– Qui se trouve dans l'appartement de l'abbesse de Sainte-Hermangilde… c'était le portrait d'Henri.
– Oui, mon père… Croyant cette peinture d'une autre époque, un jour, en votre présence, je ne cachai pas à la supérieure que j'étais frappée de la beauté de ce portrait. Vous me dîtes alors, en plaisantant, que ce tableau représentait un de nos parents d'autrefois, qui, très-jeune encore, avait montré un grand courage et d'excellentes qualités. La grâce de cette figure, jointe à ce que vous me dîtes du noble caractère de ce parent, ajouta encore à ma première impression… Depuis ce jour, souvent je m'étais plu à me rappeler ce portrait, et cela sans le moindre scrupule, croyant qu'il s'agissait d'un de nos cousins mort depuis longtemps… Peu à peu, je m'habituai à ces douces pensées… sachant qu'il ne m'était pas permis d'aimer sur cette terre…, ajouta Fleur-de-Marie avec une expression navrante, et en laissant de nouveau couler ses larmes. Je me fis de ces rêveries bizarres une sorte de mélancolique intérêt, moitié sourire et moitié larmes ; je regardai ce joli page des temps passés comme un fiancé d'outre-tombe… que je retrouverais peut-être un jour dans l'éternité ; il me semblait qu'un tel amour était seul digne d'un cœur qui vous appartenait tout entier, mon père… Mais pardonnez-moi ces tristes enfantillages.
– Rien de plus touchant, au contraire, pauvre enfant ! dit Clémence profondément émue.
– Maintenant, reprit Rodolphe, je comprends pourquoi tu m'as reproché un jour, d'un air chagrin, de t'avoir trompée sur ce portrait.
– Hélas ! oui, mon père… Jugez de ma confusion, lorsque plus tard la supérieure m'apprit que ce portrait était celui de son neveu, l'un de nos parents… Alors, mon trouble fut extrême, je tâchai d'oublier mes premières impressions, mais, plus j'y tâchais, plus elles s'enracinaient dans mon cœur, par suite même de la persévérance de mes efforts… Malheureusement encore, souvent je vous entendis, mon père, vanter le cœur, l'esprit, le caractère du prince Henri…
– Tu l'aimais déjà, mon enfant chérie, alors que tu n'avais encore vu que son portrait et entendu parler que de ses rares qualités.
– Sans l'aimer, mon père, je sentais pour lui un attrait que je me reprochais amèrement ; mais je me consolais en pensant que personne au monde ne saurait ce triste secret, qui me couvrait de honte à mes propres yeux. Oser aimer… moi… moi… et puis ne pas me contenter de votre tendresse, de celle de ma seconde mère ! Ne vous devais-je pas assez pour employer toutes les forces, toutes les ressources de mon cœur à vous chérir tous deux ?… Oh ! croyez-moi, parmi mes reproches, ces derniers furent les plus douloureux. Enfin, pour la première fois je vis mon cousin… à cette grande fête que vous donniez à l'archiduchesse Sophie ; le prince Henri ressemblait d'une manière si saisissante à son portrait que je le reconnus tout d'abord… Le soir même, mon père, vous m'avez présenté à mon cousin, en autorisant entre nous l'intimité que permet la parenté.
– Eh bientôt vous vous êtes aimés ?
– Ah ! mon père, il exprimait son respect, son attachement, son admiration pour vous avec tant d'éloquence… vous m'aviez dit vous-même tant de bien de lui !…
– Il le méritait… Il n'est pas de caractère plus élevé, il n'est pas de meilleur et de plus valeureux cœur.
– Ah ! de grâce, mon père… ne le louez pas ainsi… Je suis déjà si malheureuse !…
– Et moi, je tiens à te bien convaincre de toutes les rares qualités de ton cousin… Ce que je te dis t'étonne… Je le conçois, mon enfant… Continue…
– Je sentais le danger que je courais en voyant le prince Henri chaque jour, et je ne pouvais me soustraire à ce danger. Malgré mon aveugle confiance en vous, mon père, je n'osais vous exprimer mes craintes. Je mis tout mon courage à cacher cet amour ; pourtant, je vous l'avoue, mon père, malgré mes remords, souvent, dans cette fraternelle intimité de chaque jour, oubliant le passé, j'éprouvai des éclairs de bonheur inconnu jusqu'alors, mais bientôt suivis, hélas ! de sombres désespoirs, dès que je retombais sous l'influence de mes tristes souvenirs… Car, hélas ! s'ils me poursuivaient au milieu des hommages et des respects de personnes presque indifférentes, jugez, jugez… mon père, de mes tortures, lorsque le prince Henri me prodiguait les louanges les plus délicates… m'entourait d'une adoration candide et pieuse, mettant, disait-il, l'attachement fraternel qu'il ressentait pour moi sous la sainte protection de sa mère, qu'il avait perdue bien jeune. Du moins, ce doux nom de sœur qu'il me donnait, je tâchais de le mériter, en conseillant mon cousin sur son avenir, selon mes faibles lumières, en m'intéressant à tout ce qui le touchait, en me promettant de toujours vous demander pour lui votre bienveillant appui… Mais souvent, aussi, que de tourments, que de pleurs dévorés, lorsque par hasard le prince Henri m'interrogeait sur mon enfance, sur ma première jeunesse… Oh ! tromper… toujours tromper… toujours craindre… toujours mentir, toujours trembler devant le regard de celui qu'on aime et qu'on respecte, comme le criminel tremble devant le regard inexorable de son juge !… Oh ! mon père ! j'étais coupable, je le sais, je n'avais pas le droit d'aimer ; mais j'expiais ce triste amour par bien des douleurs… Que vous dirai-je ? Le départ du prince Henri, en me causant un nouveau et violent chagrin, m'a éclairée… J'ai vu que je l'aimais plus encore que je ne croyais… Aussi, ajouta Fleur-de-Marie avec accablement, et comme si cette confession eût épuisé ses forces, bientôt je vous aurais fait cet aveu, car ce fatal amour a comblé la mesure de ce que je souffre… Dites, maintenant que vous savez tout, dites, mon père, est-il pour moi un autre avenir que celui du cloître ?
– Il en est un autre, mon enfant… oui… et cet avenir est aussi doux et aussi riant, aussi heureux que celui du couvent est morne et sinistre !
– Que dites-vous, mon père ?
– Écoute-moi à mon tour… Tu sens bien que je t'aime trop, que ma tendresse est trop clairvoyante pour que ton amour et celui d'Henri m'aient échappé ; au bout de quelques jours, je fus certain qu'il t'aimait, plus encore peut-être que tu ne l'aimes…
– Mon père… non… non… c'est impossible, il ne m'aime pas à ce point.
– Il t'aime, te dis-je… Il t'aime avec passion, avec délire.
– Ô mon Dieu ! Mon Dieu !
– Écoute encore… lorsque je t'ai fait cette plaisanterie du portrait, j'ignorais qu'Henri dût venir bientôt voir sa tante à Gerolstein. Lorsqu'il y vint, je cédai au penchant qu'il m'a toujours inspiré ; je l'invitai à nous voir souvent… Jusqu'alors, je l'avais traité comme mon fils, je ne changeai rien à ma manière d'être envers lui… Au bout de quelques jours, Clémence et moi nous ne pûmes douter de l'attrait que vous éprouviez l'un pour l'autre… Si ta position était plus douloureuse, ma pauvre enfant, la mienne aussi était pénible, et surtout d'une délicatesse extrême… Comme père, sachant les rares et excellentes qualités d'Henri, je ne pouvais qu'être profondément heureux de votre attachement, car jamais je n'aurais pu rêver un époux plus digne de toi.
– Ah ! mon père… pitié ! pitié !
– Mais, comme homme d'honneur, je songeais au triste passé de mon enfant… Aussi, loin d'encourager les espérances d'Henri, dans plusieurs entretiens je lui donnai des conseils absolument contraires à ceux qu'il aurait dû attendre de moi si j'avais songé à lui accorder ta main. Dans des conjonctures si délicates, comme père et comme homme d'honneur, je devais garder une neutralité rigoureuse, ne pas encourager l'amour de ton cousin, mais le traiter avec la même affabilité que par le passé… Tu as été jusqu'ici si malheureuse, mon enfant chérie, que, te voyant pour ainsi dire te ranimer sous l'influence de ce noble et pur amour, pour rien au monde je n'aurais voulu te ravir ces joies divines et rares. En admettant même que cet amour dût être brisé plus tard… tu aurais au moins connu quelques jours d'innocent bonheur… Et puis, enfin… cet amour pouvait assurer ton repos à venir…
– Mon repos ?
– Écoute encore… Le père d'Henri, le prince Paul, vient de m'écrire ; voici sa lettre… Quoiqu'il regarde cette alliance comme une faveur inespérée… il me demande ta main pour son fils, qui, me dit-il, éprouve pour toi l'amour le plus respectueux et le plus passionné.
– Ô mon Dieu ! Mon Dieu ! dit Fleur-de-Marie, en cachant son visage dans ses mains, j'aurais pu être si heureuse !
– Courage, ma fille bien-aimée ! Si tu le veux, ce bonheur est à toi ! s'écria tendrement Rodolphe.
– Oh ! jamais !… Jamais !… Oubliez-vous ?…
– Je n'oublie rien… Mais que demain tu entres au couvent, non-seulement je te perds à jamais… mais tu me quittes pour une vie de larmes et d'austérités… Eh bien ! te perdre pour te perdre… qu'au moins je te sache heureuse et mariée à celui que tu aimes… et qui t'adore.
– Mariée avec lui… moi, mon père !…
– Oui… mais à la condition que, sitôt après votre mariage, contracté ici la nuit, sans d'autres témoins que Murph pour toi et que le baron de Graün pour Henri, vous partirez tous deux pour aller dans quelque tranquille retraite de Suisse ou d'Italie, vivre inconnus, en riches bourgeois. Maintenant, ma fille chérie, sais-tu pourquoi je me résigne à t'éloigner de moi ? Sais-tu pourquoi je désire qu'Henri quitte son titre une fois hors de l'Allemagne ? C'est que je suis sûr qu'au milieu d'un bonheur solitaire, concentrée dans une existence dépouillée de tout faste, peu à peu tu oublieras cet odieux passé, qui t'est surtout pénible parce qu'il contraste amèrement avec les cérémonieux hommages dont à chaque instant tu es entourée.
– Rodolphe a raison, s'écria Clémence. Seule avec Henri, continuellement heureuse de son bonheur et du vôtre, il ne vous restera pas le temps de songer à vos chagrins d'autrefois, mon enfant.
– Puis, comme il me serait impossible d'être longtemps sans te voir, chaque année Clémence et moi nous irons vous visiter.
– Et un jour… lorsque la plaie dont vous souffrez tant, pauvre petite, sera cicatrisée… lorsque vous aurez trouvé l'oubli dans le bonheur… et ce moment arrivera plus tôt que vous ne le pensez… vous reviendrez près de nous pour ne plus nous quitter !
– L'oubli dans le bonheur !… murmura Fleur-de-Marie qui, malgré elle, se laissait bercer par ce songe enchanteur.
– Oui… oui, mon enfant, reprit Clémence, lorsqu'à chaque instant du jour vous vous verrez bénie, respectée, adorée par l'époux de votre choix, par l'homme dont votre père vous a mille fois vanté le cœur noble et généreux… aurez-vous le loisir de songer au passé ? Et, lors même que vous y songeriez… comment ce passé vous attristerait-il ? Comment vous empêcherait-il de croire à la radieuse félicité de votre mari ?
– Enfin c'est vrai… car dis-moi, mon enfant, reprit Rodolphe, qui pouvait à peine contenir des larmes de joie en voyant sa fille ébranlée, en présence de l'idolâtrie de ton mari pour toi… lorsque tu auras la conscience et la preuve du bonheur qu'il te doit… quels reproches pourras-tu te faire ?
– Mon père…, dit Fleur-de-Marie, oubliant le passé pour cette espérance ineffable, tant de bonheur me serait-il encore réservé ?
– Ah ! j'en étais bien sûr ! s'écria Rodolphe dans un élan de joie triomphante, est-ce qu'après tout un père qui le veut… ne peut pas rendre au bonheur son enfant adorée ?…
– Elle mérite tant… que nous devions être exaucés, mon ami, dit Clémence en partageant le ravissement du prince.
– Épouser Henri… et un jour… passer ma vie entre lui… ma seconde mère… et mon père…, répéta Fleur-de-Marie, subissant de plus en plus la douce ivresse de ces pensées.
– Oui, mon ange aimé, nous serons tous heureux !… Je vais répondre au père d'Henri que je consens au mariage, s'écria Rodolphe en serrant Fleur-de-Marie dans ses bras avec une émotion indicible. Rassure-toi, notre séparation sera passagère… les nouveaux devoirs que le mariage va t'imposer raffermiront encore tes pas dans cette voie d'oubli et de félicité où tu vas marcher désormais… car, enfin, si un jour tu es mère, ce ne sera pas seulement pour toi qu'il te faudra être heureuse…
– Ah ! s'écria Fleur-de-Marie avec un cri déchirant, car ce mot de mère la réveilla du songe enchanteur qui la berçait, mère !… moi ? Oh ! jamais ! Je suis indigne de ce saint nom… Je mourrais de honte devant mon enfant… si je n'étais pas morte de honte devant son père… en lui faisant l'aveu du passé…
– Que dit-elle ? mon Dieu ! s'écria Rodolphe, foudroyé par ce brusque changement…
– Moi mère ! reprit Fleur-de-Marie avec une amertume désespérée, moi respectée, moi bénie par un enfant innocent et candide ! Moi autrefois l'objet du mépris de tous ! Moi profaner ainsi le nom sacré de mère… oh ! jamais… Misérable folle que j'étais de me laisser entraîner à un espoir indigne !…
– Ma fille, par pitié, écoute-moi.
Fleur-de-Marie se leva droite, pâle, et belle de la majesté d'un malheur incurable.
– Mon père… nous oublions qu'avant de m'épouser… le prince Henri doit connaître ma vie passée.
– Je ne l'avais pas oublié, s'écria Rodolphe ; il doit tout savoir… il saura tout…
– Et vous ne voulez pas que je meure… de me voir ainsi dégradée à ses yeux ?
– Mais il saura aussi quelle irrésistible fatalité t'a jetée dans l'abîme… mais il saura ta réhabilitation.
– Et il sentira enfin, reprit Clémence en serrant Fleur-de-Marie dans ses bras, que lorsque je vous appelle ma fille… il peut sans honte vous appeler sa femme…
– Et moi… ma mère… j'aime trop… j'estime trop le prince Henri pour jamais lui donner une main qui a été touchée par les bandits de la Cité…
Peu de temps après cette scène douloureuse, on lisait dans la Gazette officielle de Gerolstein :
« Hier a eu lieu, en l'abbaye grand-ducale de Sainte-Hermangilde, en présence de Son Altesse Royale le grand-duc régnant et de toute la cour, la prise de voile de très-haute et très-puissante princesse Son Altesse Amélie de Gerolstein.
« Le noviciat a été reçu par l'illustrissime et révérendissime seigneur monseigneur Charles-Maxime, archevêque duc d'Oppenheim ; monseigneur Annibal-André Montano, des princes de Delphes, évêque de Ceuta in partibus infidelium et nonce apostolique, y a donné le salut et la bénédiction papale.
« Le sermon a été prononcé par le révérendissime seigneur Pierre d'Asfeld, chanoine du chapitre de Cologne, comte du Saint-Empire romain.
« VENI, CREATOR OPTIME. »
VII. La profession
RODOLPHE À CLÉMENCE
Gerolstein, 12 janvier 1842[5]
En me rassurant complètement aujourd'hui sur la santé de votre père, mon amie, vous me faites espérer que vous pourrez, avant la fin de cette semaine, le ramener ici. Je l'avais prévenu que dans la résidence de Rosenfeld, située au milieu des forêts, il serait exposé, malgré toutes les précautions possibles, à l'âpre rigueur de nos froids ; malheureusement sa passion pour la chasse a rendu nos conseils inutiles. Je vous en conjure, Clémence, dès que votre père pourra supporter le mouvement de la voiture, partez aussitôt ; quittez ce pays sauvage et cette sauvage demeure, seulement habitable pour ces vieux Germains au corps de fer dont la race a disparu.
Je tremble qu'à votre tour vous ne tombiez malade ; les fatigues de ce voyage précipité, les inquiétudes auxquelles vous avez été en proie jusqu'à votre arrivée auprès de votre père, toutes ces causes ont dû réagir cruellement sur vous. Que n'ai-je pu vous accompagner !…
Clémence, je vous en supplie, pas d'imprudence ; je sais combien vous êtes vaillante et dévouée… je sais de quels soins empressés vous allez entourer votre père ; mais il serait aussi désespéré que moi si votre santé s'altérait pendant ce voyage. Je déplore doublement la maladie du comte, car elle vous éloigne de moi dans un moment où j'aurais puisé bien des consolations dans votre tendresse…
La cérémonie de la profession de notre pauvre enfant est toujours fixée à demain… à demain 13 janvier, époque fatale… C'est le TREIZE JANVIER que j'ai tiré l'épée contre mon père…
Ah ! mon amie… je m'étais cru pardonné trop tôt… L'enivrant espoir de passer ma vie auprès de vous et de ma fille m'avait fait oublier que ce n'était pas moi, mais elle, qui avait été punie jusqu'à présent, et que mon châtiment était encore à venir.
Et il est venu… lorsqu'il y a six mois l'infortunée nous a dévoilé la double torture de son cœur : sa honte incurable du passé… jointe à son malheureux amour pour Henri…
Ces deux amers et brûlants ressentiments exaltés l'un par l'autre, devaient, par une logique fatale, amener son inébranlable résolution de prendre le voile. Vous le savez, mon amie, en combattant ce dessein de toutes les forces de notre adoration pour elle, nous ne pouvions nous dissimuler que sa digne et courageuse conduite eût été la nôtre. Que répondre à ces mots terribles : « J'aime trop le prince Henri pour lui donner une main touchée par les bandits de la Cité » ?
Elle a dû se sacrifier à ses nobles scrupules, au souvenir ineffaçable de sa honte ! Elle l'a fait vaillamment… Elle a renoncé aux splendeurs du monde, elle est descendue des marches d'un trône pour s'agenouiller, vêtue de bure, sur la dalle d'une église ; elle a croisé ses mains sur sa poitrine, courbé sa tête angélique… ses beaux cheveux blonds que j'aimais tant, et que je conserve comme un trésor, sont tombés tranchés par le fer…
Ô mon amie, vous savez notre émotion déchirante à ce moment lugubre et solennel ; cette émotion est, à cette heure, aussi poignante que par le passé… En vous écrivant ces mots, je pleure comme un enfant.
Je l'ai vue ce matin ; quoiqu'elle m'ait paru moins pâle que d'habitude, et qu'elle prétende ne pas souffrir… sa santé m'inquiète, mortellement. Hélas ! lorsque, sous le voile et le bandeau qui entourent son noble front, je vois ses traits amaigris qui ont la froide blancheur du marbre, et qui font paraître ses grands yeux bleus plus grands encore, je ne puis m'empêcher de songer au doux et pur éclat dont brillait sa beauté lors de notre mariage. Jamais, n'est-ce pas ? nous ne l'avions vue plus charmante… notre bonheur semblait rayonner sur son délicieux visage.
Comme je vous le disais, je l'ai vue ce matin ; elle n'est pas prévenue que la princesse Juliane se démet volontairement en sa faveur de sa dignité abbatiale : demain donc, jour de sa profession, notre enfant sera élue abbesse, puisqu'il y a unanimité parmi les demoiselles nobles de la communauté pour lui conférer cette dignité[6].
Depuis le commencement de son noviciat, il n'y a qu'une voix sur sa piété, sur sa charité, sur sa religieuse exactitude à remplir toutes les règles de son ordre, dont elle exagère malheureusement les austérités… Elle a exercé dans ce couvent l'influence qu'elle exerce partout, sans y prétendre et en l'ignorant, ce qui en augmente la puissance…
Son entretien de ce matin m'a confirmé ce dont je me doutais ; elle n'a pas trouvé dans la solitude du cloître et dans la pratique sévère de la vie monastique le repos et l'oubli… elle se félicite pourtant de sa résolution, qu'elle considère comme l'accomplissement d'un devoir impérieux ; mais elle souffre toujours, car elle n'est pas née pour ces contemplations mystiques, au milieu desquelles certaines personnes, oubliant toutes les affections, tous les souvenirs terrestres, se perdent en ravissements ascétiques.
Non, Fleur-de-Marie croit, elle prie, elle se soumet à la rigoureuse et dure observance de son ordre ; elle prodigue les consolations les plus évangéliques, les soins les plus humbles aux pauvres femmes malades qui sont traitées dans l'hospice de l'abbaye. Elle a refusé jusqu'à l'aide d'une sœur converse pour le modeste ménage de cette triste cellule froide et nue où nous avons remarqué avec un si douloureux étonnement, vous vous le rappelez, mon amie, les branches desséchées de son petit rosier, suspendues au-dessous de son christ. Elle est enfin l'exemple chéri, le modèle vénéré de la communauté… Mais elle me l'a avoué ce matin, en se reprochant cette faiblesse avec amertume, elle n'est pas tellement absorbée par la pratique et par les austérités de la vie religieuse, que le passé ne lui apparaisse sans cesse non-seulement tel qu'il a été… mais tel qu'il aurait pu être.
– Je m'en accuse, mon père, me disait-elle avec cette calme et douce résignation que vous lui connaissez, je m'en accuse, mais je ne puis m'empêcher de songer souvent, que, si Dieu avait voulu m'épargner la dégradation qui a flétri à jamais mon avenir, j'aurais pu vivre toujours auprès de vous, aimée de l'époux de votre choix. Malgré moi, ma vie se partage entre ces douloureux regrets et les effroyables souvenirs de la Cité. En vain je prie Dieu de me délivrer de ces obsessions, de remplir uniquement mon cœur de son pieux amour, de ses saintes espérances, de me prendre enfin tout entière, puisque je veux me donner tout entière à lui… il n'exauce pas mes vœux… sans doute parce que mes préoccupations terrestres me rendent indigne d'entrer en communication avec lui.
– Mais alors, m'écriai-je, saisi d'une folle lueur d'espérance, il en est temps encore, aujourd'hui ton noviciat finit, mais c'est seulement demain qu'aura lieu ta profession solennelle ; tu es encore libre, renonce à cette vie si rude et si austère qui ne t'offre pas les consolations que tu attendais ; souffrir pour souffrir, viens souffrir dans nos bras, notre tendresse adoucira tes chagrins.
Secouant tristement la tête, elle me répondit avec cette inflexible justesse de raisonnement qui nous a si souvent frappés :
– Sans doute, mon bon père, la solitude est bien triste pour moi… pour moi déjà si habituée à vos tendresses de chaque instant. Sans doute je suis poursuivie par d'amers regrets, de navrants souvenirs ; mais au moins j'ai la conscience d'accomplir un devoir… mais je comprends, mais je sais que partout ailleurs qu'ici je serais déplacée ; je me retrouverais dans cette condition si cruellement fausse… dont j'ai déjà tant souffert… et pour moi… et pour vous… car j'ai ma fierté aussi. Votre fille sera ce qu'elle doit être… fera ce qu'elle doit faire, subira ce qu'elle doit subir… Demain tous sauraient de quelle fange vous m'avez tirée… qu'en me voyant repentante au pied de la croix on me pardonnerait peut-être le passé en faveur de mon humilité présente… Et il n'en serait pas ainsi, n'est-ce pas ? mon bon père, si l'on me voyait, comme il y a quelques mois, briller au milieu des splendeurs de votre cour. D'ailleurs, satisfaire aux justes et sévères exigences du monde, c'est me satisfaire moi-même ; aussi je remercie et je bénis Dieu de toute la puissance de mon âme, en songeant que lui seul pouvait offrir à votre fille un asile et une position dignes d'elle et de vous… une position enfin qui ne formât pas un affligeant contraste avec ma dégradation première… et pût mériter le seul respect qui me soit dû… celui que l'on accorde au repentir et à l'humilité sincères.
Hélas ! Clémence… que répondre à cela ?…
Fatalité ! Fatalité ! Car cette malheureuse enfant est douée, si cela peut se dire, d'une inexorable logique en tout ce qui touche les délicatesses du cœur et de l'honneur. Avec un esprit et une âme pareils, il ne faut pas songer à pallier, à tourner les positions fausses ; il faut en subir les implacables conséquences…
Je l'ai quittée, comme toujours, le cœur brisé.
Sans fonder le moindre espoir sur cette entrevue, qui sera la dernière avant sa profession, je m'étais dit : « Aujourd'hui encore elle peut renoncer au cloître. » Mais vous le voyez, mon amie, sa volonté est irrévocable, et je dois, hélas ! en convenir avec elle et répéter ses paroles : « Dieu seul pouvait lui offrir un asile et une position dignes d'elle et de moi. »
Encore une fois, sa résolution est admirablement convenable et logique au point de vue de la société où nous vivons… Avec l'exquise susceptibilité de Fleur-de-Marie, il n'y a pas pour elle d'autre condition possible. Mais, je vous l'ai dit bien souvent, mon amie, si des devoirs sacrés, plus sacrés encore que ceux de la famille, ne me retenaient pas au milieu de ce peuple qui m'aime et dont je suis un peu la providence, je serais allé avec vous, ma fille, Henri et Murph, vivre heureux et obscur dans quelque retraite ignorée. Alors, loin des lois impérieuses d'une société impuissante à guérir les maux qu'elle a faits, nous aurions bien forcé cette malheureuse enfant au bonheur et à l'oubli… tandis qu'ici, au milieu de cet éclat, de ce cérémonial, si restreint qu'il fût, c'était impossible… Mais encore une fois… fatalité ! fatalité ! je ne puis abdiquer mon pouvoir sans compromettre le bonheur de ce peuple, qui compte sur moi… Braves et dignes gens ! qu'ils ignorent toujours ce que leur fidélité me coûte !…
Adieu, tendrement adieu, ma bien-aimée Clémence. Il m'est presque consolant de vous voir aussi affligée que moi du sort de mon enfant, car ainsi je puis dire notre chagrin, et il n'y a pas d'égoïsme dans ma souffrance.
Quelquefois je me demande avec effroi ce que je serais devenu sans vous au milieu de circonstances si douloureuses… Souvent aussi ces pensées m'apitoient encore davantage sur le sort de Fleur-de-Marie… Car vous me restez, vous… Et à elle, que lui reste-t-il ?
Adieu encore, et tristement adieu, noble amie, bon ange des jours mauvais. Revenez bientôt ; cette absence vous pèse autant qu'à moi…
À vous ma vie et mon amour !… âme et cœur, à vous !
R.
Je vous envoie cette lettre par un courrier ; à moins de changement imprévu, je vous en expédierai une autre demain, sitôt après la triste cérémonie. Mille vœux et espoirs à votre père pour son prompt rétablissement. J'oubliais de vous donner des nouvelles du pauvre Henri. Son état s'améliore et ne donne plus de si graves inquiétudes. Son excellent père, malade lui-même, a retrouvé des forces pour le soigner, pour le veiller ; miracle d'amour paternel qui ne nous étonne pas, nous autres.
Ainsi donc, amie, à demain… demain, jour sinistre et néfaste pour moi !
À vous encore, à vous toujours.
R.
Abbaye de Sainte-Hermangilde, quatre heures du matin.
Rassurez-vous, Clémence, rassurez-vous, quoique l'heure à laquelle je vous écris cette lettre et le lieu d'où elle est datée doivent vous effrayer…
Grâce à Dieu, le danger est passé ; mais la crise a été terrible…
Hier, après vous avoir écrit, agité par je ne sais quel funeste pressentiment, me rappelant la pâleur, l'air souffrant de ma fille, l'état de faiblesse où elle languit depuis quelque temps, songeant enfin qu'elle devait passer en prières, dans une immense et glaciale église, presque toute cette nuit qui précède sa profession, j'ai envoyé Murph et David à l'abbaye demander à la princesse Juliane de leur permettre de rester jusqu'à demain dans la maison extérieure qu'Henri habitait ordinairement. Ainsi ma fille pouvait avoir de prompts secours et moi de ses nouvelles si, comme je le craignais, les forces lui manquaient pour accomplir cette rigoureuse… je ne veux pas dire cruelle… obligation de rester une nuit de janvier en prières par un froid excessif. J'avais aussi écrit à Fleur-de-Marie que, tout en respectant l'exercice de ses devoirs religieux, je la suppliais de songer à sa santé et de faire sa veillée de prières dans sa cellule et non dans l'église. Voici ce qu'elle m'a répondu :
« Mon bon père, je vous remercie du plus profond de mon cœur de cette nouvelle et tendre preuve de votre intérêt. N'ayez aucune inquiétude ; je me crois en état d'accomplir mon devoir. Votre fille, mon bon père, ne peut témoigner ni crainte ni faiblesse. La règle est telle, je dois m'y conformer. En résultât-il quelques souffrances physiques, c'est avec joie que je les offrirais à Dieu. Vous m'approuverez, je l'espère, vous qui avez toujours pratiqué le renoncement et le devoir avec tant de courage. Adieu, mon bon père, je ne vous dirai pas que je vais prier pour vous. En priant Dieu, je vous prie toujours, car il m'est impossible de ne pas vous confondre avec la divinité que j'implore. Vous avez été pour moi sur la terre ce que Dieu, si je le mérite, sera pour moi dans le ciel.
« Daignez bénir ce soir votre fille par la pensée, mon bon père… Elle sera demain l'épouse du Seigneur.
« Elle vous baise la main avec un pieux respect.
« Sœur AMÉLIE »
Cette lettre, que je ne pus lire sans fondre en larmes, me rassura pourtant quelque peu ; je devais, moi aussi, accomplir une veillée sinistre.
La nuit venue, j'allai m'enfermer dans le pavillon que j'ai fait construire non loin du monument élevé au souvenir de mon père, en expiation de cette nuit fatale…
Vers une heure du matin, j'entendis la voix de Murph ; je frissonnai d'épouvante. Il arrivait en toute hâte du couvent.
Que vous dirai-je, mon amie ? Ainsi que je l'avais prévu, la malheureuse enfant, malgré son courage et sa volonté, n'a pas eu la force d'accomplir entièrement cette pratique barbare, dont il avait été impossible à la princesse Juliane de la dispenser, la règle étant formelle à ce sujet.
À huit heures du soir, Fleur-de-Marie s'est agenouillée sur la pierre de cette église. Jusqu'à plus de minuit elle a prié. Mais, à cette heure, succombant à sa faiblesse, à cet horrible froid, à son émotion, car elle a longuement et silencieusement pleuré, elle s'est évanouie. Deux religieuses, qui, par ordre de la princesse Juliane, avaient partagé sa veillée, vinrent la relever et la transportèrent dans sa cellule.
David fut à l'instant prévenu. Murph monta en voiture, accourut me chercher. Je volai au couvent ; je fus reçu par la princesse Juliane. Elle me dit que David craignait que ma vue ne fît une trop vive impression sur ma fille ; que son évanouissement, dont elle était revenue, ne présentait rien de très-alarmant, ayant été causé seulement par une grande faiblesse.
D'abord une horrible pensée me vint. Je crus qu'on voulait me cacher quelque grand malheur, ou du moins me préparer à l'apprendre ; mais la supérieure me dit : « Je vous l'affirme, monseigneur, la princesse Amélie est hors de danger ; un léger cordial que le docteur David lui a fait prendre a ranimé ses forces. »
Je ne pouvais douter de ce que m'affirmait l'abbesse ; je la crus, et j'attendis des nouvelles de ma fille avec une douloureuse impatience.
Au bout d'un quart d'heure d'angoisses, David revint. Grâce à Dieu, elle allait mieux, et elle avait voulu continuer sa veillée de prières dans l'église, en consentant seulement à s'agenouiller sur un coussin. Et, comme je me révoltais et m'indignais de ce que la supérieure et lui eussent accédé à son désir, ajoutant que je m'y opposais formellement, il me répondit qu'il eût été dangereux de contrarier la volonté de ma fille dans un moment où elle était sous l'influence d'une vive émotion nerveuse, et que d'ailleurs il était convenu avec la princesse Juliane que la pauvre enfant quitterait l'église à l'heure des matines pour prendre un peu de repos et se préparer à la cérémonie.
– Elle est donc maintenant à l'église ? lui dis-je.
– Oui, monseigneur ; mais avant une demi-heure elle l'aura quittée.
Je me fis aussitôt conduire à notre tribune du nord, d'où l'on domine tout le chœur.
Là, au milieu des ténèbres de cette vaste église, seulement éclairée par la pâle clarté de la lampe du sanctuaire, je la vis, près de la grille, agenouillée, les mains jointes, et priant encore avec ferveur.
Moi aussi je m'agenouillai en pensant à mon enfant.
Trois heures sonnèrent ; deux sœurs assises dans les stalles, qui ne l'avaient pas quittée des yeux, vinrent lui parler bas. Au bout de quelques moments elle se signa, se releva et traversa le chœur d'un pas assez ferme ; et pourtant, mon amie, lorsqu'elle passa sous la lampe, son visage me parut aussi blanc que le long voile qui flottait autour d'elle.
Je sortis aussitôt de la tribune, voulant d'abord aller la rejoindre ; mais je craignis qu'une nouvelle émotion l'empêchât de goûter quelques moments de repos. J'envoyai David savoir comment elle se trouvait : il revint me dire qu'elle se sentait mieux et qu'elle allait tâcher de dormir un peu.
Je reste à l'abbaye pour la cérémonie qui aura lieu ce matin.
Je pense maintenant, mon amie, qu'il est inutile de vous envoyer cette lettre incomplète. Je la terminerai demain, en vous racontant les événements de cette triste journée.
À bientôt donc, mon amie. Je suis brisé de douleur, plaignez-moi.
Dernier chapitre. Le 13 janvier
RODOLPHE À CLÉMENCE.
Treize janvier… anniversaire maintenant doublement sinistre ! ! !
Mon amie… nous la perdons à jamais !
Tout est fini… tout !
Écoutez ce récit :
Il est donc vrai… on éprouve une volupté atroce à raconter une horrible douleur.
Hier je me plaignais du hasard qui vous retenait loin de moi… aujourd'hui, Clémence, je me félicite de ce que vous n'êtes pas ici : vous souffririez trop…
Ce matin, je sommeillais à peine, j'ai été éveillé par le son des cloches… j'ai tressailli d'effroi… cela m'a semblé funèbre… on eût dit un glas de funérailles.
En effet… ma fille est morte pour nous… morte, entendez-vous… Dès aujourd'hui, Clémence… il vous faut commencer à porter son deuil dans votre cœur, dans votre cœur toujours pour elle si maternel.
Que notre enfant soit ensevelie sous le marbre d'un tombeau ou sous la voûte d'un cloître… pour nous… quelle est la différence ?
Dès aujourd'hui, entendez-vous, Clémence, il faut la regarder comme morte… D'ailleurs… elle est d'une si grande faiblesse… sa santé, altérée par tant de chagrins, par tant de secousses, est si chancelante… Pourquoi pas aussi cette autre mort, plus complète encore ? La fatalité n'est pas lasse…
Et puis d'ailleurs… d'après ma lettre d'hier, vous devez comprendre que cela serait peut-être plus heureux pour elle… qu'elle fût morte.
Morte… ces cinq lettres ont une physionomie étrange… ne trouvez-vous pas ?… quand on les écrit à propos d'une fille idolâtrée… d'une fille si belle… si charmante, d'une bonté si angélique… Dix-huit ans à peine… et morte au monde !…
Au fait… pour nous et pour elle, à quoi bon végéter souffrante dans la morne tranquillité de ce cloître ? Qu'importe qu'elle vive, si elle est perdue pour nous ? Elle doit tant l'aimer, la vie… que la fatalité lui a faite !…
Ce que je dis là est affreux… il y a un égoïsme barbare dans l'amour paternel !…
À midi, sa profession a eu lieu avec une pompe solennelle.
Caché derrière les rideaux de notre tribune, j'y ai assisté…
J'ai ressenti, mais avec encore plus d'intensité, toutes les poignantes émotions que nous avions éprouvées lors de son noviciat…
Chose bizarre ! elle est adorée, on croit généralement qu'elle est attirée vers la vie religieuse par une irrésistible vocation, on devrait voir dans sa profession un événement heureux pour elle, et, au contraire, une accablante tristesse pesait sur la foule.
Au fond de l'église, parmi le peuple… j'ai vu deux sous-officiers de mes gardes, deux vieux et rudes soldats, baisser la tête et pleurer…
On eût dit qu'il y avait dans l'air un douloureux pressentiment… Du moins s'il était fondé, il n'est réalisé qu'à demi…
La profession terminée, on a ramené notre enfant dans la salle du chapitre, où devait avoir lieu la nomination de la nouvelle abbesse…
Grâce à mon privilège souverain, j'allai dans cette salle attendre Fleur-de-Marie au retour du chœur.
Elle rentra bientôt…
Son émotion, sa faiblesse étaient si grandes que deux sœurs la soutenaient…
Je fus effrayé, moins encore de sa pâleur et de la profonde altération de ses traits que de l'expression de son sourire… Il me parut empreint d'une sorte de satisfaction sinistre…
Clémence… je vous le dis… peut-être bientôt nous faudra-t-il du courage… bien du courage… Je sens pour ainsi dire en moi que notre enfant est mortellement frappée…
… Après tout, sa vie serait si malheureuse…
Voilà deux fois que je me dis, en pensant à la mort possible de ma fille… que cette mort mettrait du moins un terme à sa cruelle existence… Cette pensée est un horrible symptôme… Mais, si ce malheur doit nous frapper, il vaut mieux y être préparé, n'est-ce pas, Clémence ?
Se préparer à un pareil malheur… c'est en savourer peu à peu et d'avance les lentes angoisses… C'est un raffinement de douleurs inouï… Cela est mille fois plus affreux que le coup qui vous frappe imprévu… Au moins la stupeur, l'anéantissement vous épargnent une partie de cet atroce déchirement…
Mais les usages de la compassion veulent qu'on vous prépare… Probablement je n'agirais pas autrement moi-même, pauvre amie… si j'avais à vous apprendre le funeste événement dont je vous parle… Ainsi épouvantez-vous… si vous remarquez que je vous entretiens d'elle… avec des ménagements, des détours d'une tristesse désespérée, après vous avoir annoncé que sa santé ne me donnait pourtant pas de graves inquiétudes.
Oui, épouvantez-vous, si je vous parle comme je vous écris maintenant… car, quoique je l'aie quittée assez calme il y a une heure pour venir terminer cette lettre, je vous le répète, Clémence, il me semble ressentir en moi qu'elle est plus souffrante qu'elle ne le paraît… Fasse le ciel que je me trompe, et que je prenne pour des pressentiments la désespérante tristesse que m'a inspirée cette cérémonie lugubre !
Fleur-de-Marie entra donc dans la grande salle du chapitre.
Toutes les stalles furent successivement occupées par les religieuses.
Elle alla modestement se mettre à la dernière place de la rangée de gauche ; elle s'appuyait sur le bras d'une des sœurs, car elle semblait toujours bien faible.
Au haut de la salle, la princesse Juliane était assise, ayant d'un côté la grande prieure, de l'autre une seconde dignitaire, tenant à la main la crosse d'or, symbole de l'autorité abbatiale.
Il se fit un profond silence, la princesse se leva, prit sa crosse en main et dit d'une voix grave et émue :
– Mes chères filles, mon grand âge m'oblige de confier à des mains plus jeunes cet emblème de mon pouvoir spirituel, et elle montra sa crosse. J'y suis autorisée par une bulle de notre Saint-Père ; je présenterai donc à la bénédiction de monseigneur l'archevêque d'Oppenheim et à l'approbation de S. A. R. le grand-duc, notre souverain, celle de vous, mes chères filles, qui par vous aura été désignée pour me succéder. Notre grande prieure va vous faire connaître le résultat de l'élection, et à celle-là que vous aurez élue je remettrai ma crosse et mon anneau.
Je ne quittai pas ma fille des yeux.
Debout dans sa stalle, les deux mains jointes sur sa poitrine, les yeux baissés, à demi enveloppée de son voile blanc et des longs plis traînants de sa robe noire, elle se tenait immobile et pensive, elle n'avait pas un moment supposé qu'on pût l'élire ; son élévation n'avait été confiée qu'à moi par l'abbesse.
La grande prieure prit un registre et lut :
– Chacune de nos chères sœurs ayant été, suivant la règle, invitée, il y a huit jours, à déposer son vote entre les mains de notre sainte mère et à tenir son choix secret jusqu'à ce moment ; au nom de notre sainte mère, je déclare qu'une de vous, mes chères sœurs, a par sa piété exemplaire, par ses vertus angéliques, mérité le suffrage unanime de la communauté, et celle-là est notre sœur Amélie, de son vivant très-haute et très-puissante princesse de Gerolstein.
À ces mots, une sorte de murmure de douce surprise et d'heureuse satisfaction circula dans la salle ; tous les regards des religieuses se fixèrent sur ma fille avec une expression de tendre sympathie ; malgré mes accablantes préoccupations, je fus moi-même vivement ému de cette nomination qui, faite isolément et secrètement, offrait néanmoins une si touchante unanimité.
Fleur-de-Marie, stupéfaite, devint encore plus pâle ; ses genoux tremblaient si fort qu'elle fut obligée de s'appuyer d'une main sur le rebord de la stalle.
L'abbesse reprit d'une voix haute et grave :
– Mes chères filles, c'est bien sœur Amélie que vous croyez la plus digne et la plus méritante de vous toutes ? C'est bien elle que vous reconnaissez pour votre supérieure spirituelle ? Que chacune de vous me réponde à son tour, mes chères filles.
Et chaque religieuse répondit à haute voix :
– Librement et volontairement j'ai choisi et je choisis sœur Amélie pour ma sainte mère et supérieure.
Saisie d'une émotion inexprimable, ma pauvre enfant tomba à genoux, joignit les deux mains et resta ainsi jusqu'à ce que chaque vote fût émis.
Alors l'abbesse, déposant la crosse et l'anneau entre les mains de la grande prieure, s'avança vers ma fille pour la prendre par la main et la conduire au siège abbatial.
Mon amie, ma tendre amie, je me suis interrompu un moment ; il m'a fallu reprendre courage pour achever de vous raconter cette scène déchirante…
– Relevez-vous, ma chère fille, lui dit l'abbesse, venez prendre la place qui vous appartient ; vos vertus évangéliques, et non votre rang, vous l'ont gagnée.
En disant ces mots, la vénérable princesse se pencha vers ma fille pour l'aider à se relever.
Fleur-de-Marie fit quelques pas en tremblant, puis arrivant au milieu de la salle du chapitre elle s'arrêta, et dit d'une voix dont le calme et la fermeté m'étonnèrent :
– Pardonnez-moi, sainte mère… je voudrais parler à mes sœurs.
– Montez d'abord, ma chère fille, sur votre siège abbatial, dit la princesse ; c'est de là que vous devez leur faire entendre votre voix.
– Cette place, sainte mère… ne peut être la mienne, répondit Fleur-de-Marie d'une voix haute et tremblante.
– Que dites-vous, ma chère fille ?
– Une si haute dignité n'est pas faite pour moi, sainte mère.
– Mais les vœux de toutes vos sœurs vous y appellent.
– Permettez-moi, sainte mère, de faire ici à deux genoux une confession solennelle, mes sœurs verront bien, et vous aussi, sainte mère, que la condition la plus humble n'est pas encore assez humble pour moi.
– Votre modestie vous abuse, ma chère fille, dit la supérieure avec bonté, croyant en effet que la malheureuse enfant cédait à un sentiment de modestie exagéré ; mais moi je devinai ces aveux que Fleur-de-Marie allait faire. Saisi d'effroi, je m'écriai d'une voix suppliante :
– Mon enfant… je t'en conjure…
À ces mots… vous dire, mon amie, tout ce que je lus dans le profond regard que Fleur-de-Marie me jeta serait impossible… Ainsi que vous le saurez dans un instant, elle m'avait compris. Oui, elle avait compris que je devais partager la honte de cette horrible révélation… Elle avait compris qu'après de tels aveux on pouvait m'accuser… moi, de mensonge… car j'avais toujours dû laisser croire que jamais Fleur-de-Marie n'avait quitté sa mère…
À cette pensée, la pauvre enfant s'était crue coupable envers moi d'une noire ingratitude… Elle n'eut pas la force de continuer, elle se tut et baissa la tête avec accablement…
– Encore une fois, ma chère fille, reprit l'abbesse, votre modestie vous trompe… l'unanimité du choix de vos sœurs vous prouve combien vous êtes digne de me remplacer… Par cela même que vous avez pris part aux joies du monde, votre renoncement à ces joies n'en est que plus méritoire… Ce n'est pas S. A. la princesse Amélie qui est élue, c'est sœur Amélie… Pour nous, votre vie a commencé du jour où vous avez mis le pied dans la maison du Seigneur… et c'est cette exemplaire et sainte vie que nous récompensons… Je vous dirai plus, ma chère fille ; avant d'entrer au bercail votre existence aurait été aussi égarée qu'elle a été au contraire pure et louable… que les vertus évangéliques dont vous nous avez donné l'exemple depuis votre séjour ici expieraient et rachèteraient encore aux yeux du Seigneur un passé si coupable qu'il fût… D'après cela, ma chère fille, jugez si votre modestie doit être rassurée.
Ces paroles de l'abbesse furent, comme vous le pensez, mon amie, d'autant plus précieuses pour Fleur-de-Marie qu'elle croyait le passé ineffaçable. Malheureusement, cette scène l'avait profondément émue, et, quoiqu'elle affectât du calme et de la fermeté, il me sembla que ses traits s'altéraient d'une manière inquiétante… Par deux fois elle tressaillit en passant sur son front sa pauvre main amaigrie.
– Je crois vous avoir convaincue, ma chère fille, reprit la princesse Juliane, et vous ne voudrez pas causer à vos sœurs un vif chagrin en refusant cette marque de leur confiance et de leur affection.
– Non, sainte mère, dit-elle avec une expression qui me frappa, et d'une voix de plus en plus faible, je crois maintenant pouvoir accepter… Mais, comme je me sens bien fatiguée et un peu souffrante, si vous le permettiez, sainte mère, la cérémonie de ma consécration n'aurait lieu que dans quelques jours…
– Il sera fait comme vous le désirez, ma chère fille… mais en attendant que votre dignité soit bénie et consacrée… prenez cet anneau… venez à votre place… nos chères sœurs vous rendront hommage selon notre règle.
Et la supérieure, glissant son anneau pastoral au doigt de Fleur-de-Marie, la conduisit au siège abbatial.
Ce fut un spectacle simple et touchant.
Auprès de ce siège où elle s'assit, se tenaient, d'un côté, la grande prieure, portant la crosse d'or ; de l'autre, la princesse Juliane. Chaque religieuse alla s'incliner devant notre enfant et lui baiser respectueusement la main.
Je voyais à chaque instant son émotion augmenter, ses traits se décomposer davantage ; enfin cette scène fut sans doute au-dessus de ses forces… car elle s'évanouit avant que la procession des sœurs fût terminée…
Jugez de mon épouvante !… Nous la transportâmes dans l'appartement de l'abbesse…
David n'avait pas quitté le couvent ; il accourut, lui donna les premiers soins. Puisse-t-il ne m'avoir pas trompé ! mais il m'a assuré que ce nouvel accident n'avait pour cause qu'une extrême faiblesse causée par le jeûne, les fatigues et la privation de sommeil que ma fille s'était imposés pendant son rude et long noviciat…
Je l'ai cru, parce que en effet ses traits angéliques, quoique d'une effrayante pâleur, ne trahissaient aucune souffrance lorsqu'elle reprit connaissance… Je fus même frappé de la sérénité qui rayonnait sur son beau front. De nouveau cette quiétude m'effraya : il me sembla qu'elle cachait le secret espoir d'une délivrance prochaine…
La supérieure était retournée au chapitre pour clore la séance, je restai seul avec ma fille.
Après m'avoir regardé en silence pendant quelques moments, elle me dit :
– Mon bon père… pourrez-vous oublier mon ingratitude ? Pourrez-vous oublier qu'au moment où j'allais faire cette pénible confession vous m'avez demandé grâce ?
– Tais-toi… je t'en supplie.
– Et je n'avais pas songé, reprit-elle avec amertume, qu'en disant à la face de tous de quel abîme de dépravation vous m'aviez retirée… c'était révéler un secret que vous aviez gardé par tendresse pour moi… c'était vous accuser publiquement, vous, mon père, d'une dissimulation à laquelle vous ne vous étiez résigné que pour m'assurer une vie éclatante et honorée… Oh ! pourrez-vous me pardonner ?
Au lieu de lui répondre, je collai mes lèvres sur son front, elle sentit couler mes larmes…
Après avoir baisé mes mains à plusieurs reprises, elle me dit :
– Maintenant, je me sens mieux, mon bon père… maintenant que me voici, ainsi que le dit notre règle, morte au monde… je voudrais faire quelques dispositions en faveur de plusieurs personnes… mais, comme tout ce que je possède est à vous… m'y autorisez-vous, mon père ?…
– Peux-tu en douter ?… Mais je t'en supplie, lui dis-je, n'aie pas de ces pensées sinistres… Plus tard tu t'occuperas de ce soin… n'as-tu pas le temps ?
– Sans doute, mon bon père, j'ai encore bien du temps à vivre, ajouta-t-elle avec un accent qui, je ne sais pourquoi, me fit de nouveau tressaillir. Je la regardai plus attentivement ; aucun changement dans ses traits ne justifia mon inquiétude. Oui, j'ai encore bien du temps à vivre, reprit-elle, mais je ne devrai plus m'occuper des choses terrestres… car, aujourd'hui, je renonce à tout ce qui m'attache au monde… Je vous en prie, ne me refusez pas…
– Ordonne… je ferai ce que tu désires…
– Je voudrais que ma tendre mère gardât toujours dans le petit salon où elle se tient habituellement… mon métier à broder… avec la tapisserie que j'avais commencée…
– Tes désirs seront remplis, mon enfant. Ton appartement est resté comme il était le jour où tu as quitté le palais ; car tout ce qui t'a appartenu est pour nous l'objet d'un culte religieux… Clémence sera profondément touchée de ta pensée…
– Quant à vous, mon bon père, prenez, je vous en prie, mon grand fauteuil d'ébène, où j'ai tant pensé, tant rêvé…
– Il sera placé à côté du mien, dans mon cabinet de travail, et je t'y verrai chaque jour assise près de moi, comme tu t'y asseyais si souvent, lui dis-je sans pouvoir retenir mes larmes.
– Maintenant, je voudrais laisser quelques souvenirs de moi à ceux qui m'ont témoigné tant d'intérêt quand j'étais malheureuse. À Mme Georges je voudrais donner l'écritoire dont je me servais dernièrement. Ce don aura quelque à-propos, ajouta-t-elle avec son doux sourire, car c'est elle qui, à la ferme, a commencé de m'apprendre à écrire. Quant au vénérable curé de Bouqueval, qui m'a instruite dans la religion, je lui destine le beau christ de mon oratoire…
– Bien, mon enfant.
– Je désirerais aussi envoyer mon bandeau de perles à ma bonne petite Rigolette… C'est un bijou simple qu'elle pourra porter sur ses beaux cheveux noirs… Et puis, si cela était possible, puisque vous savez où se trouvent Martial et la Louve en Algérie, je voudrais que cette courageuse femme qui m'a sauvé la vie eût ma croix d'or émaillée… Ces différents gages de souvenir, mon bon père, seraient remis à ceux à qui je les envoie « de la part de Fleur-de-Marie ».
– J'exécuterai tes volontés… Tu n'oublies personne ?…
– Je ne crois pas, mon bon père…
– Cherche bien… Parmi ceux qui t'aiment n'y a-t-il pas quelqu'un de bien malheureux ? d'aussi malheureux que ta mère et moi… quelqu'un enfin qui regrette aussi douloureusement que nous ton entrée au couvent ?
La pauvre enfant me comprit, me serra la main, une légère rougeur colora un instant son pâle visage.
Allant au-devant d'une question qu'elle craignait sans doute de me faire, je lui dis :
– Il va mieux… on ne craint plus pour ses jours…
– Et son père ?
– Il se ressent de l'amélioration de la santé de son fils… il va mieux aussi… Et à Henri ? Que lui donnes-tu ?… Un souvenir de toi lui serait une consolation si chère et si précieuse !…
– Mon père… offrez-lui mon prie-Dieu… Hélas ! je l'ai bien souvent arrosé de mes larmes, en demandant au ciel la force d'oublier Henri, puisque j'étais indigne de son amour…
– Combien il sera heureux de voir que tu as eu une pensée pour lui !…
– Quant à la maison d'asile pour les orphelines et les jeunes filles abandonnées de leurs parents, je désirerais, mon bon père, que…
Ici la lettre de Rodolphe était interrompue par ces mots presque illisibles :
« Clémence… Murph terminera cette lettre ; je n'ai plus la tête à moi ; je suis fou… Ah ! le 13 JANVIER ! ! ! »
La fin de cette lettre, de l'écriture de Murph, était ainsi conçue :
Madame,
D'après les ordres de Son Altesse Royale, je complète ce triste récit. Les deux lettres de monseigneur auront dû préparer Votre Altesse Royale à l'accablante nouvelle qu'il me reste à lui apprendre.
Il y a trois heures, monseigneur était occupé à écrire à Votre Altesse Royale ; j'attendais dans une pièce voisine qu'il me remît la lettre pour l'expédier aussitôt par un courrier. Tout à coup j'ai vu entrer la princesse Juliane d'un air consterné. « Où est Son Altesse Royale ? me dit-elle d'une voix émue. – Princesse, monseigneur écrit à Mme la grande-duchesse des nouvelles de la journée. – Sir Walter, il faut apprendre à monseigneur un événement terrible… Vous êtes son ami… veuillez l'en instruire… De vous, ce coup lui sera moins terrible…
Je compris tout ; je crus plus prudent de me charger de cette funeste révélation… La supérieure ayant ajouté que la princesse Amélie s'éteignait lentement, et que monseigneur, devait se hâter de venir recevoir les derniers soupirs de sa fille, je n'avais malheureusement pas le temps d'employer des ménagements. J'entrai dans le salon ; Son Altesse Royale s'aperçut de ma pâleur. « Tu viens m'apprendre un malheur !… – Un irréparable malheur, monseigneur… Du courage !… – Ah ! mes pressentiments ! !… » s'écria-t-il. Et, sans ajouter un mot, il courut au cloître. Je le suivis.
De l'appartement de la supérieure, la princesse Amélie avait été transportée dans sa cellule après sa dernière entrevue avec monseigneur. Une des sœurs la veillait ; au bout d'une heure, elle s'aperçut que la voix de la princesse Amélie, qui lui parlait par intervalles, s'affaiblissait et s'oppressait de plus en plus. La sœur s'empressa d'aller prévenir la supérieure. Le docteur David fut appelé ; il crut remédier à cette nouvelle perte de forces par un cordial, mais en vain ; le pouls était à peine sensible… Il reconnut avec désespoir que, des émotions réitérées ayant probablement usé le peu de forces de la princesse Amélie, il ne restait aucun espoir de la sauver.
Ce fut alors que monseigneur arriva ; la princesse Amélie venait de recevoir les derniers sacrements, une lueur de connaissance lui restait encore ; dans une de ses mains, croisées sur son sein, elle tenait les débris de son petit rosier…
Monseigneur tomba agenouillé à son chevet ; il sanglotait.
– Ma fille !… mon enfant chérie !… s'écria-t-il d'une voix déchirante.
La princesse Amélie l'entendit, tourna légèrement la tête vers lui… ouvrit les yeux… tâcha de sourire, et dit d'une voix défaillante :
– Mon bon père… pardon… aussi à Henri… à ma bonne mère… pardon…
Ce furent ses derniers mots…
Après une heure d'une agonie pour ainsi dire paisible… elle rendit son âme à Dieu…
Lorsque sa fille eut rendu le dernier soupir, monseigneur ne dit pas un mot… son calme et son silence étaient effrayants… il ferma les paupières de la princesse, la baisa plusieurs fois au front, prit pieusement les débris du petit rosier et sortit de la cellule.
Je le suivis ; il revint dans la maison extérieure du cloître, et, me montrant la lettre qu'il avait commencé d'écrire à Votre Altesse Royale, et à laquelle il voulut en vain ajouter quelques mots, car sa main tremblait convulsivement, il me dit :
– Il m'est impossible d'écrire… Je suis anéanti… ma tête se perd ! Écris à la grande-duchesse que je n'ai plus de fille !…
J'ai exécuté les ordres de monseigneur.
Qu'il me soit permis, comme à son plus vieux serviteur, de supplier Votre Altesse Royale de hâter son retour… autant que la santé de M. le comte d'Orbigny le permettra. La présence seule de Votre Altesse Royale pourrait calmer le désespoir de monseigneur… Il veut chaque nuit veiller sur sa fille jusqu'au jour où elle sera ensevelie dans la chapelle grand-ducale.
J'ai accompli ma triste tâche, madame ; veuillez excuser l'incohérence de cette lettre, et recevoir l'expression du respectueux dévouement avec lequel j'ai l'honneur d'être de Votre Altesse Royale,
Le très-obéissant serviteur,
WALTER MURPH.
La veille du service funèbre de la princesse Amélie, Clémence arriva à Gerolstein avec son père.
Rodolphe ne fut pas seul le jour des funérailles de Fleur-de-Marie.
Fin de l'épilogue.
Fin des Mystères de Paris
Source: Wikisource
Cet enregistrement est mis à disposition sous un contrat Art Libre.
Cet enregistrement est mis à disposition sous un contrat Creative Commons.
Cet enregistrement est mis à disposition sous un contrat Creative Commons.
Warning: Undefined variable $cookies in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 7
Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 7
Warning: Undefined variable $validcookiesStats in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 7
Warning: Undefined variable $cookies in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 134
Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 134
Warning: Undefined variable $validcookiesSoc in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 134







