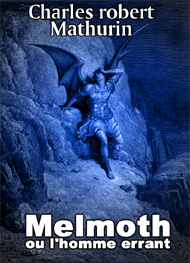
Melmoth ou l'homme errant-Quatrième partie
Enregistrement : Audiocite.net
Publication : 2011-01-01
Lu par Eric
Livre audio de 4h
Fichier Zip de 159 Mo (il contient des mp3)

Télécharger
(clic droit "enregistrer sous")Signaler
une erreur
Warning: Undefined variable $cookies in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 46
Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 46
Warning: Undefined variable $validcookiesSoc in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 46
Illustration: John Milton's “Paradise Lost“ de Gustave Doré - Domaine public
+++ Livre 1
+++ Livre 2
+++ Livre 3
+++ Livre 4
Téléchargement partie par partie :
Partie: 1, 2, 3, 4, 5.
+++ Livre 1
+++ Livre 2
+++ Livre 3
+++ Livre 4
Téléchargement partie par partie :
Partie: 1, 2, 3, 4, 5.
Melmoth ou l’Homme errant
Melmoth the Wanderer
Charles Robert Maturin
Trad. : Jean Cohen - 1820
HISTOIRE DES INDIENS
XX
Dans le nord des Indes, et non loin de l’embouchure du Hoogly, est située une île qui, par sa position et par des circonstances particulières, resta longtemps inconnue aux Européens. Elle n’était même visitée par les habitants des îles voisines que dans certaines occasions extraordinaires. Elle est entourée de bas-fonds qui en rendent l’approche impraticable à tout vaisseau chargé, et les rochers qui bordent la côte font que cette approche est dangereuse, même pour les légers canots des naturels du pays ; mais ce qui la rendait autrefois plus formidable encore que tout le reste, c’étaient les horreurs dont la superstition l’avait comme investie. Il existait une tradition, d’après laquelle le premier temple de la déesse Séeva avait été construit dans cette île, où sa hideuse idole, assise sur une natte de vipères entrelacées, portant un collier de crânes humains, et des langues fourchues sortant de ses vingt bouches de serpent, avait reçu de ses adorateurs le premier hommage sanglant ; hommage qui consistait en membres mutilés et en enfants immolés.
Le temple avait été renversé et l’île à moitié dépeuplée par un tremblement de terre qui s’était fait ressentir jusque sur les côtes des Indes. Il avait cependant été rebâti par le zèle de ses adorateurs, qui recommençaient à visiter l’île, quand un ouragan, sans exemple même dans ces climats, vint désoler le lieu consacré. La pagode fut consumée par la foudre ; les habitants, leurs maisons, leurs champs cultivés furent détruits, au point qu’il ne resta pas dans toute l’île une trace d’humanité, de culture ou de vie. Les dévots consultaient leur imagination pour se rendre compte de la cause de ces calamités ; et tandis qu’assis à l’ombre de leurs cocotiers, ils défilaient leurs chapelets de couleur, ils attribuaient ces événements à la colère de la déesse Séeva, irritée de la popularité croissante du dieu Juggernaut. Ils soutenaient que l’on avait vu son image s’élevant au milieu des flammes qui avaient consumé les autels auxquels ses adorateurs s’étaient vainement attachés pour leur sûreté, et ils étaient fermement persuadés qu’elle s’était rendue dans quelque île plus heureuse, où elle espérait jouir de festins de chair et de sang, en paix et sans être molestée par l’aspect du culte d’une déité rivale. En conséquence, l’île resta pendant de longues années inculte et privée d’habitants.
Les équipages des vaisseaux européens, ajoutant foi à l’assurance des Indiens, et persuadés qu’ils n’y trouveraient ni animaux, ni végétaux, ni même de l’eau, évitaient de la visiter, et les naturels du pays, en passant devant dans leurs canots, lançaient un regard de tristesse sur son aspect désert, et jetaient quelque objet à la mer pour désarmer le courroux de Séeva.
Cette île, ainsi abandonnée à elle-même, devint d’une fertilité extraordinaire, de même que l’on voit certains enfants qui profitent mieux quand on les néglige, que quand on les entoure de tous les soins du luxe et d’une tendresse excessive. Le sol était tapissé de fleurs, les arbres couverts du feuillage le plus épais pliaient sous le poids des fruits ; mais il n’y avait pas de main pour les cueillir ni de bouche pour les savourer, quand un jour quelques pêcheurs, qu’un courant très fort avait poussés dans l’île, qu’ils avaient vainement cherché à éviter, se virent forcés d’en approcher, non sans avoir adressé à la déesse Séeva les plus ferventes prières, pour se la rendre favorable. À leur grand étonnement, ils purent s’en éloigner de nouveau sans avoir éprouvé de malencontre ; seulement ils rapportèrent à leur retour qu’ils y avaient entendu les sons les plus exquis qui jamais eussent frappé leurs oreilles, et ils jugèrent que sans doute une déesse moins cruelle que Séeva y avait fixé son séjour. Les plus jeunes d’entre les pêcheurs ajoutèrent à ce rapport qu’ils avaient entrevu la figure d’une femme, d’une beauté extraordinaire, qui avait glissé et disparu entre les arbres qui ombrageaient de toutes parts les rochers de la côte. Ils ne manquèrent pas de supposer que cette femme était une incarnation de Vishnou, sous une forme plus aimable qu’aucune de celles qu’il eût jamais prises.
Les habitants des îles voisines, non moins superstitieux que pleins d’imagination, déifièrent cette vision, chacun à sa manière. Les vieux dévots, en l’invoquant, n’abandonnaient aucune des pratiques sanglantes du culte de Séeva et de Harée ; les jeunes femmes s’approchaient, avec leurs légers canots, le plus près possible, de l’île enchantée, offrant des vœux à Camdeo (le dieu de l’amour chez les Indiens), à qui elles envoyaient de petites nacelles de papier remplies de fleurs, et avec un cierge allumé, dans l’espoir que leur divinité chérie fixerait sa résidence dans cette île. Les jeunes gens aussi, ou du moins ceux qui étaient amoureux et qui aimaient la musique, allaient sur les côtes de l’île supplier Apollon Krishnou de la sanctifier par sa présence ; ne sachant ce qu’il fallait lui offrir, debout sur la proue de leurs canots, ils chantaient des airs sauvages, et finissaient par jeter à la mer une figure de cire tenant en main une espèce de lyre.
On vit pendant longtemps ces canots voguer régulièrement toutes les nuits, et se croiser dans l’obscurité comme des météores lumineux. Tantôt une main tremblante déposait sur la grève la lanterne de papier ou la corbeille de fleurs ; tantôt une main plus hardie la suspendait en offrande aux rochers du rivage. Les simples insulaires se plaisaient dans leur humilité volontaire ; mais on remarquait qu’ils revenaient de l’île avec des idées bien douces de l’objet de leur adoration. Les femmes s’efforçaient de répéter les sons divins qui avaient frappé leurs oreilles ; les hommes rentraient chez eux, désolés de n’avoir pu entrevoir la forme céleste qui, au rapport des pêcheurs, errait dans ce lieu inhabité.
Peu à peu l’île perdit la mauvaise réputation dont elle avait joui depuis si longtemps, et une aventure arriva à la fin, qui ne laissa plus de doute sur sa sainteté et sur celle d’un seul habitant qu’elle renfermât.
Un jeune Indien avait offert, à plusieurs reprises, mais en vain, à sa bien-aimée, le bouquet mystique, dont l’arrangement des fleurs exprimait son amour. Inquiet de savoir sa destinée, il se rendit à l’île enchantée, afin de l’apprendre de la mystérieuse divinité qui y avait fixé sa demeure. Pendant qu’il dirigeait son canot vers la côte, il composa une chanson impromptu, dans laquelle il disait que sa maîtresse le repoussait comme s’il avait été un Paria, quoiqu’il l’eût aimée, fût-il même descendu de l’illustre caste des Brames. Il ajoutait que sa peau était plus brillante que le marbre poli des degrés par lesquels on descend à la fontaine d’un rajah, et ses yeux plus brillants qu’aucuns de ceux qui se soient jamais cachés derrière la purdah brodée d’une Nawaub. Elle était plus majestueuse à ses yeux que la noire pagode de Juggernaut, et plus éclatante que le trident du temple de Mahadeva, quand il est éclairé des rayons de la lune. Il n’était pas étonnant que ces deux objets trouvassent une place dans ses vers, car il les distinguait l’un et l’autre sur la côte, tandis qu’il sillonnait une mer tranquille, sous le ciel serein d’une nuit du tropique. Il termina sa chanson en promettant à sa maîtresse, si elle agréait ses soupirs, de lui construire une cabane, à quatre pieds de terre, pour la mettre à l’abri des serpents, de planter à l’entour et des palmiers et des tamarins, et de chasser pendant son sommeil les moustiques avec un éventail formé des feuilles du premier bouquet qu’elle daignerait accepter en témoignage de sa passion.
Le hasard voulut que la même nuit la jeune personne, de qui la réserve n’avait pas eu l’indifférence pour cause, se rendît aussi à cette île, dans un canot, et avec deux de ses compagnes, afin de découvrir si les vœux de son amant étaient sincères. Ils arrivèrent au même instant, et malgré l’obscurité que les premières teintes du matin n’avaient pas encore dissipée, ils prirent courage, et ils descendirent, chacun de leur côté, sur le rivage, tenant dans leurs mains des corbeilles de fleurs. Ils s’avancèrent vers la ruine de la pagode, où l’on s’imaginait que la nouvelle déesse avait fixé son séjour.
Ils eurent quelque peine à se faire jour à travers les taillis de fleurs qui couvraient spontanément la terre inculte, et non sans crainte de voir un tigre s’élancer sur eux à chaque pas. Ils se rassurèrent cependant quand ils se furent rappelés que ces animaux se cachent d’ordinaire dans les grands marais de roseaux, et n’ont pas pour retraite les lieux parfumés de fleurs. Les crocodiles n’étaient pas non plus à craindre dans les ruisseaux étroits qu’ils pouvaient traverser sans mouiller de leur eau limpide la cheville de leurs pieds. Le tamarin, le cocotier, le palmier éparpillaient leurs fleurs, exhalaient leurs parfums et balançaient leurs rameaux sur la tête de la jeune femme tremblante et pieuse, à mesure qu’elle approchait des ruines de la pagode. Ce temple avait été jadis un édifice massif et carré, construit au milieu des rochers, qui, par un caprice de la nature, assez ordinaire dans les mers des Indes, occupaient le centre de l’île, et paraissaient être le résultat d’une éruption volcanique. Le tremblement de terre, qui avait renversé le temple, avait mêlé les rochers et les ruines, de manière qu’ils ne formaient plus qu’une masse informe
qui semblait attester à la fois l’impuissance de la nature et de l’art, abattus par cette puissance qui les a créés, et qui peut les anéantir l’un et l’autre. D’un côté, l’on voyait des colonnes chargées de caractères hyéroglyphiques ;
de l’autre, des pierres qui portaient les marques d’un pouvoir irrésistible. Mortels, disait ce pouvoir, vous tracez avec le ciseau, je n’écris qu’avec le feu. Ici, les restes du monument offraient la représentation des serpents hideux sur lesquels Séeva avait été assise ; et là, la rose croissait entre les fentes des rochers, comme si la nature avait voulu envoyer la plus charmante de ses enfants pour prêcher aux humains sa douce théologie. L’idole même était tombée, et ses fragments épars jonchaient le terrain. On voyait cependant encore cette bouche horrible dans laquelle on avait autrefois jeté des cœurs palpitants, tandis qu’alors des paons superbes, étalant leur magnifique plumage, nourrissaient leurs petits au milieu des branches de tamarin qui ombrageaient ses fragments noircis.
Les jeunes Indiennes s’avançaient, et leurs craintes diminuaient. Rien en effet ne devait inspirer cette terreur religieuse qui marque l’approche d’un être spirituel. Tout autour d’eux était calme, obscur et silencieux. Près des ruines se trouvaient les restes d’une fontaine, telle que l’on en voit à côté de toutes les pagodes, et qui servent à rafraîchir et à purifier les dévots personnages qui visitent le lieu ; mais les degrés qui y conduisaient était brisés, et l’eau était stagnante. Les jeunes Indiennes en burent cependant quelques gouttes, en invoquant la déesse de l’île, après quoi elles s’approchèrent de la seule arcade qui restât entière. L’intérieur du temple avait été creusé dans le roc. On y voyait, comme dans l’île Éléphantine, des figures monstrueuses taillées en pierres, dont les unes étaient adhérentes au rocher, et les autres détachées.
Deux jeunes compagnes de l’Indienne, distinguées par leur courage, s’avancèrent en formant une espèce de danse irrégulière devant les ruines des anciens dieux, et invoquèrent la nouvelle habitante de l’île, pour qu’elle daignât être propice aux vœux de leur amie. Celle-ci s’approchait de son côté, pour suspendre sa guirlande de fleurs aux débris d’une idole à moitié cachée parmi les fragments de pierres ; et couverte de cette riche végétation qui, dans les pays de l’Orient, semble annoncer le triomphe éternel de la nature au milieu des ruines de l’art. La rose se renouvelle tous les ans ; mais des siècles ne renouvelleraient pas une pyramide.
La belle Indienne attache sa guirlande. Tout à coup une voix cachée murmure :
— Il y a ici une fleur fanée.
— Oui, oui, il y en a une, répondit la jeune fille, et cette fleur fanée est l’emblème de mon cœur. J’ai cultivé plus d’une rose, mais j’ai laissé flétrir celle qui m’était la plus chère de toutes. Veux-tu la ranimer pour moi, déesse inconnue, afin que ma guirlande ne déshonore pas tes autels ?
— Veux-tu ranimer la rose, en la réchauffant contre son sein, dit le jeune amant, en sortant de derrière les fragments de rochers et de colonnes où il s’était caché, et où il avait prononcé, sous la forme d’oracles, des réponses aux discours emblématiques, mais intelligibles de son amante, qu’il avait écoutés avec ravissement.
— Ranimeras-tu la rose, répéta-t-il en la serrant contre son cœur avec des transports d’amour et de bonheur.
La jeune Indienne, cédant à la fois au sentiment et à la superstition, se laissa aller dans ses bras, mais soudain elle s’en arracha, le repoussa de toutes ses forces et se retira tremblante d’effroi. Elle ne pouvait parler, et se bornait à montrer du doigt une figure qui venait d’apparaître au milieu de cette masse tumultueuse et indéfinie de rochers et de ruines. L’amant, sans être alarmé du cri de sa maîtresse, s’avançait pour la reprendre dans ses bras, quand son regard se fixa sur l’objet qui avait frappé le sien, et il se laissa tomber le visage contre terre, dans une adoration muette.
La figure qu’ils avaient aperçue était celle d’une femme, comme ils n’en avaient jamais vu. Sa peau était d’une blancheur éblouissante, surtout comparée à la teinte cuivrée des Indiens du Bengale. Ses vêtements n’étaient que des fleurs tressées avec des plumes de paon, et dont les riches couleurs formaient une draperie très digne en effet de couvrir une déesse insulaire. Ses longs cheveux châtains, nuance qui leur était inconnue, tombaient jusqu’à ses pieds, et se mêlaient fantastiquement aux fleurs et aux plumes qui formaient son habillement. Sur sa tête elle portait une couronne de ces coquillages brillants que l’on ne trouve que dans les mers des Indes, et dont le pourpre et le vert luttent d’éclat avec l’améthyste et l’émeraude. Sur son épaule blanche et nue était perché un loxia, et autour de son cou elle portait un collier formé des œufs de cet oiseau, si blancs et si diaphanes, que la première souveraine de l’Europe aurait échangé contre eux son plus beau rang de perles. Ses bras et ses jambes étaient tout à fait nus, et son pas avait une rapidité et une légèreté divines, qui frappèrent autant l’imagination des Indiens, que la couleur extraordinaire de sa peau et de ses cheveux.
Les jeunes amants, ainsi que nous l’avons dit, se prosternèrent respectueusement devant cette vision. Des sons délicieux frappèrent leurs oreilles. La vision leur adressait la parole, mais c’était dans une langue qui leur était inconnue ; cette circonstance les confirma dans l’idée qu’ils entendaient le langage des dieux, et ils se prosternèrent de nouveau. Dans ce moment le loxia, quittant son épaule, vint voltiger autour d’eux.
— Il va chercher des portes-lanternes pour en éclairer son nid, dirent les Indiens.
Mais l’oiseau, avec une intelligence particulière à son espèce, avait compris et adopté la prédilection de sa maîtresse, pour les fleurs fraîches dont elle formait tous les jours sa parure. Il s’élança donc sur le bouton de rose fané qui se trouvait dans le bouquet de l’amant, et l’arrachant d’entre les autres fleurs, il le déposa aux pieds de sa maîtresse. Les Indiens interprétèrent cet augure d’une manière favorable, et après s’être encore une fois prosternés contre terre, ils reprirent le chemin de l’île qu’ils habitaient. Cette fois, ils ne s’embarquèrent pas dans des canots différents ; l’amant dirigea celui de son amante qui, assise en sûreté à côté de lui, prêtait l’oreille aux hymnes que ses jeunes compagnes chantaient en l’honneur de la blanche déesse et de l’île propice aux amours, où elle avait fixé sa demeure.
La belle et unique habitante de cette île, troublée un moment à la vue de ses adorateurs, ne tarda pas à recouvrer sa tranquillité. Elle ne pouvait connaître la crainte, car rien, dans le monde qu’elle avait vu, ne lui avait encore offert l’apparence de l’inimitié. Le soleil et l’ombre, les fleurs et
les feuilles, les tamarins et les figues dont elle se nourrissait ; l’eau qu’elle buvait en admirant l’être charmant qui buvait toujours avec elle ; les paons qui étalaient leur riche et brillant plumage aussitôt qu’ils la voyaient ; enfin le loxia qui, perché sur sa main ou sur son épaule, la suivait dans ses promenades, et s’efforçait d’imiter sa voix par ses gazouillements : tous ces objets étaient ses amis, et elle ne connaissait qu’eux.
Les êtres humains qui parfois approchaient de l’île lui causaient à la vérité une légère émotion ; mais c’était plutôt de la curiosité que de la crainte. D’ailleurs leurs gestes exprimaient tous du respect, leurs offrandes de fleurs lui étaient si agréables, leurs visites se passaient dans un silence si profond, qu’elle les voyait sans aucune répugnance, et s’étonnait seulement en les voyant partir, comment ils pouvaient se soutenir en sûreté sur les eaux, et comment des créatures d’une couleur si sombre, et avec des traits si peu agréables, pouvaient croître au milieu des brillantes fleurs qu’elles lui offraient comme les produits de leurs demeures.
On pourrait penser que du moins les éléments devaient avoir inspiré à son imagination quelques idées terribles ; mais la régularité périodique de leurs phénomènes dans le climat qu’elle habitait les dépouillait de ce qu’ils avaient d’effrayant. Elle s’y était accoutumée comme à la succession du jour et de la nuit. N’ayant jamais entendu l’expression de la frayeur d’autrui, elle n’en éprouvait pas elle-même : car cette communication est dans la plupart des esprits la première cause de l’effroi. Elle n’avait jamais senti que des douleurs si légères, qu’elles n’en méritaient pas le nom ; elle n’avait aucune idée de la mort. Comment, d’après tout cela, aurait-elle connu la crainte ?
Quand par hasard l’île était visitée par un ouragan, accompagné du spectacle horrible d’une profonde obscurité au milieu du jour, de nuages noirs et suffocants, du roulement d’un tonnerre épouvantable, elle restait tranquille sous le large feuillage du bananier, ignorant son danger, et examinant avec une curiosité inexplicable les oiseaux qui penchaient la tête et les ailes, et les singes qui sautillaient de branches en branches dans leur bizarre frayeur. Si la foudre tombait sur un arbre, elle la contemplait comme un enfant regarde un feu d’artifice que l’on tire pour l’amuser. Elle pleurait cependant le lendemain, quand elle voyait que les feuilles flétries ne se ranimaient pas. Quand la pluie descendait par torrents, les ruines de la pagode lui offraient un abri, et elle écoutait avec un ravissement inexprimable le bruit des eaux qui roulaient autour d’elle. Elle vivait ainsi comme une fleur au milieu du soleil et de la tempête, plus brillante à la lumière du jour, mais pliant au vent, et tirant de l’un et de l’autre sa douce et sauvage existence. Cette existence moitié physique, moitié imaginative, mais sans passions ou intelligence, dura jusqu’à sa dix-septième année. Ce fut alors qu’une circonstance arriva qui en changea pour toujours la couleur.
Le lendemain du jour où les Indiens étaient partis, Immalie, c’était le nom que ses adorateurs lui avaient donné ; Immalie, disons-nous, se tenait, vers le soir, sur le rivage, quand elle vit s’approcher d’elle un être différent de tous ceux qu’elle avait vus jusqu’alors. La couleur de son visage et de ses mains ressemblait à la sienne, mais ses vêtements, qui étaient européens et taillés d’après la mode de l’an 1680, lui parurent si mal séants, si peu gracieux, qu’elle éprouva une sensation mêlée de
répugnance et d’étonnement, que ses beaux traits ne purent exprimer autrement que par un sourire.
L’étranger s’approcha d’elle, et elle s’avança vers lui, non point comme une femme d’Europe, avec des révérences pleines de grâce, moins encore comme une jeune fille de l’Inde, avec d’humiliantes courbettes ; mais semblable à un jeune faon : ses manières exprimaient à la fois la vie, la timidité, la confiance. Elle quitta précipitamment la grève, courut à son antre favori, et revint bientôt après, entourée de son escorte de paons, ils étalaient leurs magnifiques roues, comme si l’instinct leur avait fait connaître le danger que courait leur protectrice qui, frappant dans ses mains avec joie, paraissait, de son côté, les inviter à partager le bonheur qu’elle éprouvait en contemplant la nouvelle fleurqui avait pris naissance au milieu des sables du rivage.
L’étranger, parvenu auprès d’elle, lui adressa la parole. À son grand étonnement, Immalie reconnut le langage dont les faibles souvenirs de son enfance avaient laissé quelques traces dans sa mémoire, langage qu’elle avait vainement essayé d’apprendre à ses paons, à ses perroquets et à ses loxias. En attendant, ces sons lui étaient devenus si étrangers, qu’elle fut enchantée quand elle entendit une bouche humaine en prononcer les plus insignifiants. Quand l’étranger lui eut dit :
— Comment vous portez-vous, belle vierge ? Elle répondit :
— Dieu m’a faite, première réponse du catéchisme que sa bouche enfantine avait autrefois appris à balbutier.
— Dieu n’a jamais fait une plus belle créature, reprit l’étranger en fixant sur elle des yeux qui brûlent encore sous les paupières de ce grand trompeur.
— Oh ! qu’oui, répondit Immalie. Il a fait beaucoup de choses plus belles. La rose est plus rouge que je ne le suis, le palmier est plus grand ; mais ils changent tous, et je ne change pas. La rose se fane après quelques heures, et moi je deviens plus grande et plus forte… Mais d’où venez-vous ? Vous n’êtes pas muet comme ceux qui vivent sous la mer ; vous n’êtes pas rouge comme ceux que j’aimais, qui me ressemblaient, et qui me paraissaient venir de bien loin au-delà des eaux. D’où venez-vous ? Vous n’avez pas l’éclat des étoiles. Où croissez-vous, et comment êtes-vous venu ici ? J’ai un faible souvenir d’avoir vu un être comme vous, mais il y a si longtemps que je puis à peine me le rappeler.
— Belle créature, dit l’étranger, je viens d’un monde où il y a des milliers d’êtres comme moi.
— Des milliers ! dit Immalie ; qu’est-ce que cela veut dire ?
— Cela veut dire beaucoup.
— C’est impossible : car je suis seule ici, et tous les mondes doivent ressembler à celui-ci.
— Ce que je vous dis est cependant vrai, reprit l’étranger. Immalie s’arrêta un moment, comme si elle eût fait pour la première
fois un effort pour réfléchir. Cet effort était pénible dans un être dont l’existence n’avait été composée jusqu’alors que d’heureuses inspirations et d’un instinct irréfléchi ; puis tout à coup elle s’écria :
— Je vous entends mieux que mes oiseaux. Ce que nous faisons s’appelle, je crois, parler. Dans le pays d’où vous venez, les oiseaux et les roses parlent-ils aussi ?
Au lieu de répondre à sa question, l’étranger lui fit entendre qu’il avait faim. Immalie s’empressa de l’engager à la suivre ; elle lui servit un léger repas de figues et de tamarins, et puisa, dans une coquille de coco, de l’eau du ruisseau limpide qui coulait à l’ombre du manguier. Pendant qu’il mangeait, Immalie lui raconta tout ce qu’elle savait d’elle-même. Elle était, disait-elle, la fille d’un palmier : c’est-à-dire que sous son ombre elle avait éprouvé la première sensation de son existence. Elle était sans doute fort âgée, car elle avait vu bien des roses naître et se flétrir ; et, quoiqu’elles eussent été suivies d’autres roses, elle aimait mieux les premières, parce qu’elles étaient beaucoup plus grandes et plus brillantes ; d’ailleurs tout était devenu plus petit : car elle pouvait présentement atteindre au fruit qu’autrefois elle n’obtenait qu’après qu’il fut tombé à terre.
Ici, l’étranger l’interrompit pour lui demander comment elle avait appris à parler.
— C’est ce que je m’en vais vous dire, répondit Immalie. Je savais parler avant d’être née ; mais du reste je me rappelle que j’avais autrefois avec moi un être qui me ressemblait beaucoup, mais il était noir. Cet être était bien bon ; il prenait soin de moi ; il me caressait ; quand j’étais petite, il m’apportait à manger et à boire, et il me parlait la même langue que vous… Oh ! je me rappelle en effet à présent qu’il m’a dit une fois, tout comme vous, qu’il y avait un autre monde dans lequel il y avait beaucoup d’êtres comme moi : je l’avais tout à fait oublié… Mais pour en revenir à lui, un jour, je m’étais assise sous ce palmier que vous voyez là-bas ; je désirais un tamarin pour me rafraîchir, parce qu’il faisait très chaud. Il n’y en avait point autour de nous, et mon bon ami noir me dit qu’il m’en irait chercher un plus loin… Eh bien ! le croiriez-vous ? depuis ce temps, je ne l’ai plus revu. J’ai bien pleuré, quand j’eus attendu longtemps, longtemps sans le voir revenir. Je l’ai cherché partout, et je ne puis m’imaginer ce qu’il est devenu.
Pendant ce discours d’Immalie, l’étranger s’était appuyé contre un arbre, et la contemplait avec une expression indéfinissable. Pour la première fois de sa vie, son regard peignait une sorte de compassion. Cette sensation ne dura pas longtemps dans un cœur où elle était étrangère. Son expression se changea bientôt en un regard moitié ironique, moitié diabolique, qu’Immalie ne pouvait comprendre.
— Vous êtes donc maintenant ici toute seule ? dit-il, depuis le départ de votre compagnon, vous n’avez pas retrouvé d’autre ami ?
— Oh, oui ! j’ai un ami bien plus beau que l’autre ; mais il ne parle pas. Il demeure sous les eaux. Je l’embrasse, et il me rend mes caresses ; mais sa bouche est si froide ! Et puis quand je l’embrasse, on dirait qu’il danse, et sa beauté se brise en beaucoup, beaucoup de petits visages qui me sourient comme autant de petites étoiles.
Elle continua encore pendant quelque temps à décrire ce mystérieux ami ; et, quand elle eut fini, l’étranger lui demanda si c’était un homme ou une femme.
— Je ne sais pas ce que vous voulez dire, répondit Immalie.
— Je vous demande de quel sexe est votre ami.
Il n’obtint aucune réponse satisfaisante à cette question, et ce ne fut que le lendemain, qu’en visitant de nouveau l’île, il fut confirmé dans
le soupçon que lui avaient inspiré les discours d’Immalie. Il trouva cet être innocent et aimable penché sur un ruisseau qui réfléchissait son image à qui elle faisait mille agaceries pleines de grâces et d’une naïve tendresse. L’étranger la contempla pendant quelque temps, et des pensées, que nul homme pourrait pénétrer, jetèrent pour un moment leur expression variée sur sa physionomie d’ordinaire si calme.
La joie avec laquelle Immalie le reçut contribua aussi à ramener des sentiments humains dans un cœur auquel ils avaient été depuis longtemps étrangers. Il éprouva une sensation semblable à celle de son maître, quand il visita le paradis terrestre : c’est-à-dire de la pitié pour les fleurs qu’il était résolu de flétrir à jamais. Il la regarda, comme elle folâtrait autour de lui, les bras étendus et les yeux ivres de joie, et il soupira quand il l’entendit célébrer son arrivée avec des paroles bien dignes d’un être qui de temps immémorial n’avait entendu que le murmure des eaux et le chant des habitants des airs. Néanmoins, quelle que fût son ignorance, elle ne put s’empêcher de témoigner sa surprise de ce qu’il venait dans l’île sans aucun moyen apparent de transport. Il évita de répondre, et dit :
— Immalie, je viens d’un monde bien différent de celui que vous habitez, et où vous ne voyez que des fleurs inanimées et des oiseaux privés de raison. Je viens d’un monde où tous les habitants pensent et parlent comme moi.
Immalie garda pendant quelques instants un silence d’étonnement et de joie. À la fin, elle s’écria :
— Oh ! comme ils doivent s’aimer ! car j’aime bien mes pauvres oiseaux et mes fleurs, et mes arbres qui m’ombragent, et mes ruisseaux qui chantent pour moi.
L’étranger sourit.
— Dans tout ce monde, il n’y a peut-être pas une créature aussi belle et aussi innocente que vous. C’est un monde de souffrances, de crimes et de soucis.
À ces mots, Immalie regarda fixement l’étranger. Elle ne comprenait rien à ce qu’il lui disait, et ce ne fut pas sans peine qu’il parvint à lui donner une bien faible idée de ce qu’il entendait par ces mots épouvantables.
— Oh ! s’écria-t-elle à la fin, si je vivais dans ce monde, j’y voudrais rendre chacun heureux.
— Mais vous ne le pourriez pas, Immalie. Ce monde est si grand que, dans tout le cours de votre vie, vous pourriez à peine le traverser, et, dans vos courses, vous ne verriez qu’un petit nombre de malheureux à la fois, et souvent leurs malheurs seraient tels, qu’aucun pouvoir humain ne pourrait les soulager.
À ces mots, Immalie fondit en larmes.
— Faible, mais aimable créature, dit l’étranger, pensez-vous que vos larmes puissent guérir les souffrances de la maladie, rafraîchir les feux qui brûlent dans un cœur ulcéré, ranimer le corps exténué par la faim, mais surtout, surtout, éteindre les flammes des passions illicites ?
Immalie pâlit à cette énumération de maux dont elle n’avait aucune idée. À la fin, elle dit que partout où elle irait, elle apporterait des fleurs, et qu’elle ferait asseoir les malheureux sous l’ombre du tamarin. Quant à la maladie et à la mort, elle ne savait pas ce que cela voulait dire.
— C’est peut-être comme les fleurs que je vois souvent languir, et d’autrefois se faner pour ne plus revenir. Mais, ajouta-t-elle après avoir réfléchi un moment, j’ai aussi remarqué que ces fleurs gardent leurs délicieux parfums, même après qu’elles se sont flétries pour toujours. Ne serait-il pas possible aussi que ce qui pense vive après que notre corps s’est flétri ? Cette pensée est bien douce !
Pour la passion, elle n’en avait aucune idée, et ne pouvait proposer de remède à un mal qui lui était si complètement étranger. Elle avait vu des fleurs se faner quand leur saison était passée, mais elle ne pouvait concevoir pourquoi une fleur se détruirait elle-même.
— Mais n’avez-vous jamais remarqué un ver dans une fleur ? dit l’étranger avec tout l’artifice de la séduction.
— Oui, répondit Immalie ; mais le ver ne faisait point partie de la fleur. Ses propres feuilles n’auraient pu lui faire de mal.
Ceci amena une discussion à laquelle l’innocence parfaite d’Immalie ôta tous ses dangers. Nonobstant sa vive curiosité, et la promptitude de son entendement, ses réponses enjouées, mais vagues, son imagination inquiète et bizarre, ses armes intellectuelles acérées, mais qu’elle ne savait pas manier ; enfin, et par-dessus tout, son instinct et son tact infaillibles pour ce qui était juste ou injuste, tout cela fit échouer plus sûrement les discours du tentateur que s’il avait argumenté contre tous les logiciens réunis des académies européennes. Versé dans tous les sophismes des écoles, il était plus qu’ignorant dans cette rhétorique du cœur et de la nature. Tel on dit que le lion s’humilie devant une vierge dans sa pureté native, le tentateur se retirait mécontent, quand il vit des larmes mouiller les yeux d’Immalie : cette innocente douleur lui offrit un présage triste et favorable.
— Vous pleurez, Immalie ?
— Oui, je pleure toujours quand je vois le soleil disparaître le soir derrière les nuages ; et vous, soleil de mon cœur, disparaîtrez-vous aussi dans l’ombre ? ne renaîtrez-vous pas ? dites-moi, ne vous reverrai-je plus ?
En prononçant ces mots, elle pressa la main de l’étranger contre sa bouche de corail.
— Je n’aimerai plus ni mes roses, ni mes paons, si vous ne revenez pas : car ils ne peuvent pas me parler comme vous faites, et je ne puis leur demander des pensées, tandis que vous m’en donnez beaucoup. Oh ! je voudrais avoir beaucoup de pensées au sujet de ce monde qui souffre, et d’où vous venez. En effet, je dois croire que vous en êtes venu, car jusqu’au moment où je vous ai vu, je n’avais jamais senti une douleur qui ne fût un plaisir. Maintenant tout est douleur, surtout quand je songe que vous ne reviendrez pas.
— Je reviendrai, belle Immalie, et je vous montrerai, à mon retour, un aperçu de ce monde d’où je viens, et que vous habiterez bientôt vous-même.
— Je vous y verrai donc, dit Immalie ; sans cela, comment pourrais-je parler des pensées ?
— Oh, oui ! oh, certainement !
— Mais pourquoi répétez-vous deux fois la même chose? Un mot de votre bouche aurait suffi.
— Eh bien ! donc, oui !
— Prenez cette rose, et respirons-en le parfum ensemble. C’est ce que je dis à mon ami du ruisseau, quand je me baisse pour l’embrasser ; mais il retire sa rose avant que je l’aie sentie, et je laisse la mienne sur l’eau. Eh bien ! ne voulez-vous pas la prendre ?
— Oui, sans doute, dit l’étranger en prenant une fleur dans le bouquet qu’Immalie lui présentait. Elle était fanée. Il s’en saisit, et la cacha dans son sein.
— Allez-vous donc traverser cette mer obscure, dit Immalie, sans vous mettre dans une de ces grandes coquilles dans lesquelles j’ai vu venir ces êtres rouges dont je vous ai parlé ?
— Nous nous reverrons, dit l’étranger, et ce sera dans le monde des souffrances.
— Je vous remercie, je vous remercie, répondit Immalie en le voyant se plonger dans les flots.
L’étranger se contenta de répondre :
— Nous nous reverrons.
Deux fois avant de partir, il jette un regard sur cette créature si belle et si innocente. Un sentiment d’humanité fait tressaillir son cœur. Mais tout à coup il arrache de son sein la rose fanée, et répond au sourire enchanteur d’Immalie :
— Nous nous reverrons.
XXI
Durant sept matinées consécutives et durant autant de soirées, Immalie parcourut le rivage de son île solitaire sans revoir l’étranger. Elle se rappelait toujours, pour se consoler, l’assurance qu’il lui avait donnée qu’elle le reverrait dans le monde des souffrances, et elle ne cessait de répéter en elle-même ses dernières paroles. Dans l’intervalle, elle s’efforça de former son éducation pour ce monde où elle allait entrer, et rien ne pouvait être plus admirable et plus intéressant que de voir les tentatives qu’elle faisait pour tirer du règne végétal ou animal quelque analogie qui pût lui donner une idée de l’incompréhensible destinée des hommes. Tantôt, elle regardait la fleur, et se disait : « Cette fleur, si brillante aujourd’hui, sera fanée demain ; mais elle ne ressent point de douleur ; elle meurt patiemment, et celles qui l’avoisinent n’éprouvent point de chagrin en perdant leur compagne : sans cela leurs couleurs ne seraient pas si resplendissantes. Mais peut-il en être ainsi dans le monde qui pense ? Pourrais-je le voir se faner et mourir, sans me faner et mourir avec lui ? Oh, non ! Quand cette fleur se fanera, je chercherai, comme la rosée, à la ranimer par mes pleurs. »
Elle essaya ensuite d’agrandir la sphère de ses idées, en observant le règne animal. Un jeune loxia était tombé mort de son nid suspendu. Immalie, regardant par l’ouverture que ces oiseaux intelligents font à l’extrémité inférieure de leur nid, pour le mettre à l’abri des oiseaux de proie, aperçut les vieux loxia avec des porte-lanternes dans leurs becs, tandis que le jeune gisait mort devant eux. À cette vue, Immalie fondit en larmes.
— Ah ! vous ne pouvez pleurer ! s’écria-t-elle, quel avantage j’ai sur vous ! Vous mangez, quoique votre petit, votre enfant soit mort ! (Nous n’avons pas besoin d’observer que, dans sa conversation avec Immalie, l’étranger lui avait donné quelque idée des liens de la parenté.) Pourrais-je boire encore le lait de la noix de coco, si lui n’était plus en état d’en goûter ? Je commence maintenant à comprendre ce qu’il m’a dit… Penser est donc souffrir !… Et le monde des pensées doit être aussi le monde des souffrances ! mais que ces larmes sont délicieuses ! autrefois je pleurais de plaisir ; ah ! je vois maintenant qu’il y a une peine plus agréable encore que le plaisir, et cette peine, je ne l’avais jamais éprouvée avant de l’avoir vu. Oh ! qui pourrait, en renonçant à la pensée, renoncer au plaisir de pleurer ?
Cependant Immalie ne passa pas uniquement dans les réflexions l’intervalle que l’étranger mit entre ses visites. Une nouvelle inquiétude commença à l’agiter ; et, dans les moments que lui laissaient ses méditations et ses larmes, elle recherchait avec avidité les plus brillants coquillages pour en orner ses bras et ses cheveux. Elle changea tous les jours sa robe de fleurs, et au bout d’une heure elles ne semblaient déjà plus assez fraîches. Puis elle remplissait une large coquille de l’eau la plus limpide, et posait les fruits les plus délicieux, qu’elle entremêlait de roses, sur le banc de pierre de la pagode ruinée. Mais le temps se passait sans que l’étranger vînt la voir. Le lendemain, en revoyant le banquet qu’elle avait préparé la veille, elle pleurait sur les fruits qui n’avaient plus de fraîcheur ; puis elle s’empressait d’essuyer ses yeux et d’en arranger un nouveau.
Telle était son occupation durant la huitième matinée, quand elle vit tout à coup l’étranger devant elle. La joie naïve et innocente avec laquelle elle courut à sa rencontre excita pour un moment dans son cœur un sentiment de remords dont Immalie s’aperçut au ralentissement de ses pas et à ses yeux détournés. Elle s’arrêta, pleine d’une aimable timidité, comme paraissant lui demander pardon d’une offense involontaire, et sollicitant la permission d’approcher, par l’attitude même qu’elle avait prise pour s’en abstenir. Dans ses yeux brillaient des larmes prêtes à s’échapper s’il avait fait encore un seul mouvement pour la repousser. Cet aspect rendit à l’étranger son courage, et il pensa en lui-même : Il faut qu’elle apprenne à souffrir pour se rendre digne d’être mon élève.
— Vous pleurez, Immalie ! ajouta-t-il en s’approchant d’elle.
— Oh, oui ! répondit-elle en souriant à travers ses larmes, comme une matinée de printemps. Vous devez m’apprendre à souffrir, et je serai bientôt préparée à entrer dans votre monde ; mais j’aime mieux pleurer pour vous, que sourire sur des roses.
— Immalie, reprit l’étranger, repoussant les sentiments de tendresse qui l’amollissaient malgré lui, Immalie, je viens vous montrer quelque chose de ce monde des pensées que vous désirez tant d’habiter, et où vous ne tarderez pas en effet à fixer votre demeure. Montez sur cette colline où vous voyez un bosquet de palmiers.
— Mais je voudrais le voir tout entier à la fois, dit Immalie avec l’avidité naturelle d’une intelligence ardente qui croit pouvoir tout embrasser.
— Tout entier à la fois ! répéta l’étranger en souriant. J’ai quelque idée que la portion que vous en verrez aujourd’hui sera plus que suffisante pour satisfaire votre curiosité, quelle qu’elle soit.
En disant ces mots, il tira de dessous son justaucorps un tube, et lui dit d’y appliquer son œil. La jeune Indienne obéit ; mais au bout d’un instant elle s’écria vivement :
— Suis-je là, où sont-ils ici ? et elle se laissa aller à terre dans une extase inexprimable.
Elle se releva au bout d’un moment, et, saisissant le télescope, elle voulut s’en servir seule ; mais elle porta le grand verre à son œil. N’apercevant plus rien, elle dit avec tristesse :
— Tout est parti ! Ce monde si beau n’a vécu qu’un instant ! Tout ce que j’aime meurt ainsi. Mes roses les plus chéries ne vivent pas aussi longtemps que celles que je néglige. Vous êtes resté absent pendant sept jours, et ce monde superbe n’a vécu qu’un moment !
L’étranger dirigea encore le télescope vers le rivage de l’Inde, dont ils n’étaient pas très éloignés, et Immalie, enchantée, s’écria de nouveau :
— Ah ! tout revit, et plus beau que jamais ! Je vois partout des êtres vivants et pensants. Mais que sont donc ces superbes rochers que j’aperçois, et qui ne ressemblent pas aux rochers de mon île ? Leurs côtés sont polis ; leurs sommets sont découpés comme des fleurs. Oh ! que ce monde doit être beau ! Est-ce la pensée qui a fait tout cela ?
— Attendez, Immalie, dit l’étranger en lui ôtant le télescope des mains ; pour jouir de ce spectacle, il faut que vous le compreniez.
— Sans doute, répondit Immalie, chez qui le monde sensible perdait peu à peu ses attraits en comparaison du monde spirituel nouvellement découvert pour elle. Oh ! oui… laissez-moi penser !
— Immalie, avez-vous de la religion ? dit pour lors l’inconnu, tandis qu’une sensation de douleur inexprimable ajoutait à la pâleur de son front.
Immalie, dont l’intelligence était prompte, et qui sympathisait avec toutes les sensations qu’elle voyait, le quitta avec vivacité, et revint un instant après tenant en main une feuille de bananier, avec laquelle elle essuya les gouttes de sueur qui découlaient de son front décoloré ; puis s’étant assise à ses pieds, dans l’attitude d’une attention avide et profonde, elle répéta :
— De la religion ! qu’est-ce que c’est ? Est-ce une nouvelle pensée ?
— C’est la connaissance d’un Être supérieur à tous les mondes et à leurs habitants, puisque c’est lui qui les a faits tous, et qui sera leur juge ; d’un être que nous ne pouvons voir ; mais dans le pouvoir et la puissance duquel nous devons croire, quoique invisible ; d’un Être qui est partout, sans qu’on le voie nulle part ; qui agit toujours, quoiqu’il ne soit jamais en mouvement ; qui entend tout, et ne se fait jamais entendre.
Immalie l’interrompit avec une espèce d’égarement :
— Arrêtez ! trop de pensées me tueront ; laissez-moi reposer un moment. J’ai vu la pluie qui tombait pour rafraîchir le rosier, et qui le couchait par terre.
Après un effort pénible, comme pour rappeler un souvenir éloigné, elle ajouta :
— La voix des songes m’a dit quelque chose de ce genre avant que je fusse née; mais il y a longtemps !… Quelquefois j’ai eu en moi des pensées qui ressemblaient à cette voix. Il me semblait que j’aimais trop les choses qui m’entouraient, et que j’aurais dû aimer des choses bien loin de moi : des fleurs qui ne se flétriraient point, et un soleil qui ne se coucherait jamais. Après de telles pensées, j’aurais voulu m’enlever comme un oiseau dans l’air ; mais il n’y avait personne pour me montrer le chemin.
— Il est juste, reprit l’étranger, non seulement d’avoir des pensées sur cet Être, mais encore de les exprimer par des actes extérieurs. Les habitants de ce monde que vous allez voir appellent cela adorer, et ils ont adopté divers modes d’adoration. (En disant ces derniers mots, un sourire satanique parut sur ses lèvres.) Ces modes sont si différents, qu’ils ne s’accordent que sur un seul point, celui de faire de la religion un tourment.
— Cela n’est pas possible, s’écria Immalie ; ils doivent sentir que celui qui est toujours le même ne peut agréer des différences dans la manière de l’adorer.
— C’est aussi en cela que consistent leurs erreurs. Pendant qu’il parlait, Immalie avait repris le télescope.
— Eh bien ! que voyez-vous ? dit l’étranger.
Immalie décrivait ce qu’elle voyait d’une manière très imparfaite, mais qui deviendra plus intelligible pour le lecteur, par les paroles explicatives de l’étranger.
— Vous voyez, dit-il, les côtes des Indes, les rivages du monde qui est près de vous. Cet édifice énorme sur lequel votre œil se fixe le premier, est la noire pagode de Juggernaut. À côté de cette pagode, vous voyez une mosquée turque ; elle se distingue par l’emblème d’un croissant qui surmonte le toit. Non loin de là est un bâtiment peu élevé, couronné d’un trident : c’est le temple de Mahadeva, une des anciennes déesses du pays.
— Mais, que m’importent les maisons ! dit Immalie ; montrez-moi les êtres vivants qui s’y rendent.
— C’est juste, reprit le tentateur ; mais ces maisons indiquent les différentes façons de penser de ceux qui les fréquentent. Si vous désirez examiner leurs pensées, il faut voir comment il les expriment par leurs actions. Dans le commerce qu’ils ont les uns avec les autres, les hommes sont souvent de mauvaise foi ; mais ils sont assez sincères dans leurs adorations, conformément au caractère qu’ils prêtent à leurs dieux : si ce caractère est formidable, ils expriment la crainte ; s’il est cruel, ils s’infligent des souffrances ; s’il est triste, l’image du dieu se réfléchit fidèlement sur le visage de ses adorateurs. Voyez du reste et jugez.
Immalie regarda, et vit une vaste plaine sablonneuse, à l’extrémité de laquelle se dessinait l’obscure pagode de Juggernaut. Cette plaine était jonchée de squelettes, tandis que des milliers d’êtres à peine vivants traînaient leurs corps à demi brûlés sur les sables, afin de périr à l’ombre du temple dont ils n’osaient espérer d’atteindre les murs. Une foule mouraient en chemin ; d’autres secouaient faiblement la main, pour éloigner les vautours, qui déjà s’apprêtaient à les dévorer.
À côté de cette scène effroyable, se présentait un spectacle magnifique. La statue de Juggernaut s’avançait sur un énorme char de triomphe, que traînaient une foule innombrable de prêtres, de victimes, de bramines et de faquirs. À mesure que la procession marchait, des malheureux se jetaient devant les roues du char, qui les écrasait en passant. D’autres, qui ne se croyaient pas dignes de périr d’une mort aussi illustre, se faisaient de larges blessures, et se contentaient de laisser couler leur sang sur la route du Dieu. Tel est le mélange de rites qui caractérise partout le paganisme. Moitié brillant, moitié horrible ; invoquant la nature en même temps qu’il l’outrage ; mêlant les fleurs avec le sang, et jetant devant le char de l’idole, tantôt un enfant en pleurs, et tantôt une guirlande. Le temple de Mahadeva ne lui offrit pas un spectacle moins horrible ; nous épargnons au lecteur la description des mères sacrifiant leurs enfants, et des enfants exposant leurs parents décrépits aux tigres et aux crocodiles. Il suffira de dire, qu’après l’avoir contemplé pendant quelque temps, Immalie, couvrant ses yeux de ses deux mains, resta muette de douleur et d’horreur.
— Tournez-vous par ici, dit l’étranger ; les cérémonies de toutes les religions ne sont pas également sanglantes.
Immalie leva les yeux, et elle vit une mosquée turque, dans toute la splendeur qui accompagna la première introduction de la religion mahométane parmi les Hindous. Elle élevait ses dômes recouverts d’or, ses minarets artistement sculptés, et ses flèches couronnées de croissants ; elle était enrichie de tous les ornements que l’imagination orientale prodigue à son architecture, à la fois légère et brillante, pompeuse et aérienne.
Un groupe de Turcs s’avançait gravement vers la mosquée. Leurs traits nobles et expressifs, leurs costumes majestueux et leurs tailles élevées formaient un contraste remarquable avec les pauvres Hindous, à moitié nus, qui, assis par terre, achevaient un léger repas de riz cuit à l’eau. Immalie regardait les Turcs avec respect et plaisir, et commençait à penser qu’il pouvait y avoir quelque chose de bon dans la religion professée par des êtres d’un aspect aussi noble. Tout à coup elle les vit, avant d’entrer dans la mosquée, repousser avec mépris les Indiens, tranquilles et effrayés, et leur cracher à la figure. Ils les frappaient du plat de leurs sabres, et les traitaient de chiens d’idolâtres ; ils les maudissaient au nom de Dieu et du prophète.
Quoique Immalie ne pût pas entendre les mots qui accompagnaient cette action, elle n’en fut pas moins révoltée, et elle en demanda le motif.
— Leur religion, dit l’étranger, leur ordonne de haïr tous ceux qui n’adorent pas Dieu comme eux.
— Hélas ! observa Immalie, cette haine que leur religion enseigne n’est-elle pas la preuve que cette religion n’est pas la véritable ? Mais pourquoi, ajouta-t-elle avec étonnement, ne vois-je pas parmi eux quelques-unes de ces créatures plus aimables, dont les habits diffèrent des leurs, et que vous appelez des femmes ? N’adorent-elles pas aussi Dieu, ou bien ont-elles une religion plus douce qui leur est propre ?
— Cette religion, répondit l’étranger, n’est pas favorable à ces créatures, dont vous êtes, sans contredit, la plus aimable. Elle enseigne que l’homme aura d’autres compagnes dans le monde des âmes, et elle ne dit pas bien clairement si jamais les femmes y arriveront. Aussi vous devez voir quelques-unes de ces créatures délaissées, errantes parmi les pierres qui marquent le lieu où reposent les morts ; elles répètent des prières pour les âmes qu’elles n’osent espérer de revoir. D’autres, âgées et dans l’indigence, assises aux portes de la mosquée, lisent à haute voix des passages d’un livre qu’ils appellent le Koran, non dans la vue d’exciter la dévotion, mais dans l’espoir d’obtenir une faible charité.
À ces mots désolants, Immalie qui avait en vain cherché dans ces divers systèmes cette espérance et ces consolations, dont son esprit si pur et son imagination si vive lui démontraient également la nécessité, éprouva une invincible répugnance pour toute religion ; car on les lui peignait sous des couleurs qui ne lui offraient qu’un hideux tableau de sang et de cruauté, renversant tous les principes de la nature, et rompant tous les liens du cœur.
Elle se jeta par terre, et s’écria :
— Il n’y a point de Dieu, s’il n’y en a point d’autre que le leur. Puis s’étant levée pour jeter un dernier regard sur ce qu’elle venait de voir, dans l’espoir que ce ne serait qu’une illusion, elle découvrit un petit édifice obscur, ombragé de palmiers et surmonté d’une croix. Frappée de la simplicité de son apparence, ainsi que du petit nombre et de la conduite paisible de ceux qui s’en approchaient, elle s’écria que c’était sans doute là une nouvelle religion ; et elle en demanda le nom et les rites. L’étranger qui avait fait ce qu’il avait pu pour empêcher qu’elle n’aperçût ce temple modeste montra beaucoup d’inquiétude à la découverte qu’elle venait de faire, et plus encore de répugnance à répondre aux questions que cette découverte lui suggérait ; mais elle insista si vivement, et mit une si aimable importunité à les réitérer ; elle passa si naïvement d’une douleur profonde et grave à une curiosité à la fois enfantine et intelligente, qu’il était impossible de lui résister.
Il se peut faire encore qu’une autre cause ait agi sur ce prophète de malheur, et l’ait forcé de prononcer une bénédiction, quand il aurait voulu maudire ; mais c’est un mystère qu’il ne nous est pas permis d’approfondir, et qui ne sera bien connu qu’au grand jour où tous les secrets seront dévoilés. Quoi qu’il en soit, il se sentit forcé de lui dire que cette religion dont elle voyait les rites et les serviteurs était celle du Christ.
— Mais quels sont ces rites ? demanda Immalie. Font-ils aussi mourir leurs enfants ou leurs parents pour prouver qu’ils aiment leur Dieu ? Les suspendent-ils dans des corbeilles pour périr, ou les exposent-ils sur les bords des rivières pour être dévorés par des animaux féroces et hideux ?
— La religion qu’ils professent leur défend cela, dit l’étranger, en prononçant à regret des paroles de vérité. Elle leur ordonne, au contraire, d’honorer leurs parents, de soigner leur progéniture.
— Et pourquoi ne repoussent-ils pas de devant leur temple ceux qui ne pensent pas comme eux ?
— Parce que leur religion leur dit d’être charitables, bienveillants et tolérants. Ils doivent chercher à instruire ceux qui n’ont point encore atteint la pureté de sa lumière ; mais ils ne doivent ni les rejeter, ni les dédaigner.
— Ils n’immolent donc pas à leur Dieu des victimes humaines ?
— Non : car ils savent que Dieu ne peut être bien servi que par des cœurs purs, et des mains exemptes de crimes. Ils savent que la dévotion seule est préférable aux cérémonies les plus imposantes et les plus terribles, et que les temples les plus orgueilleux, élevés en l’honneur de sa divinité, seront réduits en poussière, tandis qu’un cœur simple et humilié brûlera éternellement sur son autel ; holocauste agréable, et dont les feux ne s’éteindront jamais.
Pendant qu’il parlait, contraint peut-être par un pouvoir supérieur, Immalie inclinait, en rougissant, son visage contre terre, et puis le relevant avec le regard d’un ange nouveau-né, elle s’écria :
— Le Christ sera mon Dieu ! Je veux être chrétienne !
Elle s’inclina de nouveau avec cette profonde humilité qui indique à la fois la soumission du corps et de l’âme, et elle resta assez longtemps dans cette position. Quand elle se releva, elle chercha l’étranger… Il n’y était plus.
XXII
L’étranger interrompit pendant quelque temps ses visites ; et quand il revint, elles semblaient n’avoir plus le même but. Il n’essayait plus de corrompre les principes d’Immalie, de fausser son jugement, ou de l’induire en erreur au sujet de la religion. Il gardait même un profond silence sur ce dernier sujet, et paraissait regretter de l’avoir jamais touché. Toute l’avidité qu’elle témoignait pour s’instruire, toute la confiante importunité de ses manières ne purent obtenir de lui un mot de plus sur ce sujet. Il l’en dédommagea néanmoins amplement, en déployant devant elle l’instruction riche et variée d’un esprit qui paraissait avoir recueilli plus de connaissances, que l’expérience humaine n’aurait pu en réunir dans le cours d’une longue vie. Cette circonstance n’étonna pourtant pas Immalie ; elle ne faisait aucune attention au temps, et l’anecdote d’hier ou les annales des siècles passés étaient contemporaines pour son esprit auquel les faits, les dates, les coutumes diverses et la suite des événements étaient également étrangers.
Ils s’asseyaient souvent le soir sur le rivage, où Immalie avait soin de préparer un siège de mousse pour son ami, et ils contemplaient ensemble en silence la vaste étendue des mers : car l’intelligence d’Immalie nouvellement réveillée sentait ce besoin d’expressions qu’un sentiment profond imprime à l’esprit le plus cultivé, et qui dans elle était augmenté à la fois par sa pureté et par son ignorance. Quant à l’étranger, il avait peut-être des raisons plus fortes encore pour garder le silence. Ce silence était cependant souvent interrompu ; pas un vaisseau ne se montrait dans l’éloignement qui ne devînt l’occasion d’une question dans la bouche d’Immalie et d’une réponse courte et évasive de la part de l’étranger. Ses connaissances étaient cependant immenses, et depuis le simple canot indien, jusqu’aux vaisseaux énormes et mal dirigés des Rajahs, ou bien aux rapides navires des Européens, qui venaient, comme les dieux de l’Océan, apporter la fertilité, la science, les découvertes des arts et les bienfaits de la civilisation, partout où ils jetaient l’ancre, il aurait pu tout lui décrire ; il aurait pu lui indiquer la destination de chacun de ces vaisseaux ; les sentiments, les mœurs et les usages nationaux de leurs divers équipages ; enfin lui donner une instruction que des livres ne lui auraient jamais procurée : car la conversation est, sans contredit, le moyen le plus sûr de bien enseigner.
Il est possible que cet être extraordinaire, à l’égard duquel les lois de la mortalité et les sentiments de la nature étaient également suspendus, éprouvât dans la société d’Immalie une espèce de repos triste et vague, qui lui faisait oublier la destinée qui le poursuivait d’une manière inévitable. Nous ne savons et nous ne saurons jamais quels furent les sentiments que lui inspira sa bonté innocente et sans soutien ; mais il est du moins certain qu’il cessa de la regarder comme sa victime, et que, pendant les moments qu’il passait auprès d’elle, écoutant ses questions et y faisant des réponses, il semblait jouir des seuls intervalles de bonheur qui furent accordés à son existence sombre et douloureuse. En s’éloignant d’elle, il rentrait dans le monde pour tenter les malheureux.
Loin d’elle, son but était tel qu’on l’a décrit, mais en sa présence, ce but paraissait suspendu. Il la regardait souvent avec des yeux dont l’éclat sauvage et féroce se noyait dans des larmes qu’il s’empressait d’essuyer pour la regarder de nouveau. Tandis qu’il reposait à côté d’elle sur les fleurs qu’elle avait cueillies pour lui, tandis qu’il contemplait ses lèvres de roses qui n’attendaient qu’un signal de lui pour parler, comme des boutons qui n’osent s’ouvrir avant que le soleil brille sur eux, tandis qu’il écoutait des accents impossibles à définir, il penchait la tête, essuyait de son front quelques gouttes d’une sueur glacée, et oubliait pour un moment la marque ineffaçable que, nouveau Caïn, il portait partout avec lui. Mais bientôt la tristesse profonde et habituelle de son âme s’emparait encore de lui. Il sentait la dent du reptile qui ne cessait de le ronger, et la chaleur de cette flamme qui ne s’éteignait jamais. Il tournait l’éclat fatal de ses grands yeux gris, sur le seul être que leur expression n’eût jamais fait frémir, parce que son innocence la rendait inaccessible à la crainte. Il la regardait attentivement pendant que la rage, le désespoir et la pitié déchiraient tour à tour son cœur. Une larme d’humanité mouillait son œil ; mais soudain il détournait ses regards et les portait sur le vaste Océan, comme s’il avait voulu embrasser le monde entier et trouver dans l’aspect de la vie humaine un aliment au feu qui consumait ses entrailles. Cet Océan si pur et si calme qui s’étendait devant eux, n’avait jamais réfléchi deux physionomies plus différentes, ou inspiré à deux cœurs des sentiments plus opposés. Immalie y puisait cette douce et délicieuse rêverie que la nature inspire à des cœurs innocents. Eux seuls peuvent jouir véritablement de la terre, de l’Océan et du ciel.
À l’étranger cette vue causait des idées bien différentes. Il la contemplait comme un tigre regarde une forêt remplie d’une proie abondante. Son imagination lui offrait à la fois des naufrages sans nombre, et le vaisseau, qui, poursuivant sa route par le vent le plus favorable et le ciel le plus pur, touchait soudain un rocher à fleur d’eau, et sombrait dans une mer calme, contraste délicieux pour son âme féroce. Parfois il se contentait de regarder les navires à mesure qu’ils passaient devant ses yeux, et de se dire que chacun d’eux renfermait une ample cargaison de malheurs et de crimes. Il réfléchissait surtout aux vaisseaux européens qui s’approchaient, tout remplis des passions et des vices d’un autre monde, pour trafiquer d’or, d’argent et des âmes des hommes, pour arracher à ces climats tous leurs riches produits, en refusant aux habitants le riz dont ils ont besoin pour soutenir leur chétive existence ; enfin, pour rapporter avec eux, en Europe, des constitutions minées, des passions enflammées, des cœurs ulcérés et des consciences qui ne peuvent plus dormir dans l’obscurité.
Tels étaient les objets qu’il cherchait à distinguer ou à deviner ; et un soir, après qu’Immalie lui eut fait des questions réitérées sur les vaisseaux qu’elle apercevait au loin sur les eaux, il lui fit la description du monde à sa manière, c’est-à-dire dans un esprit de sarcasme, de malignité et d’impatience que lui inspirait la vue de son innocente curiosité. Dans l’ébauche qu’il lui fit de la société, il y avait un mélange d’atroce amertume, d’ironie et d’affreuse vérité, tel qu’Immalie l’interrompit souvent par des cris d’étonnement, de douleur et d’effroi.
Quand il eut cessé de parler, Immalie garda pendant quelque temps le silence, méditant, avec tristesse et mélancolie, sur ce qu’elle venait d’entendre. L’amère ironie de son langage n’avait fait aucune impression sur elle, car elle n’en avait pu saisir le sens détourné ; elle avait seulement compris qu’il avait été beaucoup question de malheurs et de souffrances, mots inconnus pour elle avant qu’elle l’eût vu, et, par un regard, elle parut à la fois lui rendre grâce et lui faire des reproches de l’avoir initiée aux pénibles mystères d’une nouvelle existence. Elle venait de goûter de l’arbre de science, ses yeux étaient ouverts ; mais elle en avait trouvé le fruit amer, et ses regards témoignaient une douce et triste reconnaissance, bien faite pour déchirer le cœur qui venait de donner la première leçon de douleur à celui d’un être si beau, si doux, si plein d’innocence. L’étranger remarqua cette expression, et jouit de son triomphe.
En lui faisant ainsi un tableau exagéré des vices de la société, peut-être avait-il voulu la détourner du désir de la contempler de plus près ; peut-être entretenait-il une espérance vague de la garder dans cette solitude, où il pourrait parfois la voir, et respirer, dans l’atmosphère de pureté qui régnait autour d’elle, le seul zéphyr qui rafraîchit le désert brûlant au sein duquel s’écoulait son existence. Cette espérance acquit un nouveau degré de force, quand il vit l’impression que son discours avait faite sur elle. L’ardente intelligence, l’avide curiosité, la vive reconnaissance qui s’y peignaient, en avaient toutes disparu, pour ne plus offrir qu’un regard baissé et des yeux pensifs et pleins de larmes.
— Ma conversation vous a-t-elle ennuyée, Immalie ? demanda-t-il.
— Elle m’a affligée, répondit l’Indienne, et cependant je voudrais vous écouter encore. J’aime à entendre le murmure du ruisseau, quoique je sache que le crocodile se cache souvent sous ses eaux.
— Vous désireriez peut-être de rencontrer des habitants de ce monde si plein de crimes et de malheurs ?
— Je le désire en effet, car c’est de ce monde que vous êtes venu, et quand vous y retournerez, chacun sera heureux, excepté moi.
— Est-il donc en mon pouvoir de contribuer au bonheur des hommes ? Est-ce pour cela que j’erre au milieu d’eux ?
Une expression horrible et indéfinissable de dérision, de malveillance et de désespoir se peignit sur ses traits quand il ajouta :
— Vous me faites trop d’honneur en m’attribuant une occupation si agréable et surtout si conforme à mes goûts.
Immalie, qui avait détourné les yeux, ne remarqua pas cette expression, et elle répondit :
— Je ne sais comment il se fait ; mais vous m’avez appris à tirer de la joie du sein même de la douleur. Avant de vous avoir vu, je ne faisais que sourire ; maintenant je pleure, et ces larmes sont délicieuses. Oh ! elles sont bien différentes de celles que je versais pour le soleil couchant ou pour la rose qui se fanait ; et cependant, je ne sais…
Ici la pauvre Indienne, oppressée par des émotions qu’elle ne pouvait ni comprendre ni expliquer, posa ses deux mains jointes sur sa poitrine comme pour cacher le secret de ses nouvelles palpitations, et avec un instinct de pureté dont elle ne se rendait pas compte, elle s’éloigna de quelques pas, et baissa vers la terre des yeux dont des larmes s’échappaient malgré elle. L’étranger parut troublé, une émotion, à laquelle il n’était pas accoutumé, l’agita pour un moment ; puis il sourit dédaigneusement, comme s’il s’était reproché de s’être livré même pour un moment à un sentiment humain. Un instant d’après, sa physionomie s’adoucit de nouveau en contemplant les regards baissés et détournés d’Immalie. Il paraissait capable de sentir la douleur, et cependant toujours prêt à se faire un jeu de celle des autres. Ce contraste du désespoir qui se cache sous le masque de la frivolité se rencontre assez souvent. Le sourire est l’enfant du bonheur, mais une gaîté factice règne souvent sur le front de l’être profondément malheureux. Telle fut l’expression de l’étranger quand se tournant vers Immalie, il lui dit :
— Mais que signifie ce discours ?
Une longue pause suivit cette question : enfin l’Indienne répondit :
— Je ne sais, avec cet art délicieux de la nature qui apprend aux femmes à peindre leurs sentiments par des mots qui semblent dire tout le contraire de ce qu’ils expriment.
Je ne sais pas signifie, je ne sais que trop bien.
L’étranger la comprit et jouissant d’avance de son triomphe, il ajouta :
— Et pourquoi vos larmes coulent-elles, Immalie ?
— Je n’en sais rien, dit la pauvre Indienne, et ses larmes n’en coulèrent que plus fort.
À ces mots, ou plutôt à ces pleurs, l’étranger s’oublia pour un moment. Il sentait ce douloureux triomphe dont le vainqueur ne peut jouir ; ce triomphe qui annonce une victoire remportée sur la faiblesse des autres, aux dépens d’une faiblesse plus grande encore de notre cœur. Un sentiment d’humanité remplit, en dépit de lui-même, son âme, et il dit avec des accents d’une douceur involontaire :
— Que voudriez-vous donc que je fisse, Immalie ?
La difficulté qu’elle éprouvait à parler un langage qui fût à la fois intelligible et réservé, qui pût faire connaître ses désirs, sans trahir son cœur et la nature inconnue de ses nouvelles émotions, firent qu’Immalie balança longtemps avant de pouvoir répondre.
— Restez avec moi, dit-elle à la fin, ne retournez pas dans ce monde de maux et de chagrins. Ici les fleurs seront toujours fraîches, et le soleil aura toujours le même éclat que le jour où je vous vis pour la première fois. Pourquoi voulez-vous retourner dans le monde pour penser et être malheureux ?
Le rire sauvage et discordant que son interlocuteur lâcha à ces paroles, la fit frémir et la rendit muette.
— Pauvre enfant ! s’écria-t-il avec ce mélange d’amertume et de compassion qui effraye et qui humilie à la fois : « Est-ce là la destinée que je dois accomplir ? Est-ce à moi à prêter l’oreille au gazouillement des oiseaux, à guetter le bouton qui s’épanouit ? Est-ce là mon sort ? »
Il poussa encore un éclat de rire barbare et rejeta loin de lui la main qu’Immalie lui avait tendue en cessant de parler.
— Oui, sans doute ! Je suis bien fait pour un pareil sort et pour une pareille compagne ! Dites-moi, ajouta-t-il avec une férocité toujours croissante, dites-moi, si ce sont mes traits, ma voix ou mes discours qui vous ont inspiré l’idée de m’insulter en m’offrant dans l’avenir l’espérance du bonheur ?
Immalie, sans comprendre le fond de ce qu’il disait, eut assez de fierté virginale et de pénétration féminine pour comprendre que l’étranger la repoussait. Un sentiment de douleur et d’indignation lutta contre la tendresse de son cœur dévoué. Elle garda le silence un moment, puis, retenant ses larmes, elle dit du ton le plus ferme :
— Allez donc vers votre monde, puisque vous voulez être malheureux. Partez. Hélas ! il n’est pas nécessaire d’aller là pour être malheureux, car je le suis ici. Allez ; mais prenez avec vous ces roses, car elles se flétriront quand vous serez parti ; prenez avec vous ces coquillages, car je n’aurai plus le plaisir à les porter quand vous ne les verrez plus.
Pendant qu’elle parlait, elle détachait avec une action simple mais énergique, les fleurs et les coquillages dont ses cheveux et son sein étaient ornés, et elle les jetait à ses pieds ; puis, le regardant avec une douleur fière et mélancolique, elle s’éloignait, quand il s’écria :
— Restez, Immalie, restez, et écoutez-moi pour un moment. Peut-être dans ce moment aurait-il dévoilé le secret profond et inconcevable qui enveloppait sa destinée ; mais Immalie secoua tristement la tête dans un silence que sa profonde douleur rendait éloquent, et se retira.
XXIII
Plusieurs jours s’écoulèrent avant que l’étranger revînt visiter l’île. Il serait impossible à l’homme de découvrir quelles furent, dans cet intervalle, ou ses occupations, ou ses sensations. Peut-être que parfois il triomphait dans les maux qu’il avait infligés, et que parfois aussi il y compatissait. Poussé enfin ou par la malignité, ou par la tendresse, ou par la curiosité, ou par l’ennui d’une vie artificielle, avec laquelle la pure existence d’Immalie formait un contraste si parfait, il retourna dans l’Ile Enchantée, nom qu’elle avait reçu des Indiens du voisinage ; mais il lui fallut traverser bien des sentiers que nul pied humain n’avait encore foulés, bien des ruisseaux où nul pied n’avait trempé, avant qu’il pût découvrir le lieu où Immalie s’était cachée.
Elle n’avait cependant pas eu l’intention de se dérober à ses regards. Quand il la trouva, elle était appuyée contre un rocher. À ses pieds, l’Océan faisait retentir son murmure éternel. Elle avait choisi le site le plus sauvage qu’elle avait pu trouver. Il n’y avait près d’elle ni fleurs, ni buissons. Les seuls objets qui l’entouraient étaient les masses de rocs calcinés par l’action des volcans et les flots dans lesquels son pied se baignait, en paraissant à la fois inviter et mépriser le danger dont ils le menaçaient. La première fois que l’étranger l’avait vue, elle était environnée de fleurs et de parfums. Tout ce que la nature végétale et animale offre de plus brillant ; des roses et des paons semblaient lutter entre eux à qui répandrait sur elle un éclat plus vif et un baume plus délicieux. Aujourd’hui, elle paraissait abandonnée par la nature dont elle était l’enfant chéri. Elle reposait sur le rocher, et semblait avoir l’Océan pour lit. Elle n’avait ni coquillages dans son sein, ni roses dans ses cheveux ; son caractère paraissait changé avec ses sentiments. Elle n’aimait plus ce qu’il y avait de plus beau dans la nature. On eût dit que, prévoyant sa destinée, elle voulait d’avance se familiariser avec ce qu’elle avait de plus triste et de plus lugubre. Elle commençait à aimer les rochers et l’Océan, le murmure des flots et la stérilité des sables, objets mélancoliques dont la seule vue nous rappelle la douleur et l’éternité.
Ceux qui aiment peuvent chercher les délices des jardins, et s’enivrer des parfums qui semblent être les offrandes de la nature sur l’autel qui brûle déjà dans leur cœur ; mais que ceux qui ont aimé s’égarent sur les rivages de l’Océan : ils y entendront aussi une voix qui leur répondra.
Immalie, dans la solitude, avait un air morne et troublé qui semblait à la fois exprimer le conflit de ses émotions intérieures, et réfléchir la tristesse et l’agitation des objets physiques qui l’entouraient : car la nature préparait une de ces horribles convulsions, une de ces agonies intempestives qui servent à annoncer, pour l’avenir, une colère plus complète, et qui, par la destruction de la nature animée sur un espace limité, proclame, dans les roulements de son tonnerre, qu’un jour viendra où le monde entier sera détruit de même, et où s’accomplira la promesse terrible que cette dévastation partielle s’est bornée à prédire.
La soirée était sombre ; d’épais nuages obscurcissaient l’horizon, du levant au couchant. Un azur pâle brillait au haut des cieux, et ressemblait à l’éclat des yeux d’un mourant. Pas un souffle ne ridait la surface de la mer ; les feuilles se penchaient sans qu’un zéphyr vînt les soulever ; les oiseaux s’étaient retirés, guidés par cet instinct qui leur apprend à éviter le terrible combat des éléments. L’aile abattue et la tête penchée, ils se cachaient dans les branches de leurs arbres favoris. La nature, dans ses grandes et terribles opérations, ressemble à un juge qui garde un silence profond, quelques moments avant de prononcer la terrible sentence qui va sortir de sa bouche implacable.
Immalie considérait le spectacle effrayant qui l’environnait sans aucune émotion née de causes physiques. Jusqu’alors le jour et les ténèbres avaient été la même chose pour elle. Elle aimait le soleil à cause de sa lumière durable, et la foudre pour son éclat passager. L’Océan lui plaisait par son retentissement sonore, et la tempête par l’agitation qu’elle causait aux feuilles des arbres ; enfin, elle aimait le repos de la nuit et la douce lumière des étoiles.
Telle, du moins, elle avait été jadis. Cette fois, son œil se fixait sur le jour qui baissait pour faire place à l’obscurité, à cette obscurité contre nature qui semblait dire aux plus beaux ouvrages de la Divinité : Retirez-vous ; vous ne brillerez plus.
Les ombres s’épaississaient, et les nuages, semblables à une armée qui a réuni toutes ses forces, se préparaient à combattre les rayons épais de lumière qui brillaient encore dans le ciel. Une seule bande large et d’un
rouge obscur bordait l’horizon. Le murmure des eaux augmentait, et le tronc du manglier frémissait, tandis que ses branches enracinées semblaient vouloir abandonner la terre à laquelle elles s’étaient unies. En un mot, la nature, par toutes les voix que pouvaient lui prêter la terre, les airs et les eaux, annonçait à ses enfants un danger imminent.
Ce fut là le moment que l’étranger choisit pour s’approcher d’Immalie. Il était insensible au danger, et ne connaissait point la crainte. Sa misérable destinée l’avait mis à l’abri de l’un et de l’autre : mais que lui avait-elle laissé ? Une seule espérance, celle de plonger les autres hommes dans sa propre condamnation. Une seule crainte, celle de voir sa victime lui échapper. Cependant, malgré sa cruauté diabolique, il ne put s’empêcher de sentir un mouvement de componction en apercevant la jeune Indienne. Ses joues étaient pâles, mais son œil était fixe, et sa figure détournée, comme si elle avait préféré la tempête à ses regards, semblait dire : Puissé-je tomber dans les mains de Dieu plutôt que dans celle des hommes !
Cette attitude qu’Immalie avait prise sans aucune intention, et qui n’exprimait nullement ses véritables sentiments, rendit au cœur de l’étranger toute sa malignité naturelle. Ses projets cruels et ses désirs habituellement sombres et diaboliques reprirent tout leur empire. En voyant le contraste de l’innocence sans secours au milieu des convulsions de la nature, il éprouva le même sentiment de plaisir qu’il ressentait quand, au moyen de la puissance surnaturelle qui lui avait été départie, il pénétrait dans les cabanes des fous ou dans les cachots de l’Inquisition. Il semblait se dire que la foudre qu’il était prêt à diriger contre le cœur de cet être si pur, était plus sûre que celle des nuages qui brillaient autour d’elle.
Armé de toute sa perversité et de toute sa puissance, il s’approcha d’Immalie, qui n’était défendue que par sa pureté. Il y avait, entre sa personne et sa position, un contraste qui aurait touché tout autre que l’Homme errant. L’éclat de sa figure brillait au milieu de l’obscurité qui l’environnait ; et sa douceur était rendue plus remarquable encore par la sévérité du rocher contre lequel elle s’appuyait.
L’étranger s’approcha sans être aperçu. Le murmure des flots et des vents couvrait le bruit de ses pas : mais, en s’avançant il entendit des sons qui l’étonnèrent. Il s’arrêta pour les écouter. C’était la pauvre Indienne, qui, sans connaître et sans craindre son danger, chantait aux échos de la tempête une espèce d’hymne sauvage de désespoir et d’amour. En voici quelques strophes :
« La nuit devient plus obscure ; mais cette obscurité qu’est-elle auprès de celle que son absence a répandue sur mon âme ? Les éclairs brillent autour de moi ; mais que sont-ils auprès de l’éclat de son œil quand il m’a quittée en courroux?
« Je n’ai vécu que dans la lumière de sa présence ; pourquoi ne mourrai-je pas quand cette lumière m’est ôtée ? Courroux des nuages, qu’ai-je à craindre de vous ? Vous pouvez me réduire en poussière, comme je vous l’ai vu faire aux branches des arbres ; mais le tronc restait, et mon cœur sera toujours à lui.
« Mugissez, terrible mer ; vos flots, que je ne puis compter, n’effaceront point son image de mon cœur. Mon cœur restera ferme comme le rocher,
même au sein des calamités de ce monde dont il me menace, de ce monde dont, sans lui, je n’aurais jamais connu les dangers, et que je suis prête à braver pour lui.
« Quand nous nous rencontrâmes pour la première fois, mon sein était couvert de roses ; aujourd’hui, je les rejette loin de moi. Quand il me vit la première fois, tous les êtres vivants m’aimaient ; maintenant leur amour m’est indifférent, je ne sais plus les aimer. Quand il venait tous les soirs me voir, je désirais que la lune brillât ; maintenant je la vois sans regret se cacher dans les nuages. Avant qu’il fût venu tout m’aimait, et j’aimais toute la nature ; maintenant je sens que je ne puis aimer qu’un objet et cet objet m’a abandonnée. Depuis que je l’ai vu tout a changé de face. Les fleurs n’ont plus leurs brillantes couleurs ; le murmure des eaux est moins doux ; les étoiles ne me sourient plus du haut des cieux, et moi-même je commence à préférer la tempête au calme. »
En terminant son chant sauvage, elle voulut quitter le lieu où la fureur toujours croissante de la tempête ne lui permettait plus de rester, quand, en se retournant, elle vit les yeux de l’étranger fixés sur elle. À cet aspect, elle rougit, et ne fit point entendre le cri de joie avec lequel elle avait l’habitude de le recevoir ; mais elle le suivit, d’un pied chancelant et en détournant la tête, jusqu’aux ruines de la pagode, où il lui faisait signe de venir chercher un asile contre le courroux des éléments.
Ils s’en approchèrent en silence ; et il était étrange de voir, au milieu des convulsions de la nature, deux êtres marcher ensemble sans prononcer un mot de crainte, sans éprouver un sentiment d’inquiétude. L’un était armé par son désespoir ; l’autre par son innocence. Immalie aurait préféré l’abri de son bananier favori ; mais l’étranger essaya de lui faire comprendre qu’elle y courrait plus de danger que dans le lieu qu’il lui indiquait.
— Du danger ! s’écria l’Indienne avec un sourire vague, mais enchanteur ; en puis-je courir quand vous êtes auprès de moi ?
— N’y a-t-il donc point de danger en ma présence ? Bien peu de personnes m’ont vu sans en craindre et même sans en éprouver.
Pendant qu’il parlait ainsi, son front se couvrait de nuages plus sombres que ceux qui obscurcissaient le ciel.
— Immalie, ajouta-t-il d’une voix que rendait plus pénétrante l’émotion inusitée qui remplissait son cœur, Immalie, vous ne pourriez être assez faible pour me croire en état de commander aux éléments ? Si je l’étais ; j’en atteste ce ciel qui me contemple avec colère, le premier acte de mon pouvoir serait de choisir sa foudre la plus prompte et la plus meurtrière pour vous clouer à la place où je vous vois.
— Moi ! répéta l’Indienne tremblante, et pâlissant plutôt de ses paroles et du ton dont il les prononçait que de la fureur redoublée de la tempête.
— Oui, oui, vous ; malgré toute votre amabilité, votre innocence, votre pureté ! Et ce serait pour empêcher qu’un feu bien plus ardent ne consume votre existence et ne tarisse la source de votre sang ; pour que vous ne soyez plus exposée à un danger mille fois plus funeste que celui dont les éléments vous menacent, le danger de ma maudite et misérable présence !
Immalie ne sachant ce qu’il voulait dire, mais compatissant à l’agitation qu’il paraissait éprouver, s’approcha de lui pour calmer, s’il était possible,
une émotion dont elle ne pouvait deviner ni le nom ni la cause. Pâle, échevelée, les mains jointes, on eût dit qu’elle demandait pardon d’un crime qu’elle ignorait. Tout autour d’elle était sauvage et terrible. La terre était jonchée de fragments de pierres et de décombres, tandis que la voûte entr’ouverte donnait passage par moments à des éclats d’une lumière terrible plus effrayante que les ténèbres. Au sein de cette désolation, elle semblait un ange descendu du ciel avec un message de réconciliation qu’elle apportait en vain.
L’étranger lui lança un de ces regards qu’aucun œil mortel, autre que le sien, n’avait encore pu contempler sans effroi ; mais son expression ne fit qu’inspirer à la victime un dévouement plus complet. Peut-être un sentiment de terreur involontaire se mêlait-il à cette expression, lorsque cette belle créature se jeta aux pieds de son ennemi désespéré, et le supplia par son silence, plus éloquent que des paroles, d’avoir pitié de lui-même. Toutes ses sensations semblaient concentrées sur l’objet mal choisi de leur idolâtrie. Tout en elle indiquait cette soumission que le cœur d’une femme éprouve pour les fautes, les passions, les crimes même de l’objet qu’elle aime. Immalie s’était d’abord inclinée devant celui qu’elle aimait dans l’espoir de le fléchir ; elle s’était ensuite mise à genoux en restant loin de lui. Elle finit par saisir sa main ; et la pressa de ses lèvres décolorées. Elle voulut prononcer quelques paroles, mais ses larmes, qui baignaient la main qu’elle tenait, l’en empêchèrent, tout en s’expliquant pour elle. Cette main lui fit, dans le premier moment, une réponse en serrant la sienne avec un mouvement convulsif ; mais l’étranger ne tarda pas à la rejeter loin d’elle. Elle restait effrayée et prosternée devant lui.
— Immalie, dit l’étranger avec effort, désirez-vous que je vous explique les sentiments que ma présence devrait vous inspirer ?
— Non, non, non, dit l’Indienne en appliquant ses mains blanches et délicates, d’abord à ses oreilles et puis à sa poitrine, je ne les sens que trop.
— Haïssez-moi, maudissez-moi, dit l’étranger, sans faire attention à ce qu’elle venait de dire, et frappant du pied avec violence : haïssez-moi, car je vous hais. Je hais tout ce qui existe, tout ce qui n’est plus ; je suis moi-même haï et haïssable !
— Ce n’est pas moi qui vous hais, dit la pauvre Indienne en tâtonnant à travers ses larmes, pour saisir sa main qu’il éloignait.
— Vous me haïriez comme les autres, si vous saviez qui je suis et qui je sers.
Immalie appela à son secours toute l’énergie du cœur et de l’esprit qu’elle venait nouvellement d’acquérir, pour répondre à cette observation.
— Je ne sais qui vous êtes ; mais je suis à vous. Je ne sais qui vous serez ; mais, qui que ce soit, je le servirai aussi. Je veux être à vous pour toujours. Abandonnez-moi si vous voulez ; mais quand je serai morte, revenez dans cette île, et dites en vous-même : les roses ont fleuri et se sont fanées ; les ruisseaux ont coulé et se sont desséchés ; les rochers ont été déplacés et les astres dans le ciel ont changé leurs cours ; mais il existait un cœur qui n’a jamais changé et il n’est point ici !
— Immalie ! dit l’étranger.
Elle le regarda, et, avec un mélange d’étonnement et de douleur, elle vit couler des larmes de ses yeux. L’instant d’après, il les essuya avec un geste de désespoir, et grinçant des dents, il poussa un éclat de ce rire
convulsif, qui indique que nous sommes nous-mêmes l’objet de notre raillerie. Immalie, que ses sensations avaient fatiguée à l’excès, tremblait en silence à ses pieds.
— Écoutez-moi, malheureuse fille ! s’écria-t-il d’un ton où la malignité se mêlait à la compassion, et une inimitié habituelle à une douceur involontaire ; écoutez-moi. Je connais le sentiment secret contre lequel vous luttez mieux que le cœur innocent qui le renferme. Bannissez ce sentiment, détruisez-le. Écrasez-le comme vous feriez d’un jeune reptile avant que le temps l’ait rendu aussi dégoûtant que venimeux.
— Je n’ai jamais de ma vie écrasé de reptile, dit Immalie.
— Vous aimez donc, dit l’étranger ; mais ajouta-t-il, après une longue et fatale pause, savez-vous quel est l’être que vous aimez ?
— C’est vous, dit l’Indienne, avec cette sincérité de l’innocence, qui rend sacrée l’impulsion à laquelle elle cède, et qui rougirait plutôt des faussetés de l’art, que de la confiance de la nature : c’est vous ! Vous m’avez appris à penser, à aimer, à pleurer.
— C’est donc pour cela que vous m’aimez ! Songez pour un moment, Immalie, à l’indignité de l’objet auquel vous prodiguez les trésors de votre sensibilité. Il n’a rien d’attrayant dans son extérieur. Ses habitudes sont même repoussantes. Il est séparé de la vie et de l’humanité par un abîme impossible à franchir. C’est un enfant déshérité par la nature, qui erre au loin pour tenter ou pour maudire ses frères plus heureux que lui ; un être qui… Mais qu’est-ce qui m’empêche de vous tout dévoiler ?
Dans ce moment un éclair d’une vivacité telle qu’aucun œil humain n’en aurait pu supporter l’éclat, brilla à travers les ruines et répandit une lumière affreuse. Immalie éprouva un effroi et une émotion involontaires. Elle tomba sur ses genoux et couvrit de ses mains ses yeux éblouis et souffrants.
Elle demeura ainsi pendant quelques moments et crut entendre parler à côté d’elle ; il lui semblait que l’étranger répondait à une voix qui lui adressait la parole. Elle distingua les mots suivants au bruit du tonnerre qui roulait dans le lointain :
— Cette heure est à moi et non à toi… va-t-en, et ne m’importune pas. Quand elle leva les yeux, toute apparence d’émotion avait fui loin des
traits de l’étranger. L’œil sec et brûlant du désespoir qu’il fixait sur elle semblait n’avoir jamais connu une larme. La main avec laquelle il la saisit semblait n’avoir jamais renfermé de sang, son attouchement était froid comme celui de la mort.
— Miséricorde ! s’écria l’Indienne en tremblant, et en cherchant vainement un sentiment d’humanité dans des yeux que les siens invoquaient, baignés de larmes. Miséricorde !
En prononçant ce mot elle ne savait ni ce qu’elle demandait, ni ce qu’elle craignait.
L’étranger ne répondit rien ; pas un de ses muscles ne se relâcha. On eût dit qu’il la serrait de ses mains sans la sentir, qu’il la regardait sans la voir. Il la porta ou plutôt il la traîna jusqu’à cette vaste arcade qui avait servi autrefois d’entrée à la pagode, mais qui, dans l’état de délabrement où elle se trouvait ressemblait plutôt à la bouche d’une caverne, demeure des habitants du désert, qu’au travail de l’homme, consacré par lui au culte de la divinité.
— Vous avez imploré la miséricorde, lui dit son compagnon d’une voix qui glaça son sang, malgré la chaleur étouffante de l’atmosphère. Vous avez imploré la miséricorde et vous l’aurez. Je n’en ai point trouvé, mais j’ai recherché mon affreuse destinée ; ma récompense est juste et assurée. Lève les yeux, femme tremblante : lève les yeux, je te l’ordonne.
Obéissant à ses ordres, elle écarta de ses yeux les longues tresses de cheveux dont elle venait de balayer en vain le rocher empreint des pas de celui qu’elle adorait. Avec la docilité d’un enfant et la douce soumission d’une femme, elle essaya de faire comme il lui disait ; mais ses yeux remplis de larmes ne purent supporter l’horreur du spectacle qui l’entourait. Elle essuya ses yeux brillants avec une chevelure qui se baignait chaque jour dans le cristal des eaux, et tandis qu’elle s’efforçait de fixer ses regards sur la désolation de la nature, elle ressemblait à un esprit céleste, forcé de contempler les effets de la colère du Tout-Puissant, dont il adore les derniers résultats quoique ses opérations lui soient inintelligibles.
Immalie s’approcha donc des ruines et pour la première fois elle frémit en contemplant la nature. Jadis tous ses phénomènes lui avaient paru également terribles ou sublimes. L’éclat du soleil ou la sombre horreur de l’orage contribuaient également à la dévotion involontaire du cœur le plus pur. Mais depuis qu’elle avait vu l’étranger, de nouvelles émotions avaient rempli ce jeune cœur. Elle avait appris à pleurer et à craindre, et peut-être voyait-elle dans l’aspect effrayant des cieux le développement de cette terreur mystérieuse qui se cache toujours au fond du cœur de ceux qui osent aimer.
— Immalie, s’écria l’étranger, est-ce ici le lieu, est-ce le moment de parler d’amour ? La nature entière tremble, le ciel est obscurci, les animaux se cachent, les buissons mêmes frémissent, comme s’ils partageaient la terreur générale.
— C’est le moment d’implorer une protection puissante, dit Immalie en s’attachant à lui avec timidité.
— Levez les yeux, reprit l’étranger, tandis que les siens, fixes et sans émotion, semblaient répondre par un éclair à chaque trait que lançait la foudre ; levez les yeux, et, si vous n’avez pas la force de résister aux mouvements de votre cœur, permettez-moi du moins de vous en indiquer un objet plus convenable.
— Aimez, ajouta-t-il en étendant les bras vers les cieux livides et troublés, aimez l’orage dans toute sa force destructive. Unissez-vous à ces voyageurs rapides et périlleux des airs, à la foudre qui les déchire, au tonnerre qui les ébranle ! Cherchez un abri tutélaire sous ces épais nuages, sous ces montagnes des cieux dont les bases ne reposent sur rien ! Cherchez pour compagnon, pour amant, tout ce que la nature a de plus terrible ; suppliez-les de vous réduire en cendres ; périssez dans leurs cruels embrasements, et vous serez plus heureuse, bien plus heureuse que si vous aviez vécu dans les miens. Vécu, que dis-je ? Oh ! qui peut être à moi et continuer à vivre ? Écoutez-moi, Immalie, écoutez-moi !
En faisant cette apostrophe, il prit ses mains dans les siennes ; ses yeux, fixés sur elle, brillaient d’un éclat plus vif même qu’à l’ordinaire, tandis qu’un nouvel enthousiasme semblait pour un moment ébranler et donner un ton inusité à tout son être.
— Si vous voulez être à moi, il faut que ce soit au milieu d’une scène comme celle-ci ; au sein des flammes et des ténèbres, au sein de la haine et du désespoir, au sein…
Sa voix n’était déjà plus qu’un cri diabolique de rage et d’horreur ; il étendait les bras comme pour lutter contre quelque objet que lui présentait son imagination, et il allait s’élancer du lieu où il s’était placé avec Immalie, poursuivi par le tableau que ses crimes et son désespoir avaient tracé, et par les images qu’il était condamné à contempler pour jamais.
Par ce mouvement soudain, la douce Immalie, perdant son appui, se trouva étendue à ses pieds. Sa voix était étouffée par la crainte, mais elle n’en conservait pas moins ce dévouement complet que le cœur d’une femme sait seul éprouver, et, à ses plus effrayantes questions, elle se contentait de répondre :
— Serez-vous là ?
— Oui, la je dois être et pour jamais ! Et voudriez-vous, oseriez-vous y être avec moi ?
Une sauvage et terrible énergie donnait à sa voix une force extraordinaire, pendant qu’il adressait ces mots affreux à l’être aimable qui, étendu à ses pieds, semblait une tourterelle fascinée qui s’élance dans le bec du vautour.
Une légère convulsion agita les traits livides de l’étranger, et il ajouta :
— Eh bien donc ! au milieu du tonnerre, je t’épouse, fiancée de la perdition ! tu seras à moi pour toujours ! Viens, répétons nos vœux sur l’autel chancelant de la nature : les foudres du ciel seront nos cierges, et la malédiction de l’univers sera notre bénédiction nuptiale.
L’Indienne jeta un cri d’effroi, non à ses discours qu’elle ne comprenait pas, mais à l’expression qui les accompagnait.
— Viens, répéta-t-il, afin que les ténèbres soient les témoins de notre union mémorable et éternelle !
Immalie, pâle, effrayée, mais ferme, s’éloigna de lui.
Dans cet instant, l’orage, qui avait obscurci les cieux et ravagé la terre, se dissipe, avec la rapidité ordinaire dans ces climats où ces terribles phénomènes ne durent que peu de moments, et sont bientôt remplacés par le ciel le plus pur et le plus brillant. À mesure que l’étranger parlait, les nuages s’entr’ouvaient, et la lune apparut bientôt avec un état inconnu au ciel de l’Europe. La jeune Indienne trouva, dans cette circonstance, un présage aussi favorable à son imagination qu’à son cœur. Elle s’arracha d’auprès de l’étranger, et s’élançant dans la lumière de la nature, dont l’éclat pouvait se comparer à la promesse de la rédemption, brillant au sein des ténèbres de la chute de l’homme, elle montra du doigt la lune, ce soleil des nuits de l’Orient, dont la lumière large et argentée couvrait, comme d’un manteau de gloire, les rochers et les ruines, les arbres et les fleurs.
— Épousez-moi à cette lumière, s’écria-t-elle, et je serai à vous pour toujours !
Sa physionomie céleste réfléchissait la lumière de la belle planète qui poursuivait sa course dans un ciel sans nuage ; tandis que ses bras blancs et nus qu’elle étendait vers la lune semblaient deux témoins sans tache de leur union.
— Épousez-moi à cette lumière, répéta-t-elle en se mettant à genoux, et je serai à vous pour toujours !
Tandis qu’elle parlait, l’étranger s’approcha d’elle avec des sentiments qu’aucune pensée humaine ne pénétrera jamais. Dans ce moment, un léger phénomène vint changer sa destinée. Un nuage obscur couvrit, pour un instant, la lune. On eût dit que l’orage se hâtait de recueillir les derniers restes de sa fureur passée, pour s’évanouir ensuite à jamais.
Les yeux de l’étranger se fixèrent sur Immalie avec un mélange affreux de tendresse et de férocité. Il montra les nuages, et dit :
— Épousez-moi par cette lumière, et vous serez à moi aux siècles des siècles !
Immalie frémit en sentant sa main qui la saisissait avec force. Elle essaya vainement de découvrir l’expression de sa physionomie, mais elle comprit assez son danger pour s’arracher de ses bras.
— Adieu, pour jamais ! s’écria l’étranger en s’éloignant d’elle à son tour.
Immalie, épuisée par l’émotion et la terreur, était tombée, privée de sentiment, sur un des monticules de décombres qui couvraient le sentier de la pagode ruinée. L’étranger revint ; il la souleva dans ses bras ; ses longs cheveux noirs les couvraient ; elle n’avait plus de mouvement ; sa joue froide et décolorée s’appuyait sur son épaule.
— Est-elle morte ? murmura-t-il tout bas. Eh bien ! soit ! qu’elle périsse ! qu’elle meure mille fois plutôt que d’être à moi !
En disant ces mots, il replaça son immobile fardeau sur les décombres, et quitta l’île pour n’y plus rentrer.
XXIV
Trois ans s’étaient écoulés depuis la séparation d’Immalie et de l’étranger, quand, un soir, l’attention de quelques gentilshommes espagnols qui se promenaient dans une allée du Prado de Madrid, se fixa sur une personne qui passait auprès d’eux. Ses vêtements étaient ceux du pays, mais il ne portait point d’épée, et marchait fort lentement. Ils s’arrêtèrent avec un tressaillement simultané, et parurent se demander, l’un l’autre, par leurs regards, quelle avait été la cause de l’impression que l’apparition de cet individu avait faite sur eux. Il n’y avait rien de remarquable dans sa figure. Il marchait tranquillement, mais c’était l’expression singulière de sa physionomie qui les avait frappés d’une sensation qu’aucun d’eux ne pouvait expliquer.
Ils étaient encore à la même place, quand l’inconnu repassa devant eux, marchant toujours avec la même lenteur, et ils rencontrèrent de nouveau cette singulière expression dans les traits, et surtout dans les yeux, qu’aucun regard humain ne pouvait contempler sans frémir. Accoutumés à considérer des objets révoltants pour la nature et pour l’homme, parcourant sans cesse les hospices des aliénés, les prisons de l’Inquisition, les cavernes de la faim, les cachots du crime ou le lit de mort du désespoir, ils avaient contracté un éclat et un langage qui leur étaient propres : un éclat que nul ne pouvait envisager, un langage que peu d’hommes auraient osé comprendre.
Ces gentilshommes observèrent deux autres personnes dont l’attention paraissait, comme la leur, fixée sur le même objet : car elles le montraient du doigt, et se parlaient à voix basse avec des gestes qui indiquaient une émotion forte et évidente. La curiosité du groupe vainquit, pour une fois, la réserve espagnole ; et, s’approchant des deux cavaliers, on leur demanda si l’étrange personnage qui venait de passer devant eux n’avait pas été le sujet de leur conversation, et la cause de l’émotion qui avait marqué leurs discours.
Ils répondirent affirmativement, et ajoutèrent qu’ils étaient instruits de certaines circonstances du caractère et de l’histoire de cet être extraordinaire, qui pouvaient justifier des marques d’émotion plus fortes encore à son aspect. Ces paroles augmentèrent la curiosité des passants, et le groupe devint plus nombreux. Quelques personnes savaient, ou prétendaient savoir des détails sur ce sujet remarquable, et il s’entama une de ces conversations vagues dont la matière principale se compose d’ignorance, de curiosité et de frayeur, mêlées à quelque peu de vérités et de connaissances positives ; de ces conversations peu satisfaisantes, mais qui ne manquent pas d’intérêt ; où chaque interlocuteur est bien aise de contribuer pour sa part aux bruits, aux conjectures, aux anecdotes, d’autant plus facilement crues qu’elles sont plus incroyables, et aux conclusions d’autant plus convaincantes qu’elles sont plus fausses.
Voici de quoi donner une idée de cette conversation.
— Mais quoi ! dit l’un des interlocuteurs : s’il est réellement ce que l’on pense, ce que l’on assure qu’il est, pourquoi ne l’arrête-t-on pas ? Pourquoi l’Inquisition ne s’en empare-t-elle pas ?
— Il a déjà souvent été dans les prisons du Saint-Office, répondit un second ; plus souvent peut-être que les révérends pères ne l’eussent voulu.
— Le fait est cependant certain, qu’il a toujours été délivré sur-le-champ. Un quatrième ajouta que cet inconnu avait été enfermé, tour à tour, dans toutes les prisons de l’Europe, mais qu’il avait toujours trouvé moyen de mettre en défaut la puissance qui paraissait le tenir dans ses mains. Au moment même où l’on croyait qu’il expiait ses crimes dans un pays, il en commettait déjà de nouveaux dans un autre.
— Sait-on quelle est sa patrie ? demanda quelqu’un.
— Il est originaire de l’Irlande, répondit-on, pays peu connu, et où, par divers motifs, ses habitants ne restent qu’avec répugnance. Il s’appelle Melmoth.
Un des interlocuteurs qui paraissait en savoir plus que les autres, leur fit part de la promptitude inconcevable avec laquelle cet étranger se transportait d’un pays à l’autre, promptitude qui surpassait tous moyens humains. Il leur raconta aussi, que sa coutume était de rechercher partout les êtres les plus misérables et les plus vicieux, sans que l’on pût deviner le motif qu’il avait pour se plaire dans leur société. Comme il achevait de parler, une voix grave frappa les oreilles des personnes rassemblées. Elle prononça ces mots :
— Ce motif est bien connu d’eux et de lui.
Le jour était baissé, ce qui n’empêchait pas que l’on distinguât fort bien la figure de l’étranger. Quelques personnes assurèrent même qu’elles avaient observé l’éclat remarquable de ses yeux, qui ne brillaient jamais sur la destinée des hommes que comme des planètes de malheur. Le groupe s’arrêta pendant quelque temps pour guetter le départ de cette figure, qui avait produit sur elle l’effet d’une torpille. Elle s’éloigna lentement ; personne ne tenta de l’arrêter.
? J’ai entendu dire, observa quelqu’un, que la musique la plus délicieuse précède l’approche de cette personne quand elle se trouve près de la victime qu’il lui est permis de tenter ou de tourmenter. Parfois, cette musique n’est sensible que pour la victime seule ; dans d’autres moments, les assistants peuvent l’entendre aussi. On m’en a fait les relations les plus étonnantes… La Sainte Vierge Marie nous protège !… Avez-vous jamais ouï de pareils sons ?
— Il n’est pas étonnant, dit un jeune fat de la société, que l’approche d’une créature aussi céleste que celle que j’aperçois soit annoncée par des sons délicieux.
Comme il parlait, tous les yeux se tournèrent vers une jeune femme qui, placée au milieu d’un groupe de personnes charmantes, les surpassait toutes par l’élégance de sa taille et sa marche noble, gracieuse et aisée. Elle ne cherchait point à attirer les regards ; mais les regards s’arrêtaient tous sur elle, sans pouvoir s’en détacher. En vain ses compagnes faisaient-elles usage de toutes les armes que leur fournissait la coquetterie pour fixer l’attention des cavaliers ; il y en avait une dont les armes n’étaient point artificielles : elles n’étaient formées que du contraste de ses attraits singuliers et simples, avec l’arrangement étudié des autres. Quand elle s’éventait, c’était vraiment pour se rafraîchir ; quand elle arrangeait son voile, c’était pour couvrir sa figure ; quand elle ajustait sa mantille, c’était pour cacher cette taille, dont la rare perfection n’était pas déguisée même par la volumineuse draperie qui la couvrait. Les hommes les plus dissolus ne pouvaient la contempler qu’avec un respect involontaire ; les infortunés trouvaient de la consolation à la regarder ; les vieux songeaient à leur jeunesse, et les jeunes éprouvaient pour la première fois ce sentiment qui seul mérite le nom d’amour, parce que la pureté seule peut l’inspirer ou le récompenser.
Nous avons déjà remarqué combien ses mouvements étaient gracieux et aisés. En effet, ils avaient tous une élasticité, un ressort, une vitalité, qui faisaient que chacune de ses actions était l’expression d’une pensée. Elle s’en apercevait soudain, et les efforts qu’elle faisait pour cacher ce qu’elle avait annoncé malgré elle, découvraient un nouveau charme à des sensations ainsi dévoilées. Autour d’elle régnait cet éclat d’innocence, de majesté, qui ne se trouve jamais uni que dans son sexe. Les hommes peuvent conserver longtemps sur leurs traits l’expression de la puissance que la nature leur a départie ; mais celle de l’innocence tarde peu à s’oblitérer.
Au milieu de toutes les grâces vives et un peu extraordinaires d’une figure qui semblait ne connaître d’autres lois que celles qu’elle s’était imposées à elle-même, régnait une teinte de mélancolie qui, aux yeux d’un observateur superficiel, aurait pu paraître passagère ou affectée ; mais qui, à d’autres, offrait la preuve que tandis que toute l’énergie de son intelligence était occupée et tout l’instinct de sa raison éveillé, son cœur était encore vide et demandait un habitant.
Le groupe de cavaliers, qui avait été occupé à causer de l’étranger, se sentit irrésistiblement attiré à la vue de cet objet. Leurs chuchotements craintifs se changèrent en exclamations de plaisir et d’étonnement en voyant passer cette femme charmante. À peine avait-elle fait quelques pas pour s’éloigner, que l’on vit l’étranger se retourner lentement : les femmes le rencontrèrent. Son regard fixe en choisit une seule sur laquelle il s’attacha. Elle le vit, le reconnut, jeta un grand cri et tomba par terre privée de sentiment.
Le tumulte occasionné par cet accident que tout le monde avait vu, sans que personne en pût deviner la cause, détourna pendant quelques instants, l’attention, qui cessa de se porter sur l’étranger. Chacun s’occupait d’assister la jeune dame ou de demander de ses nouvelles. On s’empressa de la porter dans sa voiture, et au moment où elle y fut placée, une voix, non loin d’elle, prononça le mot d’Immalie ! Elle reconnut cette voix et se retourna, avec un regard d’angoisse et un faible cri, vers le côté d’où elle était partie. Ceux qui l’entouraient l’avaient entendue comme elle ; mais ne comprenant pas le sens du mot et ne sachant pas à qui il s’adressait, ils attribuèrent l’émotion de la jeune dame à son indisposition. La voiture partit et l’étranger la suivit des yeux. Bientôt la société se dispersa : il resta seul. Les ombres s’épaississaient ; il ne paraissait pas remarquer ce changement. Un petit nombre de personnes, qui ne l’avaient pas perdu de vue, continuaient à se promener pour l’observer. Il ne les aperçut pas. L’un de ceux qui restèrent le plus longtemps dit qu’il lui avait vu faire un geste comme pour essuyer ses yeux. Les larmes de la pénitence lui étaient à jamais prohibées. Était-ce donc la passion qui aurait fait couler celles-là. Dans ce cas, malheur à l’objet de cette passion !
XXV
Le lendemain, la jeune personne, qui avait excité tant d’intérêt, devait quitter Madrid pour passer quelques semaines dans un château peu éloigné de la capitale, et qui appartenait à sa famille. Cette famille se composait de sa mère, dona Clara d’Aliaga, épouse d’un riche négociant, que l’on attendait d’un moment à l’autre de retour des Indes ; de son frère don Fernand d’Aliaga, et d’un grand nombre de domestiques : car ces riches citoyens, fiers de leur opulence et de la noblesse de leurs ancêtres, se piquaient de voyager avec autant de lenteur et de cérémonie que le premier grand du royaume. Aussi le vieux et lourd carrosse s’avançait gravement comme un corbillard. Le cocher dormait sur le siège, et les six chevaux noirs ne changeaient jamais leur pas solennel et mesuré. Fernand d’Aliaga et les domestiques étaient à cheval à côté de la voiture, dans laquelle s’étaient placées dona Clara et sa fille.
Dona Clara était une femme d’une humeur grave et d’un caractère froid. Elle avait toute la solennité d’une Espagnole et toute l’austérité d’une dévote. Don Fernand offrait l’union des passions vives et des mœurs austères, assez commune parmi les habitants de l’Espagne. Son orgueil triste et personnel était blessé quand il se rappelait que sa famille avait dérogé en se livrant au commerce ; et il regardait l’extrême beauté de sa sœur comme le moyen le plus probable de recouvrer son rang par une alliance avec une famille illustre ; il la contemplait avec cette partialité, mêlée d’égoïsme, aussi peu honorable pour celui qui l’éprouve que pour celle qui l’inspire.
C’était au milieu de pareils êtres que la vive et sensible Immalie, la fille de la nature, était condamnée à voir flétrir la fleur d’une existence transplantée dans un climat si étranger pour elle. Sa singulière destinée semblait ne l’avoir éloignée d’un désert physique que pour la placer dans un désert moral. Sa dernière position était peut-être plus triste encore que la première.
Il est certain que le point de vue le plus lugubre n’offre rien d’aussi glaçant que l’aspect de figures humaines, sur lesquelles nous cherchons vainement à découvrir une expression qui réponde à ce que nous sentons. La stérilité de la nature est de l’abondance quand on la compare à celle d’un cœur qui communique sa désolation à tout ce qui l’entoure.
Il y avait déjà quelque temps qu’ils étaient en route, quand dona Clara, qui ne parlait jamais qu’après une longue préface muette, sans doute pour donner une espèce de poids à ce qui, sans cela n’en aurait eu aucun, dit du ton d’un oracle :
— Ma fille, on m’a appris que vous vous étiez trouvée mal hier au soir dans une promenade publique : auriez-vous rencontré quelque objet qui vous ait surprise ou effrayée ?
— Non, Madame.
— Quelle a donc pu être la cause de l’émotion que vous avez témoignée… m’a-t-on dit… car je n’en ai aucune connaissance… à la vue d’un personnage d’une apparence extraordinaire ?
— Oh ! je ne puis, je n’ose vous le dire, répondit Immalie en baissant son voile sur sa figure rougissante.
Puis tout à coup, l’irrépressible ingénuité de sa première nature reprenant tout son empire sur elle, elle se laissa glisser du coussin où elle était assise et embrassant les genoux de dona Clara, elle s’écria :
— Ô ma mère ! je vous dirai tout.
— Non, dit dona Clara, en la repoussant avec toute la froideur de l’orgueil offensé ; non, cela n’est pas nécessaire. Je ne recherche point une confiance qu’on me retire et qu’on me rend tout d’une haleine. Je n’aime pas non plus ces émotions violentes. Elles sont indignes d’une jeune fille. Rien n’est plus simple que vos devoirs d’enfant. Ils consistent en une parfaite obéissance, une soumission profonde et un silence non interrompu, à moins que la parole ne vous soit adressée par moi, par votre frère ou par le père Jozé. Certes, il n’est point de devoirs plus faciles. Levez-vous donc et cessez de pleurer ; si votre conscience est troublée, le père Jozé ne manquera pas de vous infliger une pénitence proportionnée à votre faute.
Après ce discours, dona Clara, qui n’en avait jamais autant dit à la fois, se reposa sur son coussin et commença à défiler son chapelet avec la plus grande dévotion. Elle s’endormit ensuite d’un sommeil profond dont elle ne se réveilla que quand la voiture arriva à sa destination.
Il était midi, et le dîner servi dans un appartement de plain-pied avec le jardin, n’attendait que l’arrivée du père Jozé, confesseur de dona Clara et de dona Isidora sa fille. Il ne tarda pas à se présenter. C’était un homme d’une figure imposante, monté sur une mule majestueuse. À la première vue ses traits portaient l’empreinte d’une profonde méditation ; mais quand on l’examinait de plus près, ces traces semblaient plutôt le résultat de sa conformation physique que d’un exercice intellectuel. Le lit était tracé, mais les eaux n’y avaient point été dirigées. En attendant, bien que son éducation eût été défectueuse et que son esprit fût un peu resserré, le père Jozé était un honnête homme, dont les intentions étaient pures. Il aimait le pouvoir et il était dévoué aux intérêts de l’Église, mais il frémissait quand il entendait parler des flammes d’un auto-da-fé.
Le dîner était terminé ; les plus beaux fruits et les vins les plus recherchés venaient d’être placés devant le père Jozé, quand dona Isidora, après une profonde révérence à sa mère et à l’ecclésiastique se retira, selon sa coutume dans son appartement.
— C’est l’heure de la sieste, observa le père Jozé.
— Non, mon père, non, dit dona Clara d’un air triste, sa femme de chambre m’assure qu’elle ne se retire pas pour dormir. Elle s’est, hélas ! trop bien accoutumée à l’ardeur du climat où elle fut perdue dans son enfance, pour sentir la chaleur comme nous. Non, elle ne se retire ni pour dormir, ni pour prier, selon la pieuse coutume des dames espagnoles. Je crains que ce ne soit pour…
— Pour quoi ?… interrompit le prêtre avec effroi.
— Pour réfléchir, pour penser ; car j’ai souvent observé, à son retour, des traces de larmes sur sa figure. Je tremble, mon père, qu’elle ne regrette ce pays d’idolâtres, ce domaine de Satan, où elle a passé sa jeunesse.
Le bon ecclésiastique demanda à sa dévote pénitente quelques détails sur la manière d’être d’Isidora, sur ses discours, ses amusements et ses occupations. Dona Clara lui donna tous ceux qu’elle avait pu recueillir, entremêlant son discours d’exclamations continuelles sur la crainte que lui inspirait le salut de sa fille. Le père s’efforça de la tranquilliser, il promit d’entretenir la jeune personne, de lui imposer quelques légères pénitences pour occuper son esprit, et assura dona Clara que, confiée à ses soins et à sa direction, elle ne pouvait courir aucun danger. Quand cette conversation importante fut terminée, le père Jozé ajouta :
— Et maintenant, ma fille, quand votre fils don Fernand, qui sans doute ne se livre pas comme sa sœur à la réflexion, aura achevé sa sieste, veuillez lui faire dire que je suis prêt à continuer la partie d’échecs que nous avons commencée il y a quatre mois. J’avais poussé mon pion jusqu’à l’avant-dernière case, il ne me fallait plus qu’un coup pour arriver à dame.
— La partie a-t-elle donc duré si longtemps ? dit dona Clara.
— Si longtemps ! s’écria l’ecclésiastique, elle aurait pu durer bien plus longtemps encore : nous n’avons guère joué que trois heures par jour l’un portant l’autre.
La soirée se passa dans un profond silence de la part de tout le monde. Le père et don Fernand faisaient la partie d’échecs ; dona Clara travaillait à sa tapisserie et dona Isidora, assise à la fenêtre ouverte, contemplait l’éclat de la lune, respirait le parfum de la tubéreuse et guettait l’épanouissement de la belle de nuit. Ces objets lui rappelaient tous les charmes que la nature avait répandus jadis sur son existence. L’azur foncé du ciel et la lumière brillante de la planète, qui y régnait en souveraine, auraient pu faire lutter la beauté de cette nuit avec l’éclat incomparable de celles des Tropiques. Un songe délicieux la ramenait par moments à l’île enchantée dont elle avait été si longtemps la reine et la divinité. Une seule image y manquait : une image, dont l’absence changeait également en un désert ce paradis insulaire et tous les charmes d’un jardin espagnol éclairé par le plus beau clair de lune. Cette image, elle ne pouvait espérer de la rencontrer que dans son cœur. Ce n’était que dans la solitude la plus profonde qu’elle osait parfois se répéter à elle-même et son nom et ces airs pittoresques de son pays qu’il lui avait appris à chanter dans les moments où son humeur prenait une teinte de douceur. Le contraste entre sa vie passée et présente était si grand ; elle se sentait tellement vaincue par la contrainte et la froideur ; on lui avait si souvent répété que tout ce qu’elle faisait, disait ou pensait, était mal, qu’elle commençait à renoncer au témoignage de ses sens, et qu’elle se persuadait que les visites de l’étranger n’avaient été que des visions qui avaient répandu à la fois le trouble et la joie sur une existence tout à fait illusoire.
— Je suis surpris, ma sœur, dit don Fernand qui était de très mauvaise humeur de la tournure défavorable que la partie avait prise pour lui, je suis fort surpris que vous ne vous occupiez jamais, comme tant de jeunes filles, à travailler à l’aiguille ou bien à faire quelques autres ouvrages féminins.
— Ou bien à lire quelques livres de piété, dit dona Clara, en levant pour un moment ses yeux de sa tapisserie et les y laissant retomber sur-le-champ. Il y a la légende de ce saint Polonais né comme vous dans une terre de ténèbres… il s’appelait… révérend père, j’ai oublié son nom.
— Échec au roi, dit le père.
— Vous ne songez qu’à cultiver quelques fleurs, à jouer du luth ou à regarder la lune, continua don Fernand, vexé du succès de son adversaire et du silence de dona Isidora.
— Elle fait beaucoup d’aumônes et de grandes œuvres de charité, dit le bon prêtre. J’ai été appelé dernièrement dans une misérable chaumière, non loin de votre château, dona Clara, pour visiter un pêcheur mourant sur la paille. Je ne faisais que remplir mon devoir ; mais votre fille y était avant moi. Elle s’y était rendue sans qu’on l’y eût appelée et je l’entendis prononcer les consolations les plus tendres et les plus éloquentes… que, par parenthèse, elle avait tirées d’une homélie manuscrite qu’un pauvre prêtre, que je ne nommerai pas, lui avait prêtée.
Isidora rougit à cette petite preuve de vanité, tandis que les taquineries de don Fernand et la froide austérité de sa mère la faisaient alternativement sourire et pleurer.
— Oui, continua le père Jozé, j’entendis tout cela comme je vous le dis, en entrant dans la chaumière, et, je vous le jure par l’habit que je porte, je m’arrêtai avec délices sur le seuil. Ses premiers mots furent… Échec et mat !
Dans son triomphe, le bon père avait oublié jusqu’à son homélie et il s’arrêta, montrant du doigt l’état désespéré du jeu de son adversaire.
— Échec et mat ! répéta dona Clara, sans lever les yeux de dessus son ouvrage.
Avant que le père Jozé pût lui expliquer que cette exclamation n’avait aucun rapport avec l’acte de charité de sa fille, un cri que celle-ci jeta, répandit l’alarme dans le salon. Tout le monde s’empressa autour d’elle ; il s’y joignit quatre femmes de chambre et deux pages. Dona Isidora n’avait pas perdu connaissance. Elle se tenait au milieu de tout ce monde, pâle comme la mort ; muette, ses yeux erraient sur le groupe qui l’environnait, sans en distinguer un seul individu. Elle conservait cependant cette présence d’esprit qui n’abandonne jamais une femme quand il s’agit de garder son secret et elle n’indiquait ni du doigt ni de l’œil la fenêtre où l’objet de sa frayeur s’était présenté. Pressée de mille questions, elle paraissait incapable d’y répondre et refusant toute assistance elle s’appuya sur la croisée pour se soutenir.
Dona Clara s’avançait d’un pas mesuré pour présenter à sa fille un flacon d’essence qu’elle portait toujours dans sa poche, quand une des femmes de chambre qui connaissait les goûts de sa jeune maîtresse, proposa de la ranimer par l’odeur des fleurs. Elle s’empressa donc de cueillir une poignée de roses et les présenta à dona Isidora. La vue et le parfum de ces fleurs magnifiques rappela mille souvenirs du temps passé à l’esprit de l’infortunée. Elle fit un signe de la main pour qu’on les ôtât, et s’écria :
— Il n’y a point ici de roses semblables à celles qui m’entouraient quand il m’aperçut pour la première fois.
— Lui ! qui, ma fille ? dit dona Clara, au comble de l’effroi.
— Expliquez-vous, ma sœur, je vous l’ordonne, dit le fougueux don Fernand. De qui parlez-vous ?
— Elle est dans le délire, dit le prêtre à qui sa pénétration habituelle avait fait découvrir qu’il existait un secret dans cette aventure. Elle est dans le délire, et vous avez tort de l’entourer ainsi, et de la questionner si vivement. Mademoiselle, allez vous reposer, et que les saints veillent sur votre sommeil.
Isidora salua l’ecclésiastique en signe de reconnaissance, et rentra dans son appartement. Le père Jozé resta pendant plus d’une heure avec dona Clara et son fils, pour combattre les craintes de l’une et la sombre susceptibilité de l’autre. Il espérait que leurs discours lui procureraient quelque éclaircissement sur un mystère qu’il voulait dévoiler. Au désir de rendre service à dona Isidora, qui était son véritable motif, se joignait peut-être même à son insu, celui d’augmenter son pouvoir dans la famille par la connaissance de tous ses secrets. Dans le cours de la conversation, il glissa quelques mots pour savoir si dona Clara ne serait pas disposée à consacrer sa fille au service de Dieu. La pieuse mère trouva ce projet merveilleux ; il n’en fut pas de même du frère qui, pour les motifs déjà indiqués, le combattit fortement. N’étant point parvenu à convaincre dona Clara ni le confesseur, il exigea de celui-ci qu’il n’en fût plus question jusqu’au retour de son père, ce qui lui fut accordé sans peine.
Dona Clara passa en prières la plus grande partie de la nuit, et ne se coucha que quand le zéphyr frais du matin lui permit d’espérer un peu de repos.
Isidora ne dormait pas davantage. Ainsi que sa mère, elle s’était prosternée devant l’image sacrée de la Vierge, mais avec des pensées bien différentes. Son existence, qui se composait de contrastes perpétuels entre les objets présents et les souvenirs du passé, la différence entre ce qu’elle voyait et ce qu’elle sentait, entre la vie pleine de sensations que lui offrait sa mémoire, et celle trop monotone qu’elle coulait, tout cela surpassait les forces d’un cœur trop plein d’une sensibilité que rien ne dirigeait, et d’une tête étourdie par des vicissitudes auxquelles même un esprit plus fort que le sien n’aurait pu résister.
Après avoir répété les prières habituelles qu’elle adressait à la Mère du Sauveur, elle sentit le besoin d’épancher son cœur devant elle, et elle commença à l’implorer en des discours dictés par ses seuls sentiments.
— Être doux et céleste, s’écria-t-elle en s’agenouillant devant l’image, vous qui seule n’avez cessé de me sourire depuis mon arrivée dans votre terre chrétienne, vous dont j’ai cru parfois que la physionomie représentait celle des êtres qui demeuraient dans les étoiles de mon ciel indien, écoutez-moi et ne soyez pas en courroux. Souffrez que je perde tout sentiment de mon existence présente, ou bien tout souvenir de celle qui est passée. Pourquoi ces pensées reviennent-elles me poursuivre ? Elles faisaient jadis mon bonheur ; maintenant elles me percent le cœur. Pourquoi conservent-elles leur pouvoir, puisque leur nature est changée ? Je ne puis plus redevenir ce que j’étais : laissez-moi donc l’oublier. Laissez-moi, s’il est possible, voir, sentir et penser comme ceux qui m’entourent. Je sens qu’il est plus facile de descendre jusqu’à eux, que de les élever jusqu’à moi. Non, Mère de Dieu ! femme divine et mystérieuse ! ils ne seront plus témoins des émotions de mon cœur brûlant. Il se consumera dans sa propre flamme, avant que leur froide compassion contribue à l’éteindre ! Ô Mère divine ; un cœur brûlant n’est-il pas la plus digne offrande que je puisse vous présenter ? L’amour de la nature ne s’assimile-t-il pas à l’amour de Dieu ? Nous pouvons, à la vérité, aimer sans religion, mais nous ne pouvons avoir de la religion sans aimer. Pourquoi faut-il que je pense, que je sente, puisque la vie n’exige que des devoirs qu’aucun sentiment n’inspire, qu’une apathie qu’aucune réflexion ne trouble ? Oui, oui, aidez-moi à bannir de mon âme toute autre image que la sienne. Que mon cœur soit comme cet appartement solitaire, éclaire par cette lumière seule que l’amour a placée devant l’objet de son adoration, et qui seule y brûle à jamais.
Dona Isidora, dont l’enthousiasme était monté au plus haut point, restait à genoux devant l’image de la Vierge, et quand elle se leva, le silence qui régnait dans sa chambre, et le sourire calme qui brillait sur les traits de cette figure céleste, semblèrent lui reprocher l’excès de sensibilité auquel elle s’était livrée. Ce sourire paraissait une marque de courroux. Il est certain que quand nous sommes très émus, nous ne trouvons point de consolation à contempler des traits qui n’expriment qu’une tranquillité profonde. Nous aimerions mieux une émotion aussi forte que la nôtre, fût-elle même dans un sens opposé. Tout nous paraît préférable à un calme qui nous absorbe et nous neutralise. C’est la réponse du rocher à la vague, qui se brise en écumant contre son pied, sans qu’il en ressente le moindre ébranlement.
Telles étaient les sensations d’Isidora, qui s’appuya sur sa croisée, pour tâcher de respirer un souffle d’air, que l’atmosphère brûlante lui refusait. Elle songeait que pendant une pareille nuit, dans son île indienne, elle se serait plongée dans le ruisseau qu’ombrageait son tamarin chéri ; peut-être même se serait-elle risquée dans les flots tranquilles et argentés de l’Océan ; mais alors, elle venait d’achever la cérémonie du bain : car elle pouvait, avec raison, appeler une cérémonie, ce qui avait autrefois été un plaisir enchanteur. Les savons, les parfums, les éponges, et surtout les secours des femmes qui la servaient, lui avaient donné de la répugnance pour ce qui jadis lui avait paru si délicieux. Ni le bain, ni la prière n’avaient calmé ses sens agités. Elle chercha de l’air à sa croisée, et le chercha vainement. La lune brillait au haut des cieux avec autant d’éclat que le soleil dans des climats plus froids. En comparant la beauté du ciel avec la triste uniformité des parterres et des bosquets peignés qui s’étendaient à ses pieds, Isidora pleura. Les larmes étaient devenues son langage chaque fois qu’elle était seule ; elle n’osait s’en servir en présence de sa famille. Tout à coup elle vit une des allées, que la lune éclairait, obscurcie par l’approche d’une figure humaine. Elle s’avança ; elle prononça son nom, ce nom qu’elle reconnaissait et qu’elle aimait, celui d’Immalie !
— Ah ! s’écria-t-elle, en mettant la tête hors de la fenêtre, y a-t-il encore quelqu’un qui me connaisse sous ce nom ?
— C’est le seul sous lequel je puis vous adresser la parole, répondit une voix qui était celle de l’étranger. Je n’ai pas encore l’honneur de connaître celui que vos amis chrétiens vous ont donné.
— Ils me nomment Isidora ; mais continuez toujours à m’appeler Immalie.
Tout à coup, tremblante pour la sûreté de l’étranger, et sa crainte surmontant sa joie innocente et pure, elle ajouta :
— Mais comment se fait-il que vous soyez ici, dans ce lieu où il n’entre jamais personne que les habitants de la maison ? Comment avez-vous fait pour passer par-dessus le mur du jardin ? Comment êtes-vous venu des Indes ? De grâce, retirez-vous, votre sûreté en dépend. Je suis entourée de personnes auxquelles je ne puis me fier et que je ne puis aimer. Ma mère est sévère ; mon frère est violent. Oh ! comment êtes-vous entré dans le jardin ? Comment avez-vous pu courir de si grands risques pour voir une personne que vous aviez depuis si longtemps oubliée ?
Elle prononça ces derniers mots à voix basse. L’étranger répondit avec un air moqueur et plein de malignité.
— Belle néophyte, charmante chrétienne, sachez que les verroux, les barreaux et les murailles ne m’embarrassent pas plus que les rochers et les brisants de votre île indienne. Je puis aller où je veux et me retirer à mon gré, sans demander la permission aux chiens de basse-cour de votre frère ou à ses pièges ; je me moque également de l’avant-garde de duègnes de votre mère, armées de leurs lunettes et flanquées d’un double rang de batteries de rosaires avec des grains aussi gros que…
— Chut, chut ! Ne prononcez pas ces mots impies ; on m’a appris à respecter ces objets sacrés. Mais est-ce bien vous ? Était-ce encore vous que j’ai vu hier au soir, ou bien n’était-ce qu’une de ces visions que m’offrent parfois mes songes quand je m’imagine être encore dans l’île bienheureuse où pour la première fois… Oh ! pourquoi vous ai-je jamais vu ?
— Aimable chrétienne, accoutumez-vous à votre affreuse destinée. Vous m’avez en effet vu hier au soir. Deux fois j’ai visité la route où vous brilliez, la plus éclatante et la plus belle de tout Madrid. C’est moi que vous avez vu ; j’ai fixé votre œil ; j’ai percé votre sein léger comme l’aurait fait un éclair ; vous tombâtes flétrie et sans connaissance sous mon regard brûlant. Oui, c’est moi que vous avez vu, moi, qui déjà avait troublé votre angélique existence dans ce paradis insulaire, moi qui vous poursuis même au sein de l’existence factice que vous avez embrassée.
— Que j’ai embrassée !… Oh non : ils m’ont saisie, entraînée ici ; ils m’ont dit que c’était pour mon bonheur présent et à venir.
— Je le crois bien ; et n’êtes-vous pas heureuse ? Votre corps délicat n’est plus exposé à l’intempérie des éléments. Votre goût si raffiné est flatté par mille inventions nouvelles ; votre lit est de duvet ; votre chambre est tendue en tapisserie. Que la lune soit brillante ou obscure, des bougies n’en brûlent pas moins toute la nuit dans votre appartement. Que le ciel soit serein ou couvert de nuages, que la terre soit émaillée de fleurs ou désolée par la tempête, l’art du peintre vous a fourni un nouveau ciel et une nouvelle terre ; et vous pouvez vous réchauffer aux feux d’un soleil qui ne se couche jamais, tandis que le ciel est sombre aux yeux des autres ; ou errer au milieu des paysages et des fleurs, tandis que la moitié de vos semblables périssent au sein des neiges et des ouragans. Vous avez ensuite des êtres raisonnables avec qui vous pouvez causer, au lieu de vos loxias et de vos singes.
— La conversation que j’ai trouvée ici ne m’a pas paru beaucoup plus intelligente ou plus instructive que la leur, dit Isidora à demi-voix.
L’étranger sans faire semblant de l’entendre, continua :
— Vous êtes environnée de tout ce qui peut flatter les sens, enivrer l’imagination ou délecter le cœur. Tous ces plaisirs doivent vous faire oublier la liberté voluptueuse, mais inculte, de votre ancienne existence.
— Les oiseaux dans les cages de ma mère, dit Isidora, ne cessent de becqueter leurs barreaux dorés ; ils foulent aux pieds les semences et l’eau limpide qu’on leur apporte. N’aimeraient-ils pas mieux reposer dans le tronc d’un vieux chêne, et prendre une nourriture plus grossière, plutôt que de se briser le bec contre leur prison magnifique ?
— Vous ne trouvez donc pas que cette nouvelle existence dans ce pays chrétien soit aussi délicieuse que vous vous l’étiez une fois imaginée ? Vous devriez rougir, Immalie, de votre ingratitude et de votre caprice. Vous rappelez-vous quand de votre île indienne, vous entrevîtes de loin le culte chrétien, que cet aspect vous mit dans l’enchantement ?
— Je me rappelle parfaitement tout ce qui s’est passé dans cette île. Jadis je vivais dans l’avenir ; maintenant je vis dans le passé.
— Vous ne vous trouvez donc point heureuse dans ce nouveau monde d’intelligence et de luxe ? dit Melmoth avec une douceur involontaire.
— Oui, quelquefois.
— À quelle occasion ?
— À la fin d’une triste et pénible journée, quand mes songes me ramènent vers cette île enchantée. Le sommeil est pour moi comme une barque, conduite par des rameurs imaginaires, et qui me pousse vers des bords charmants et bienheureux. C’est alors que j’existe de nouveau au milieu des fleurs et des parfums. J’entends la musique des airs et des ruisseaux. Tout vit et tout aime autour de moi. Mes pas sont jonchés de fleurs, et l’onde pure vient encore baiser mes pieds !
— Et dans vos songes, Immalie, ne voyez-vous jamais d’autres images ?
— Je n’ai pas besoin de vous dire, répondit Isidora avec ce singulier mélange de fermeté et de naïveté, résultat de son caractère et des circonstances extraordinaires de sa première existence, je n’ai pas besoin de vous dire que vous êtes avec moi toutes les nuits.
— Moi !
— Oui, vous. Vous êtes toujours dans ce canot qui me porte dans mon île indienne. Vous me regardez ; mais l’expression de votre figure est si changée, que je n’ose vous adresser la parole. Nous traversons les mers dans un instant. Vous tenez toujours le gouvernail, quoique vous ne débarquiez jamais. Aussitôt que mon île se montre à ma vue, vous disparaissez. Quand nous revenons, l’obscurité règne sur l’Océan, et notre course est aussi ténébreuse et aussi prompte que la tempête. Vous me regardez et vous ne parlez jamais. Oh ! oui ! vous êtes avec moi toutes les nuits.
— Mais, Immalie, ce ne sont que des songes, de vaines illusions. Qui ? moi ! vous conduire sur les mers d’Espagne jusqu’aux Indes ! Ce ne sont là que des visions de votre imagination !
— Est-ce donc encore un songe qui m’abuse à présent ? N’est-ce pas à vous que je parle ? Expliquez-vous ; car il me paraît non moins étrange de vous voir en Espagne que d’être dans mon île. Hélas ! dans la vie que je mène à présent, mes songes sont devenus des réalités et les réalités semblent n’être que des songes. Si vous êtes réellement ici, comment se fait-il que vous y soyez ? Comment avez-vous fait pour venir me voir de si loin ? Combien vous avez dû traverser d’océans, combien vous avez dû voir d’îles sans qu’il y en eût aucune de semblable à celle où je vous vis pour la première fois ! Mais est-ce vraiment vous que je vois ? Je croyais vous avoir vu hier au soir ; mais j’aime encore mieux m’en fier à mes songes qu’à mes sens. Je croyais que vous ne visitiez jamais que cette île d’illusions ; seriez-vous réellement un être vivant, un être que je puis espérer de voir dans cette terre de froides réalités ?
— Belle Immalie ou Isidora, ou quelque nom que vos adorateurs indiens ou vos parrains chrétiens vous ont donné, je vous prie de m’écouter, pendant que je vous dévoile quelques mystères.
Et parlant ainsi, Melmoth se jeta sur un lit de jacinthes et tulipes qui déployaient leurs brillantes couleurs et exhalaient leurs parfums délicieux sous la fenêtre d’Isidora.
— Oh ! vous allez détruire mes fleurs, s’écria-t-elle, se rappelant tout à coup les moments heureux où des fleurs étaient à la fois les compagnes de son imagination et de son cœur.
— Je vous prie de me pardonner ; c’est ma vocation, dit Melmoth en se roulant sur les fleurs écrasées et en lançant à Isidora un de ses regards sombres et effrayants. Je suis envoyé pour fouler aux pieds toutes les fleurs du monde physique et moral, n’importe que ce soient des jacinthes, des cœurs ou d’autres bagatelles de ce genre. Et maintenant, dona Isidora, puisqu’il faut vous appeler ainsi, je suis ce soir ici ; demain, je serai… où votre choix m’aura placé. Je vous préviens d’avance que cela m’est égal, soit que vous m’envoyiez aux mers de l’Inde, où vos songes m’ont déjà si souvent expédié, ou bien qu’il me faille briser la glace du pôle, ou bien enfin que je sillonne les flots de cet Océan qu’un jour, jour affreux, qui n’aura ni soleil ni lune, ni commencement ni fin, il me faudra sillonner à jamais pour ne recueillir que le désespoir !
— Paix ! paix ! ne prononcez pas des mots aussi horribles ! Est-ce vous en effet que j’ai vu dans l’île ? Est-ce vous qui depuis ce moment avez fait partie de mes prières, de mes espérances, de mon cœur ? Êtes-vous cet être sur qui je fondais encore mon espoir quand la vie était sur le point de me manquer ? Dans ma traversée pour me rendre à cette terre chrétienne, j’ai beaucoup souffert. J’étais si malade que vous auriez eu pitié de moi. Oh ! vous seul, votre pensée, votre image pouvait me soutenir ! J’aimais, et quand on aime on vit. Privée de cette existence délicieuse qui me parut un songe et qui remplit encore mes songes, en faisant de mon sommeil une seconde existence, j’ai pensé à vous, j’ai rêvé de vous, je n’ai aimé que vous !
— M’aimer !… aucun être ne m’a encore prouvé son amour que par des larmes !
— Et n’en ai-je pas versé ? dit Isidora, croyez-en celles-ci, elles ne sont pas les premières que j’ai répandues, et je crains bien, grâce à vous, qu’elles ne soient pas non plus les dernières.
— En vérité, vous finiriez par m’inspirer de la fatuité, dit le voyageur avec un rire sardonique. Soit : je le veux bien et quand viendra le jour trop heureux, belle Immalie, toujours belle Isidora, en dépit de votre nom chrétien que j’ai bien de la peine à prononcer, ce jour où vous vous réveillerez au milieu des baisers, des rayons de la lumière, de l’amour et de tous les vains ornements dont la folie couvre le malheur avant leur union ?
Il accompagna ce discours de ce rire affreux et convulsif qui unit l’expression de la frivolité à celle du désespoir. La pauvre et timide Isidora lui répondit :
— Je ne vous comprends pas ; et si vous ne voulez pas me priver de ma raison, ne riez plus, ou du moins ne riez plus ainsi.
— Il faut bien que je rie, puisque je ne saurais pleurer, dit Melmoth en fixant sur elle ses yeux secs et brûlants, que le clair de lune rendait plus visibles. Il y a longtemps que la source des larmes est tarie en moi, comme celle de tout autre bonheur humain.
— Je saurai pleurer pour nous deux, dit Isidora, et ses larmes coulaient autant de souvenir que de douleur ; quand ces deux sources s’unissent, Dieu seul et le malheureux savent s’ils coulent en abondance.
— Gardez ces pleurs pour notre heure nuptiale, mon aimable fiancée, dit Melmoth en lui-même, vous n’en aurez pas trop.
Cédant à un sentiment naturel au cœur des femmes, Isidora, d’une voix mal assurée, lui dit :
— Si vous m’aimez, ne me recherchez plus en secret ; ma mère, quoique sévère, est bonne ; mon frère est généreux, quoique susceptible… mon père… je ne l’ai jamais vu ; mais puisqu’il est mon père, il faudra qu’il vous aime. Que je vous retrouve en leur présence, le plaisir que j’éprouve en vous voyant ne sera plus mêlé de douleur et de honte. Invoquez la sanction de l’Église, et alors, peut-être…
— Peut-être ! reprit Melmoth. Vous avez donc déjà appris le peut-être européen ; cet art de suspendre le sens d’un mot significatif, d’affecter de la franchise, au moment où l’on cache de plus en plus les replis de son cœur, de nous mettre au désespoir, au moment où l’on veut que nous espérions !
— Oh non, non ! s’écria l’innocente créature, je suis toute vérité. Je suis Immalie quand je vous parle, quoique pour tout autre, dans ce pays, je sois Isidora. Quand je vous aimai pour la première fois, je n’avais qu’un cœur à consulter ; maintenant il y en a plusieurs, et dans le nombre il y en a bien peu qui ressemblent au mien. Mais si vous m’aimez, vous pourrez vous plier à eux comme je l’ai fait ; vous pourrez aimer leur Dieu, leurs foyers, leurs espérances et leur pays. Même avec vous je ne saurais être heureuse, si vous n’adorez la croix que votre main indiqua la première à ma vue errante, et cette religion que vous confessâtes à regret être la plus belle et la plus bienfaisante de la terre.
— Ai-je confessé cela ? répéta Melmoth, il faut vraiment que je l’aie fait à regret. Belle Immalie, ajouta-t-il en étouffant un rire satirique, vous m’avez converti à votre nouvelle religion, à votre beauté, à votre naissance espagnole, à vos noms ronflants, à tout ce que vous pouvez désirer. Je me présenterai incontinent devant votre pieuse mère, devant votre frère irrité, et devant tous vos parents, quelque susceptibles, fiers ou ridicules qu’ils puissent être. Je leur parlerai, je les flatterai, et quand ils me renverront à votre homme de loi avec ses larges moustaches et son manteau de velours noir râpé, je vous assignerai pour douaire, le plus ample territoire que jamais épouse ait reçu de son époux.
— Oh ! puisse-t-il être situé dans cette terre harmonieuse et brillante où je vous ai vu pour la première fois ! Un seul endroit pour placer mes pieds au milieu de ses fleurs, me serait plus précieux que toute la terre cultivée de l’Europe.
— Non, ce sera dans une région que ces hommes de loi connaissent bien mieux, et à laquelle votre pieuse mère et votre orgueilleuse famille reconnaîtront elles-mêmes mes droits quand je les leur aurai expliqués. Il se peut que d’autres y possèdent des droits indivis avec moi ; et cependant, chose étrange à dire ! ils ne me disputeront jamais mon titre exclusif à sa possession.
— Je ne comprends rien à tout cela, dit Isidora ; mais je sens que je manque aux bienséances imposées à une femme espagnole et chrétienne en causant plus longtemps avec vous. Si vous pensez comme vous faisiez jadis ; si vous sentez comme je dois sentir à jamais, toute cette discussion, qui m’embarrasse et m’effraye, devient inutile. Qu’ai-je à faire de ce territoire dont vous me parlez ? si vous en êtes le possesseur, c’est là son seul prix à mes yeux.
— Ce que vous y avez à faire ! répéta Melmoth. Oh ! vous ne savez pas encore tout ce que vous pouvez avoir à faire avec ce territoire et avec moi ! Par moi, vous vous en assurez l’éternelle possession. Mes héritiers en jouiront aux siècles des siècles, pourvu qu’ils le tiennent au même titre que moi. Écoutez-moi, belle Immalie, ou chrétienne, ou tout autre nom qu’il vous plaira d’adopter, écoutez-moi, pendant que je vous annonce la richesse, la population et la magnificence de cette région dont je veux vous faire le don nuptial. Là, se trouvent tous les chefs de la terre : les héros, les souverains, les tyrans. Là, sont leurs richesses, leur pompe et leur pouvoir. Quelle superbe accumulation ! Ils y ont des trônes et des couronnes, et des piédestaux et des trophées de feu, qui brûlent aux siècles des siècles, et l’éclat de leur gloire y brille éternellement. Là, sont tous ceux dont vous avez lu l’histoire, vos Alexandres, vos Césars, vos Ptolémées et vos pharaons. Là sont les princes de l’Orient, les Nemrods, les Baltasars et les Holophernes de leurs siècles. Là sont les princes du Nord, les Odins, les Attilas, les Alarics, tous ces barbares sans nom, et qui n’en méritent pas, lesquels, sous des titres et des prétextes différents, ont ravagé et désolé la terre qu’ils venaient conquérir. Là, enfin, se trouvent les souverains du Midi, de l’Orient et de l’Occident, les descendants de Mahomet, les califes, les Sarrasins, les Maures avec leurs titres pompeux, leurs prétentions et leurs ornements, le croissant, le Koran et la queue de cheval. Oh ! vous ne manquerez pas de société dans cette brillante région : car elle sera véritablement brillante, et qu’importe que sa lumière provienne du soufre enflammé ou des rayons tremblants de la lune qui vous font paraître si pâle en ce moment ?
— Je suis pâle, dites-vous, répondit Isidora, respirant avec peine, je ne m’en étonne pas. Je ne comprends pas le sens de vos paroles ; mais ce sens doit être horrible : ne me parlez plus de cette région avec son orgueil, ses vices et sa splendeur ! Je suis prête à vous suivre dans des déserts, dans des solitudes qu’aucun pied n’aura foulées que le vôtre, et où le mien, toujours fidèle, suivra la trace de vos pas. Je suis née dans la solitude, et je saurai, s’il le faut, y mourir ; pourvu qu’en quelque lieu que je vive, à quelque époque que je meure, je sois à vous. Pour le lieu, il ne m’importe guère, quand même ce serait !…
Elle frémit involontairement.
— Quand même ce serait… Où ? demanda Melmoth qui éprouvait à la fois un triomphe sauvage à la vue du dévouement de cette infortunée, et un sentiment d’horreur à la destinée qu’elle allait, par ses imprécations, attirer sur elle-même.
— Partout où vous serez, répondit Isidora. Là, je veux être, et là je serai heureuse comme dans l’île des fleurs et du soleil où je vous vis pour la première fois. Oh ! je ne vois plus de fleurs aussi belles et aussi odorantes que celles qui y croissaient ; je n’entends plus la musique de ses ruisseaux et de ses zéphyrs qui me semblaient répéter le son de vos pas !…
— Vous entendrez une musique bien plus parfaite, interrompit Melmoth : vous entendrez les voix de dix mille, que dis-je ? de dix millions d’esprits, dont les tons sont éternels, sans pauses et sans intervalles.
— Ce sera vraiment beau, s’écria Isidora en joignant les mains. Le seul langage que j’aie appris dans ce nouveau monde, et qui mérite qu’on le parle, est le langage de la musique. J’en avais distingué quelques sons imparfaits dans le gazouillement des oiseaux de mon ancien monde ; mais c’est dans celui-ci qu’on me l’apprit véritablement. Le malheur, que j’ai en même temps appris à connaître, balance à peine ce nouvel et délicieux langage.
— Mais songez, reprit Melmoth, si vous avez réellement tant de goût pour la musique, combien vous aurez de jouissances quand vous entendrez ces accents accompagnés et répétés par les torrents de dix mille flots de feu battant contre les rochers auxquels le désespoir éternel a donné la dureté du diamant ! On parle de la musique des sphères ! pensez plutôt à celle de ces orbes vivants, tournant éternellement sur leurs axes de feu, et chantant éternellement pendant qu’ils brûlent, comme ces chrétiens, vos frères, qui servirent à illuminer les jardins de Néron, dans Rome, pendant une nuit de réjouissances.
— Vous me faites trembler !
— Trembler, parce qu’on vous parle de feu ! quelle étrange timidité ! Je vous ai promis que, quand vous arriveriez dans vos nouveaux domaines, vous y trouveriez tout ce qu’il y a de plus grand et de plus magnifique, de plus splendide et de plus voluptueux : le monarque et l’épicurien, un lit de roses et un dais de feu.
— Et c’est là la demeure à laquelle vous m’invitez ?
— Oui, c’est elle ; venez et soyez à moi. Des milliers de voix vous y appellent : écoutez et obéissez-leur ! Ces voix retentissent toutes dans la mienne. Leurs feux brillent dans mes yeux, et brûlent dans mon cœur. Écoutez-moi, Isidora ; ma bien-aimée, écoutez-moi. C’est sincèrement et pour jamais que je vous recherche. Oh ! qu’ils sont frivoles les liens qui unissent des amants mortels, comparés à ceux qui nous uniront tous deux dans l’éternité ! Vous aimez la musique : là, vous entendrez sans doute la plupart des musiciens qui ont existé, depuis Tubalcaïn jusqu’à Lulli. Leur accompagnement sera singulier : ce sera le rugissement éternel d’une mer de feu, formant une basse continue aux chants de millions de chanteurs souffrants !
— Que voulez-vous dire par cette horrible description ? demanda la tremblante Isidora ; vos paroles sont des énigmes pour moi : je ne vous comprends pas.
— Vous ne me comprenez pas ! répéta Melmoth avec un air froidement satirique qui contrastait effroyablement avec la brûlante intelligence qui brillait dans ses yeux ; vous ne me comprenez pas ! N’aimez-vous donc pas la musique ?
— Je l’aime.
— Aimez-vous aussi la danse, ma belle, ma gracieuse amante ?
— Je l’aimais.
— Pourquoi cette différence dans vos réponses ?
— J’aime la musique ; je dois l’aimer à jamais : elle est pour moi le langage du souvenir. Chaque son que j’entends me ramène avec ma chère île : je ne saurais en dire autant de la danse. J’ai appris la danse ; mais j’ai senti la musique. Je n’oublierai jamais la première fois que je l’entendis : je crus que c’était le langage que les chrétiens parlaient toujours entre eux.
— Ces raisons sont assez bonnes ; mais je voudrais savoir si vous n’en avez pas encore d’autres pour aimer la musique, et pour avoir aimé la danse. Si vous en avez, dites-les-moi, de grâce.
— J’aime la musique, parce qu’en l’entendant je pense à vous. J’ai cessé d’aimer la danse, quoiqu’elle m’eût d’abord ravie, parce qu’en dansant il m’est arrivé quelquefois de vous oublier. En votre présence, quoiqu’elle paraisse nécessaire à mon existence, je n’ai jamais éprouvé cette sensation délicieuse que me cause votre image quand la musique l’évoque du fond de mon cœur. La musique me paraît être la voix de la religion qui m’ordonne de me rappeler et d’adorer le Dieu de mon cœur. La danse me semble une apostasie momentanée, et presque une profanation.
— Ces raisons sont subtiles, j’en conviens, dit Melmoth, je n’y trouve qu’un défaut ; c’est de n’être pas assez flatteuses pour celui qui les écoute… mais n’importe la danse ou la musique ! il paraît que mon image est également pernicieuse dans l’une et dans l’autre. Celle-ci vous tourmente par des souvenirs ; celle-là par des remords. Mais je suppose que cette image vous soit retirée à jamais ; je suppose qu’il fût possible de rompre le lien qui nous unit et dont l’illusion a pénétré jusque dans l’âme de tous deux…
— Vous pouvez le supposer, dit Isidora, avec un mélange de fierté virginale et de tendre douleur ; et si vous le faites, vous pouvez croire que j’y ferai aussi mon possible de mon côté. L’effort ne me coûtera pas beaucoup… rien que… ma vie !
Melmoth contemplait cette belle et innocente créature, jadis si cultivée au sein de la nature, maintenant si naturelle encore au milieu de la civilisation, et conservant toute la douce richesse de sa première nature angélique, dans l’atmosphère artificielle où nul n’appréciait ni son parfum ni son éclat. Melmoth la contemplait, il sentait son prix et se maudissait lui-même. Puis avec cet égoïsme, compagnon d’un malheur sans espoir, il crut que cette malédiction serait affaiblie en se partageant ; et s’approchant de la fenêtre devant laquelle se tenait sa victime pâle et toujours belle, il lui dit du ton le plus doux qu’il lui fut possible de prendre :
— Isidora ! voulez-vous donc être à moi ?
— Que vous répondrai-je ? dit Isidora. Si c’est l’amour qui m’interroge, j’en ai dit assez ; si ce n’est que la vanité, j’en ai dit beaucoup trop.
— La vanité ! hélas ! vous ne savez ce que vous dites ! L’ange accusateur lui-même n’osera mettre ce péché au nombre des miens. Il est impossible que je le commette jamais. C’est un sentiment terrestre. Je ne puis, par conséquent, y participer ni en jouir. Il n’en est pas moins vrai que dans ce moment je sens un peu d’orgueil humain.
En prononçant ces derniers mots, sa physionomie prit en effet une expression d’orgueil si effrayante, qu’Isidora ne put s’empêcher de frémir. Tremblante et remplie d’inquiétude, elle lui dit :
— Voulez-vous donc être à moi ? Ou bien que faut-il que je pense de vos horribles discours ? Hélas ! mon cœur ne s’est jamais enveloppé de mystère. Jamais l’éclat de sa vérité ne s’est montré au milieu des éclats et du tonnerre, du sein desquels vous avez prononcé l’arrêt de ma destinée.
— Voulez-vous donc être à moi, Isidora ?
— Consultez mes parents ; épousez-moi selon les rites et en face de l’Église, dont je suis un membre indigne, et je serai à vous pour toujours.
— Pour toujours ! s’écria Melmoth. C’est bien dit, mon épouse ! vous voulez donc être à moi pour toujours ?… Le voulez-vous, Isidora ?
— Oui… oui… je l’ai déjà dit… Mais le soleil est près de se lever. Je sens la fraîcheur de la matinée ; les orangers exhalent un parfum plus fort. Retirez-vous… Je suis restée trop longtemps… Les domestiques ne tarderont pas à se lever ; ils pourraient vous apercevoir… Retirez-vous, je vous en conjure.
— Je pars ; mais un seul mot encore. Pour moi, le lever du soleil, l’arrivée de vos domestiques, tout ce qui est dans les cieux au-dessus de ma tête ou sur la terre à mes pieds ; tout, vous dis-je, est également indifférent. Que le soleil reste sous l’horizon et m’attende. Vous êtes à moi !
— Oui, je suis à vous ; mais il faut que vous sollicitiez le consentement de ma famille.
— Oh ! sans doute. Pourquoi pas ? Je suis si accoutumé à la sollicitation.
— Et…
— Eh bien ! Quoi ? vous hésitez.
— J’hésite, dit l’ingénue et timide Isidora, parce que…
— Encore ?
— Parce que, ajouta-t-elle en fondant en larmes, ceux à qui vous parlerez ne prononceront pas le même langage que moi. Ils vous parleront de richesses et de douaire ; ils vous demanderont des détails sur cette région où vous m’avez dit qu’étaient situés ces riches et vastes domaines ; et, s’ils m’en parlaient la première, que faudra-t-il que je réponde ?
À ce discours, Melmoth s’approcha, le plus près qu’il lui fut possible, de la fenêtre, et prononça un mot que, dans le premier moment, Isidora ne parut pas avoir entendu ou compris. Tremblante, elle réitéra sa demande. La réponse fut donnée d’une voix plus basse encore. N’osant croire à ce qu’elle venait d’entendre, et se flattant que ses oreilles l’avaient trompée, elle répéta, pour la troisième fois, sa question. Cette fois un mot épouvantable, impossible à redire, tonna dans son oreille. Elle poussa un cri perçant en fermant sa fenêtre. Hélas ! cette fenêtre ne lui déroba que la figure de l’étranger ! Son image restait gravée dans son cœur.
Source: http://fr.wikisource.org/wiki/Melmoth_ou_l%E2%80%99Homme_errant
Melmoth the Wanderer
Charles Robert Maturin
Trad. : Jean Cohen - 1820
HISTOIRE DES INDIENS
XX
Dans le nord des Indes, et non loin de l’embouchure du Hoogly, est située une île qui, par sa position et par des circonstances particulières, resta longtemps inconnue aux Européens. Elle n’était même visitée par les habitants des îles voisines que dans certaines occasions extraordinaires. Elle est entourée de bas-fonds qui en rendent l’approche impraticable à tout vaisseau chargé, et les rochers qui bordent la côte font que cette approche est dangereuse, même pour les légers canots des naturels du pays ; mais ce qui la rendait autrefois plus formidable encore que tout le reste, c’étaient les horreurs dont la superstition l’avait comme investie. Il existait une tradition, d’après laquelle le premier temple de la déesse Séeva avait été construit dans cette île, où sa hideuse idole, assise sur une natte de vipères entrelacées, portant un collier de crânes humains, et des langues fourchues sortant de ses vingt bouches de serpent, avait reçu de ses adorateurs le premier hommage sanglant ; hommage qui consistait en membres mutilés et en enfants immolés.
Le temple avait été renversé et l’île à moitié dépeuplée par un tremblement de terre qui s’était fait ressentir jusque sur les côtes des Indes. Il avait cependant été rebâti par le zèle de ses adorateurs, qui recommençaient à visiter l’île, quand un ouragan, sans exemple même dans ces climats, vint désoler le lieu consacré. La pagode fut consumée par la foudre ; les habitants, leurs maisons, leurs champs cultivés furent détruits, au point qu’il ne resta pas dans toute l’île une trace d’humanité, de culture ou de vie. Les dévots consultaient leur imagination pour se rendre compte de la cause de ces calamités ; et tandis qu’assis à l’ombre de leurs cocotiers, ils défilaient leurs chapelets de couleur, ils attribuaient ces événements à la colère de la déesse Séeva, irritée de la popularité croissante du dieu Juggernaut. Ils soutenaient que l’on avait vu son image s’élevant au milieu des flammes qui avaient consumé les autels auxquels ses adorateurs s’étaient vainement attachés pour leur sûreté, et ils étaient fermement persuadés qu’elle s’était rendue dans quelque île plus heureuse, où elle espérait jouir de festins de chair et de sang, en paix et sans être molestée par l’aspect du culte d’une déité rivale. En conséquence, l’île resta pendant de longues années inculte et privée d’habitants.
Les équipages des vaisseaux européens, ajoutant foi à l’assurance des Indiens, et persuadés qu’ils n’y trouveraient ni animaux, ni végétaux, ni même de l’eau, évitaient de la visiter, et les naturels du pays, en passant devant dans leurs canots, lançaient un regard de tristesse sur son aspect désert, et jetaient quelque objet à la mer pour désarmer le courroux de Séeva.
Cette île, ainsi abandonnée à elle-même, devint d’une fertilité extraordinaire, de même que l’on voit certains enfants qui profitent mieux quand on les néglige, que quand on les entoure de tous les soins du luxe et d’une tendresse excessive. Le sol était tapissé de fleurs, les arbres couverts du feuillage le plus épais pliaient sous le poids des fruits ; mais il n’y avait pas de main pour les cueillir ni de bouche pour les savourer, quand un jour quelques pêcheurs, qu’un courant très fort avait poussés dans l’île, qu’ils avaient vainement cherché à éviter, se virent forcés d’en approcher, non sans avoir adressé à la déesse Séeva les plus ferventes prières, pour se la rendre favorable. À leur grand étonnement, ils purent s’en éloigner de nouveau sans avoir éprouvé de malencontre ; seulement ils rapportèrent à leur retour qu’ils y avaient entendu les sons les plus exquis qui jamais eussent frappé leurs oreilles, et ils jugèrent que sans doute une déesse moins cruelle que Séeva y avait fixé son séjour. Les plus jeunes d’entre les pêcheurs ajoutèrent à ce rapport qu’ils avaient entrevu la figure d’une femme, d’une beauté extraordinaire, qui avait glissé et disparu entre les arbres qui ombrageaient de toutes parts les rochers de la côte. Ils ne manquèrent pas de supposer que cette femme était une incarnation de Vishnou, sous une forme plus aimable qu’aucune de celles qu’il eût jamais prises.
Les habitants des îles voisines, non moins superstitieux que pleins d’imagination, déifièrent cette vision, chacun à sa manière. Les vieux dévots, en l’invoquant, n’abandonnaient aucune des pratiques sanglantes du culte de Séeva et de Harée ; les jeunes femmes s’approchaient, avec leurs légers canots, le plus près possible, de l’île enchantée, offrant des vœux à Camdeo (le dieu de l’amour chez les Indiens), à qui elles envoyaient de petites nacelles de papier remplies de fleurs, et avec un cierge allumé, dans l’espoir que leur divinité chérie fixerait sa résidence dans cette île. Les jeunes gens aussi, ou du moins ceux qui étaient amoureux et qui aimaient la musique, allaient sur les côtes de l’île supplier Apollon Krishnou de la sanctifier par sa présence ; ne sachant ce qu’il fallait lui offrir, debout sur la proue de leurs canots, ils chantaient des airs sauvages, et finissaient par jeter à la mer une figure de cire tenant en main une espèce de lyre.
On vit pendant longtemps ces canots voguer régulièrement toutes les nuits, et se croiser dans l’obscurité comme des météores lumineux. Tantôt une main tremblante déposait sur la grève la lanterne de papier ou la corbeille de fleurs ; tantôt une main plus hardie la suspendait en offrande aux rochers du rivage. Les simples insulaires se plaisaient dans leur humilité volontaire ; mais on remarquait qu’ils revenaient de l’île avec des idées bien douces de l’objet de leur adoration. Les femmes s’efforçaient de répéter les sons divins qui avaient frappé leurs oreilles ; les hommes rentraient chez eux, désolés de n’avoir pu entrevoir la forme céleste qui, au rapport des pêcheurs, errait dans ce lieu inhabité.
Peu à peu l’île perdit la mauvaise réputation dont elle avait joui depuis si longtemps, et une aventure arriva à la fin, qui ne laissa plus de doute sur sa sainteté et sur celle d’un seul habitant qu’elle renfermât.
Un jeune Indien avait offert, à plusieurs reprises, mais en vain, à sa bien-aimée, le bouquet mystique, dont l’arrangement des fleurs exprimait son amour. Inquiet de savoir sa destinée, il se rendit à l’île enchantée, afin de l’apprendre de la mystérieuse divinité qui y avait fixé sa demeure. Pendant qu’il dirigeait son canot vers la côte, il composa une chanson impromptu, dans laquelle il disait que sa maîtresse le repoussait comme s’il avait été un Paria, quoiqu’il l’eût aimée, fût-il même descendu de l’illustre caste des Brames. Il ajoutait que sa peau était plus brillante que le marbre poli des degrés par lesquels on descend à la fontaine d’un rajah, et ses yeux plus brillants qu’aucuns de ceux qui se soient jamais cachés derrière la purdah brodée d’une Nawaub. Elle était plus majestueuse à ses yeux que la noire pagode de Juggernaut, et plus éclatante que le trident du temple de Mahadeva, quand il est éclairé des rayons de la lune. Il n’était pas étonnant que ces deux objets trouvassent une place dans ses vers, car il les distinguait l’un et l’autre sur la côte, tandis qu’il sillonnait une mer tranquille, sous le ciel serein d’une nuit du tropique. Il termina sa chanson en promettant à sa maîtresse, si elle agréait ses soupirs, de lui construire une cabane, à quatre pieds de terre, pour la mettre à l’abri des serpents, de planter à l’entour et des palmiers et des tamarins, et de chasser pendant son sommeil les moustiques avec un éventail formé des feuilles du premier bouquet qu’elle daignerait accepter en témoignage de sa passion.
Le hasard voulut que la même nuit la jeune personne, de qui la réserve n’avait pas eu l’indifférence pour cause, se rendît aussi à cette île, dans un canot, et avec deux de ses compagnes, afin de découvrir si les vœux de son amant étaient sincères. Ils arrivèrent au même instant, et malgré l’obscurité que les premières teintes du matin n’avaient pas encore dissipée, ils prirent courage, et ils descendirent, chacun de leur côté, sur le rivage, tenant dans leurs mains des corbeilles de fleurs. Ils s’avancèrent vers la ruine de la pagode, où l’on s’imaginait que la nouvelle déesse avait fixé son séjour.
Ils eurent quelque peine à se faire jour à travers les taillis de fleurs qui couvraient spontanément la terre inculte, et non sans crainte de voir un tigre s’élancer sur eux à chaque pas. Ils se rassurèrent cependant quand ils se furent rappelés que ces animaux se cachent d’ordinaire dans les grands marais de roseaux, et n’ont pas pour retraite les lieux parfumés de fleurs. Les crocodiles n’étaient pas non plus à craindre dans les ruisseaux étroits qu’ils pouvaient traverser sans mouiller de leur eau limpide la cheville de leurs pieds. Le tamarin, le cocotier, le palmier éparpillaient leurs fleurs, exhalaient leurs parfums et balançaient leurs rameaux sur la tête de la jeune femme tremblante et pieuse, à mesure qu’elle approchait des ruines de la pagode. Ce temple avait été jadis un édifice massif et carré, construit au milieu des rochers, qui, par un caprice de la nature, assez ordinaire dans les mers des Indes, occupaient le centre de l’île, et paraissaient être le résultat d’une éruption volcanique. Le tremblement de terre, qui avait renversé le temple, avait mêlé les rochers et les ruines, de manière qu’ils ne formaient plus qu’une masse informe
qui semblait attester à la fois l’impuissance de la nature et de l’art, abattus par cette puissance qui les a créés, et qui peut les anéantir l’un et l’autre. D’un côté, l’on voyait des colonnes chargées de caractères hyéroglyphiques ;
de l’autre, des pierres qui portaient les marques d’un pouvoir irrésistible. Mortels, disait ce pouvoir, vous tracez avec le ciseau, je n’écris qu’avec le feu. Ici, les restes du monument offraient la représentation des serpents hideux sur lesquels Séeva avait été assise ; et là, la rose croissait entre les fentes des rochers, comme si la nature avait voulu envoyer la plus charmante de ses enfants pour prêcher aux humains sa douce théologie. L’idole même était tombée, et ses fragments épars jonchaient le terrain. On voyait cependant encore cette bouche horrible dans laquelle on avait autrefois jeté des cœurs palpitants, tandis qu’alors des paons superbes, étalant leur magnifique plumage, nourrissaient leurs petits au milieu des branches de tamarin qui ombrageaient ses fragments noircis.
Les jeunes Indiennes s’avançaient, et leurs craintes diminuaient. Rien en effet ne devait inspirer cette terreur religieuse qui marque l’approche d’un être spirituel. Tout autour d’eux était calme, obscur et silencieux. Près des ruines se trouvaient les restes d’une fontaine, telle que l’on en voit à côté de toutes les pagodes, et qui servent à rafraîchir et à purifier les dévots personnages qui visitent le lieu ; mais les degrés qui y conduisaient était brisés, et l’eau était stagnante. Les jeunes Indiennes en burent cependant quelques gouttes, en invoquant la déesse de l’île, après quoi elles s’approchèrent de la seule arcade qui restât entière. L’intérieur du temple avait été creusé dans le roc. On y voyait, comme dans l’île Éléphantine, des figures monstrueuses taillées en pierres, dont les unes étaient adhérentes au rocher, et les autres détachées.
Deux jeunes compagnes de l’Indienne, distinguées par leur courage, s’avancèrent en formant une espèce de danse irrégulière devant les ruines des anciens dieux, et invoquèrent la nouvelle habitante de l’île, pour qu’elle daignât être propice aux vœux de leur amie. Celle-ci s’approchait de son côté, pour suspendre sa guirlande de fleurs aux débris d’une idole à moitié cachée parmi les fragments de pierres ; et couverte de cette riche végétation qui, dans les pays de l’Orient, semble annoncer le triomphe éternel de la nature au milieu des ruines de l’art. La rose se renouvelle tous les ans ; mais des siècles ne renouvelleraient pas une pyramide.
La belle Indienne attache sa guirlande. Tout à coup une voix cachée murmure :
— Il y a ici une fleur fanée.
— Oui, oui, il y en a une, répondit la jeune fille, et cette fleur fanée est l’emblème de mon cœur. J’ai cultivé plus d’une rose, mais j’ai laissé flétrir celle qui m’était la plus chère de toutes. Veux-tu la ranimer pour moi, déesse inconnue, afin que ma guirlande ne déshonore pas tes autels ?
— Veux-tu ranimer la rose, en la réchauffant contre son sein, dit le jeune amant, en sortant de derrière les fragments de rochers et de colonnes où il s’était caché, et où il avait prononcé, sous la forme d’oracles, des réponses aux discours emblématiques, mais intelligibles de son amante, qu’il avait écoutés avec ravissement.
— Ranimeras-tu la rose, répéta-t-il en la serrant contre son cœur avec des transports d’amour et de bonheur.
La jeune Indienne, cédant à la fois au sentiment et à la superstition, se laissa aller dans ses bras, mais soudain elle s’en arracha, le repoussa de toutes ses forces et se retira tremblante d’effroi. Elle ne pouvait parler, et se bornait à montrer du doigt une figure qui venait d’apparaître au milieu de cette masse tumultueuse et indéfinie de rochers et de ruines. L’amant, sans être alarmé du cri de sa maîtresse, s’avançait pour la reprendre dans ses bras, quand son regard se fixa sur l’objet qui avait frappé le sien, et il se laissa tomber le visage contre terre, dans une adoration muette.
La figure qu’ils avaient aperçue était celle d’une femme, comme ils n’en avaient jamais vu. Sa peau était d’une blancheur éblouissante, surtout comparée à la teinte cuivrée des Indiens du Bengale. Ses vêtements n’étaient que des fleurs tressées avec des plumes de paon, et dont les riches couleurs formaient une draperie très digne en effet de couvrir une déesse insulaire. Ses longs cheveux châtains, nuance qui leur était inconnue, tombaient jusqu’à ses pieds, et se mêlaient fantastiquement aux fleurs et aux plumes qui formaient son habillement. Sur sa tête elle portait une couronne de ces coquillages brillants que l’on ne trouve que dans les mers des Indes, et dont le pourpre et le vert luttent d’éclat avec l’améthyste et l’émeraude. Sur son épaule blanche et nue était perché un loxia, et autour de son cou elle portait un collier formé des œufs de cet oiseau, si blancs et si diaphanes, que la première souveraine de l’Europe aurait échangé contre eux son plus beau rang de perles. Ses bras et ses jambes étaient tout à fait nus, et son pas avait une rapidité et une légèreté divines, qui frappèrent autant l’imagination des Indiens, que la couleur extraordinaire de sa peau et de ses cheveux.
Les jeunes amants, ainsi que nous l’avons dit, se prosternèrent respectueusement devant cette vision. Des sons délicieux frappèrent leurs oreilles. La vision leur adressait la parole, mais c’était dans une langue qui leur était inconnue ; cette circonstance les confirma dans l’idée qu’ils entendaient le langage des dieux, et ils se prosternèrent de nouveau. Dans ce moment le loxia, quittant son épaule, vint voltiger autour d’eux.
— Il va chercher des portes-lanternes pour en éclairer son nid, dirent les Indiens.
Mais l’oiseau, avec une intelligence particulière à son espèce, avait compris et adopté la prédilection de sa maîtresse, pour les fleurs fraîches dont elle formait tous les jours sa parure. Il s’élança donc sur le bouton de rose fané qui se trouvait dans le bouquet de l’amant, et l’arrachant d’entre les autres fleurs, il le déposa aux pieds de sa maîtresse. Les Indiens interprétèrent cet augure d’une manière favorable, et après s’être encore une fois prosternés contre terre, ils reprirent le chemin de l’île qu’ils habitaient. Cette fois, ils ne s’embarquèrent pas dans des canots différents ; l’amant dirigea celui de son amante qui, assise en sûreté à côté de lui, prêtait l’oreille aux hymnes que ses jeunes compagnes chantaient en l’honneur de la blanche déesse et de l’île propice aux amours, où elle avait fixé sa demeure.
La belle et unique habitante de cette île, troublée un moment à la vue de ses adorateurs, ne tarda pas à recouvrer sa tranquillité. Elle ne pouvait connaître la crainte, car rien, dans le monde qu’elle avait vu, ne lui avait encore offert l’apparence de l’inimitié. Le soleil et l’ombre, les fleurs et
les feuilles, les tamarins et les figues dont elle se nourrissait ; l’eau qu’elle buvait en admirant l’être charmant qui buvait toujours avec elle ; les paons qui étalaient leur riche et brillant plumage aussitôt qu’ils la voyaient ; enfin le loxia qui, perché sur sa main ou sur son épaule, la suivait dans ses promenades, et s’efforçait d’imiter sa voix par ses gazouillements : tous ces objets étaient ses amis, et elle ne connaissait qu’eux.
Les êtres humains qui parfois approchaient de l’île lui causaient à la vérité une légère émotion ; mais c’était plutôt de la curiosité que de la crainte. D’ailleurs leurs gestes exprimaient tous du respect, leurs offrandes de fleurs lui étaient si agréables, leurs visites se passaient dans un silence si profond, qu’elle les voyait sans aucune répugnance, et s’étonnait seulement en les voyant partir, comment ils pouvaient se soutenir en sûreté sur les eaux, et comment des créatures d’une couleur si sombre, et avec des traits si peu agréables, pouvaient croître au milieu des brillantes fleurs qu’elles lui offraient comme les produits de leurs demeures.
On pourrait penser que du moins les éléments devaient avoir inspiré à son imagination quelques idées terribles ; mais la régularité périodique de leurs phénomènes dans le climat qu’elle habitait les dépouillait de ce qu’ils avaient d’effrayant. Elle s’y était accoutumée comme à la succession du jour et de la nuit. N’ayant jamais entendu l’expression de la frayeur d’autrui, elle n’en éprouvait pas elle-même : car cette communication est dans la plupart des esprits la première cause de l’effroi. Elle n’avait jamais senti que des douleurs si légères, qu’elles n’en méritaient pas le nom ; elle n’avait aucune idée de la mort. Comment, d’après tout cela, aurait-elle connu la crainte ?
Quand par hasard l’île était visitée par un ouragan, accompagné du spectacle horrible d’une profonde obscurité au milieu du jour, de nuages noirs et suffocants, du roulement d’un tonnerre épouvantable, elle restait tranquille sous le large feuillage du bananier, ignorant son danger, et examinant avec une curiosité inexplicable les oiseaux qui penchaient la tête et les ailes, et les singes qui sautillaient de branches en branches dans leur bizarre frayeur. Si la foudre tombait sur un arbre, elle la contemplait comme un enfant regarde un feu d’artifice que l’on tire pour l’amuser. Elle pleurait cependant le lendemain, quand elle voyait que les feuilles flétries ne se ranimaient pas. Quand la pluie descendait par torrents, les ruines de la pagode lui offraient un abri, et elle écoutait avec un ravissement inexprimable le bruit des eaux qui roulaient autour d’elle. Elle vivait ainsi comme une fleur au milieu du soleil et de la tempête, plus brillante à la lumière du jour, mais pliant au vent, et tirant de l’un et de l’autre sa douce et sauvage existence. Cette existence moitié physique, moitié imaginative, mais sans passions ou intelligence, dura jusqu’à sa dix-septième année. Ce fut alors qu’une circonstance arriva qui en changea pour toujours la couleur.
Le lendemain du jour où les Indiens étaient partis, Immalie, c’était le nom que ses adorateurs lui avaient donné ; Immalie, disons-nous, se tenait, vers le soir, sur le rivage, quand elle vit s’approcher d’elle un être différent de tous ceux qu’elle avait vus jusqu’alors. La couleur de son visage et de ses mains ressemblait à la sienne, mais ses vêtements, qui étaient européens et taillés d’après la mode de l’an 1680, lui parurent si mal séants, si peu gracieux, qu’elle éprouva une sensation mêlée de
répugnance et d’étonnement, que ses beaux traits ne purent exprimer autrement que par un sourire.
L’étranger s’approcha d’elle, et elle s’avança vers lui, non point comme une femme d’Europe, avec des révérences pleines de grâce, moins encore comme une jeune fille de l’Inde, avec d’humiliantes courbettes ; mais semblable à un jeune faon : ses manières exprimaient à la fois la vie, la timidité, la confiance. Elle quitta précipitamment la grève, courut à son antre favori, et revint bientôt après, entourée de son escorte de paons, ils étalaient leurs magnifiques roues, comme si l’instinct leur avait fait connaître le danger que courait leur protectrice qui, frappant dans ses mains avec joie, paraissait, de son côté, les inviter à partager le bonheur qu’elle éprouvait en contemplant la nouvelle fleurqui avait pris naissance au milieu des sables du rivage.
L’étranger, parvenu auprès d’elle, lui adressa la parole. À son grand étonnement, Immalie reconnut le langage dont les faibles souvenirs de son enfance avaient laissé quelques traces dans sa mémoire, langage qu’elle avait vainement essayé d’apprendre à ses paons, à ses perroquets et à ses loxias. En attendant, ces sons lui étaient devenus si étrangers, qu’elle fut enchantée quand elle entendit une bouche humaine en prononcer les plus insignifiants. Quand l’étranger lui eut dit :
— Comment vous portez-vous, belle vierge ? Elle répondit :
— Dieu m’a faite, première réponse du catéchisme que sa bouche enfantine avait autrefois appris à balbutier.
— Dieu n’a jamais fait une plus belle créature, reprit l’étranger en fixant sur elle des yeux qui brûlent encore sous les paupières de ce grand trompeur.
— Oh ! qu’oui, répondit Immalie. Il a fait beaucoup de choses plus belles. La rose est plus rouge que je ne le suis, le palmier est plus grand ; mais ils changent tous, et je ne change pas. La rose se fane après quelques heures, et moi je deviens plus grande et plus forte… Mais d’où venez-vous ? Vous n’êtes pas muet comme ceux qui vivent sous la mer ; vous n’êtes pas rouge comme ceux que j’aimais, qui me ressemblaient, et qui me paraissaient venir de bien loin au-delà des eaux. D’où venez-vous ? Vous n’avez pas l’éclat des étoiles. Où croissez-vous, et comment êtes-vous venu ici ? J’ai un faible souvenir d’avoir vu un être comme vous, mais il y a si longtemps que je puis à peine me le rappeler.
— Belle créature, dit l’étranger, je viens d’un monde où il y a des milliers d’êtres comme moi.
— Des milliers ! dit Immalie ; qu’est-ce que cela veut dire ?
— Cela veut dire beaucoup.
— C’est impossible : car je suis seule ici, et tous les mondes doivent ressembler à celui-ci.
— Ce que je vous dis est cependant vrai, reprit l’étranger. Immalie s’arrêta un moment, comme si elle eût fait pour la première
fois un effort pour réfléchir. Cet effort était pénible dans un être dont l’existence n’avait été composée jusqu’alors que d’heureuses inspirations et d’un instinct irréfléchi ; puis tout à coup elle s’écria :
— Je vous entends mieux que mes oiseaux. Ce que nous faisons s’appelle, je crois, parler. Dans le pays d’où vous venez, les oiseaux et les roses parlent-ils aussi ?
Au lieu de répondre à sa question, l’étranger lui fit entendre qu’il avait faim. Immalie s’empressa de l’engager à la suivre ; elle lui servit un léger repas de figues et de tamarins, et puisa, dans une coquille de coco, de l’eau du ruisseau limpide qui coulait à l’ombre du manguier. Pendant qu’il mangeait, Immalie lui raconta tout ce qu’elle savait d’elle-même. Elle était, disait-elle, la fille d’un palmier : c’est-à-dire que sous son ombre elle avait éprouvé la première sensation de son existence. Elle était sans doute fort âgée, car elle avait vu bien des roses naître et se flétrir ; et, quoiqu’elles eussent été suivies d’autres roses, elle aimait mieux les premières, parce qu’elles étaient beaucoup plus grandes et plus brillantes ; d’ailleurs tout était devenu plus petit : car elle pouvait présentement atteindre au fruit qu’autrefois elle n’obtenait qu’après qu’il fut tombé à terre.
Ici, l’étranger l’interrompit pour lui demander comment elle avait appris à parler.
— C’est ce que je m’en vais vous dire, répondit Immalie. Je savais parler avant d’être née ; mais du reste je me rappelle que j’avais autrefois avec moi un être qui me ressemblait beaucoup, mais il était noir. Cet être était bien bon ; il prenait soin de moi ; il me caressait ; quand j’étais petite, il m’apportait à manger et à boire, et il me parlait la même langue que vous… Oh ! je me rappelle en effet à présent qu’il m’a dit une fois, tout comme vous, qu’il y avait un autre monde dans lequel il y avait beaucoup d’êtres comme moi : je l’avais tout à fait oublié… Mais pour en revenir à lui, un jour, je m’étais assise sous ce palmier que vous voyez là-bas ; je désirais un tamarin pour me rafraîchir, parce qu’il faisait très chaud. Il n’y en avait point autour de nous, et mon bon ami noir me dit qu’il m’en irait chercher un plus loin… Eh bien ! le croiriez-vous ? depuis ce temps, je ne l’ai plus revu. J’ai bien pleuré, quand j’eus attendu longtemps, longtemps sans le voir revenir. Je l’ai cherché partout, et je ne puis m’imaginer ce qu’il est devenu.
Pendant ce discours d’Immalie, l’étranger s’était appuyé contre un arbre, et la contemplait avec une expression indéfinissable. Pour la première fois de sa vie, son regard peignait une sorte de compassion. Cette sensation ne dura pas longtemps dans un cœur où elle était étrangère. Son expression se changea bientôt en un regard moitié ironique, moitié diabolique, qu’Immalie ne pouvait comprendre.
— Vous êtes donc maintenant ici toute seule ? dit-il, depuis le départ de votre compagnon, vous n’avez pas retrouvé d’autre ami ?
— Oh, oui ! j’ai un ami bien plus beau que l’autre ; mais il ne parle pas. Il demeure sous les eaux. Je l’embrasse, et il me rend mes caresses ; mais sa bouche est si froide ! Et puis quand je l’embrasse, on dirait qu’il danse, et sa beauté se brise en beaucoup, beaucoup de petits visages qui me sourient comme autant de petites étoiles.
Elle continua encore pendant quelque temps à décrire ce mystérieux ami ; et, quand elle eut fini, l’étranger lui demanda si c’était un homme ou une femme.
— Je ne sais pas ce que vous voulez dire, répondit Immalie.
— Je vous demande de quel sexe est votre ami.
Il n’obtint aucune réponse satisfaisante à cette question, et ce ne fut que le lendemain, qu’en visitant de nouveau l’île, il fut confirmé dans
le soupçon que lui avaient inspiré les discours d’Immalie. Il trouva cet être innocent et aimable penché sur un ruisseau qui réfléchissait son image à qui elle faisait mille agaceries pleines de grâces et d’une naïve tendresse. L’étranger la contempla pendant quelque temps, et des pensées, que nul homme pourrait pénétrer, jetèrent pour un moment leur expression variée sur sa physionomie d’ordinaire si calme.
La joie avec laquelle Immalie le reçut contribua aussi à ramener des sentiments humains dans un cœur auquel ils avaient été depuis longtemps étrangers. Il éprouva une sensation semblable à celle de son maître, quand il visita le paradis terrestre : c’est-à-dire de la pitié pour les fleurs qu’il était résolu de flétrir à jamais. Il la regarda, comme elle folâtrait autour de lui, les bras étendus et les yeux ivres de joie, et il soupira quand il l’entendit célébrer son arrivée avec des paroles bien dignes d’un être qui de temps immémorial n’avait entendu que le murmure des eaux et le chant des habitants des airs. Néanmoins, quelle que fût son ignorance, elle ne put s’empêcher de témoigner sa surprise de ce qu’il venait dans l’île sans aucun moyen apparent de transport. Il évita de répondre, et dit :
— Immalie, je viens d’un monde bien différent de celui que vous habitez, et où vous ne voyez que des fleurs inanimées et des oiseaux privés de raison. Je viens d’un monde où tous les habitants pensent et parlent comme moi.
Immalie garda pendant quelques instants un silence d’étonnement et de joie. À la fin, elle s’écria :
— Oh ! comme ils doivent s’aimer ! car j’aime bien mes pauvres oiseaux et mes fleurs, et mes arbres qui m’ombragent, et mes ruisseaux qui chantent pour moi.
L’étranger sourit.
— Dans tout ce monde, il n’y a peut-être pas une créature aussi belle et aussi innocente que vous. C’est un monde de souffrances, de crimes et de soucis.
À ces mots, Immalie regarda fixement l’étranger. Elle ne comprenait rien à ce qu’il lui disait, et ce ne fut pas sans peine qu’il parvint à lui donner une bien faible idée de ce qu’il entendait par ces mots épouvantables.
— Oh ! s’écria-t-elle à la fin, si je vivais dans ce monde, j’y voudrais rendre chacun heureux.
— Mais vous ne le pourriez pas, Immalie. Ce monde est si grand que, dans tout le cours de votre vie, vous pourriez à peine le traverser, et, dans vos courses, vous ne verriez qu’un petit nombre de malheureux à la fois, et souvent leurs malheurs seraient tels, qu’aucun pouvoir humain ne pourrait les soulager.
À ces mots, Immalie fondit en larmes.
— Faible, mais aimable créature, dit l’étranger, pensez-vous que vos larmes puissent guérir les souffrances de la maladie, rafraîchir les feux qui brûlent dans un cœur ulcéré, ranimer le corps exténué par la faim, mais surtout, surtout, éteindre les flammes des passions illicites ?
Immalie pâlit à cette énumération de maux dont elle n’avait aucune idée. À la fin, elle dit que partout où elle irait, elle apporterait des fleurs, et qu’elle ferait asseoir les malheureux sous l’ombre du tamarin. Quant à la maladie et à la mort, elle ne savait pas ce que cela voulait dire.
— C’est peut-être comme les fleurs que je vois souvent languir, et d’autrefois se faner pour ne plus revenir. Mais, ajouta-t-elle après avoir réfléchi un moment, j’ai aussi remarqué que ces fleurs gardent leurs délicieux parfums, même après qu’elles se sont flétries pour toujours. Ne serait-il pas possible aussi que ce qui pense vive après que notre corps s’est flétri ? Cette pensée est bien douce !
Pour la passion, elle n’en avait aucune idée, et ne pouvait proposer de remède à un mal qui lui était si complètement étranger. Elle avait vu des fleurs se faner quand leur saison était passée, mais elle ne pouvait concevoir pourquoi une fleur se détruirait elle-même.
— Mais n’avez-vous jamais remarqué un ver dans une fleur ? dit l’étranger avec tout l’artifice de la séduction.
— Oui, répondit Immalie ; mais le ver ne faisait point partie de la fleur. Ses propres feuilles n’auraient pu lui faire de mal.
Ceci amena une discussion à laquelle l’innocence parfaite d’Immalie ôta tous ses dangers. Nonobstant sa vive curiosité, et la promptitude de son entendement, ses réponses enjouées, mais vagues, son imagination inquiète et bizarre, ses armes intellectuelles acérées, mais qu’elle ne savait pas manier ; enfin, et par-dessus tout, son instinct et son tact infaillibles pour ce qui était juste ou injuste, tout cela fit échouer plus sûrement les discours du tentateur que s’il avait argumenté contre tous les logiciens réunis des académies européennes. Versé dans tous les sophismes des écoles, il était plus qu’ignorant dans cette rhétorique du cœur et de la nature. Tel on dit que le lion s’humilie devant une vierge dans sa pureté native, le tentateur se retirait mécontent, quand il vit des larmes mouiller les yeux d’Immalie : cette innocente douleur lui offrit un présage triste et favorable.
— Vous pleurez, Immalie ?
— Oui, je pleure toujours quand je vois le soleil disparaître le soir derrière les nuages ; et vous, soleil de mon cœur, disparaîtrez-vous aussi dans l’ombre ? ne renaîtrez-vous pas ? dites-moi, ne vous reverrai-je plus ?
En prononçant ces mots, elle pressa la main de l’étranger contre sa bouche de corail.
— Je n’aimerai plus ni mes roses, ni mes paons, si vous ne revenez pas : car ils ne peuvent pas me parler comme vous faites, et je ne puis leur demander des pensées, tandis que vous m’en donnez beaucoup. Oh ! je voudrais avoir beaucoup de pensées au sujet de ce monde qui souffre, et d’où vous venez. En effet, je dois croire que vous en êtes venu, car jusqu’au moment où je vous ai vu, je n’avais jamais senti une douleur qui ne fût un plaisir. Maintenant tout est douleur, surtout quand je songe que vous ne reviendrez pas.
— Je reviendrai, belle Immalie, et je vous montrerai, à mon retour, un aperçu de ce monde d’où je viens, et que vous habiterez bientôt vous-même.
— Je vous y verrai donc, dit Immalie ; sans cela, comment pourrais-je parler des pensées ?
— Oh, oui ! oh, certainement !
— Mais pourquoi répétez-vous deux fois la même chose? Un mot de votre bouche aurait suffi.
— Eh bien ! donc, oui !
— Prenez cette rose, et respirons-en le parfum ensemble. C’est ce que je dis à mon ami du ruisseau, quand je me baisse pour l’embrasser ; mais il retire sa rose avant que je l’aie sentie, et je laisse la mienne sur l’eau. Eh bien ! ne voulez-vous pas la prendre ?
— Oui, sans doute, dit l’étranger en prenant une fleur dans le bouquet qu’Immalie lui présentait. Elle était fanée. Il s’en saisit, et la cacha dans son sein.
— Allez-vous donc traverser cette mer obscure, dit Immalie, sans vous mettre dans une de ces grandes coquilles dans lesquelles j’ai vu venir ces êtres rouges dont je vous ai parlé ?
— Nous nous reverrons, dit l’étranger, et ce sera dans le monde des souffrances.
— Je vous remercie, je vous remercie, répondit Immalie en le voyant se plonger dans les flots.
L’étranger se contenta de répondre :
— Nous nous reverrons.
Deux fois avant de partir, il jette un regard sur cette créature si belle et si innocente. Un sentiment d’humanité fait tressaillir son cœur. Mais tout à coup il arrache de son sein la rose fanée, et répond au sourire enchanteur d’Immalie :
— Nous nous reverrons.
XXI
Durant sept matinées consécutives et durant autant de soirées, Immalie parcourut le rivage de son île solitaire sans revoir l’étranger. Elle se rappelait toujours, pour se consoler, l’assurance qu’il lui avait donnée qu’elle le reverrait dans le monde des souffrances, et elle ne cessait de répéter en elle-même ses dernières paroles. Dans l’intervalle, elle s’efforça de former son éducation pour ce monde où elle allait entrer, et rien ne pouvait être plus admirable et plus intéressant que de voir les tentatives qu’elle faisait pour tirer du règne végétal ou animal quelque analogie qui pût lui donner une idée de l’incompréhensible destinée des hommes. Tantôt, elle regardait la fleur, et se disait : « Cette fleur, si brillante aujourd’hui, sera fanée demain ; mais elle ne ressent point de douleur ; elle meurt patiemment, et celles qui l’avoisinent n’éprouvent point de chagrin en perdant leur compagne : sans cela leurs couleurs ne seraient pas si resplendissantes. Mais peut-il en être ainsi dans le monde qui pense ? Pourrais-je le voir se faner et mourir, sans me faner et mourir avec lui ? Oh, non ! Quand cette fleur se fanera, je chercherai, comme la rosée, à la ranimer par mes pleurs. »
Elle essaya ensuite d’agrandir la sphère de ses idées, en observant le règne animal. Un jeune loxia était tombé mort de son nid suspendu. Immalie, regardant par l’ouverture que ces oiseaux intelligents font à l’extrémité inférieure de leur nid, pour le mettre à l’abri des oiseaux de proie, aperçut les vieux loxia avec des porte-lanternes dans leurs becs, tandis que le jeune gisait mort devant eux. À cette vue, Immalie fondit en larmes.
— Ah ! vous ne pouvez pleurer ! s’écria-t-elle, quel avantage j’ai sur vous ! Vous mangez, quoique votre petit, votre enfant soit mort ! (Nous n’avons pas besoin d’observer que, dans sa conversation avec Immalie, l’étranger lui avait donné quelque idée des liens de la parenté.) Pourrais-je boire encore le lait de la noix de coco, si lui n’était plus en état d’en goûter ? Je commence maintenant à comprendre ce qu’il m’a dit… Penser est donc souffrir !… Et le monde des pensées doit être aussi le monde des souffrances ! mais que ces larmes sont délicieuses ! autrefois je pleurais de plaisir ; ah ! je vois maintenant qu’il y a une peine plus agréable encore que le plaisir, et cette peine, je ne l’avais jamais éprouvée avant de l’avoir vu. Oh ! qui pourrait, en renonçant à la pensée, renoncer au plaisir de pleurer ?
Cependant Immalie ne passa pas uniquement dans les réflexions l’intervalle que l’étranger mit entre ses visites. Une nouvelle inquiétude commença à l’agiter ; et, dans les moments que lui laissaient ses méditations et ses larmes, elle recherchait avec avidité les plus brillants coquillages pour en orner ses bras et ses cheveux. Elle changea tous les jours sa robe de fleurs, et au bout d’une heure elles ne semblaient déjà plus assez fraîches. Puis elle remplissait une large coquille de l’eau la plus limpide, et posait les fruits les plus délicieux, qu’elle entremêlait de roses, sur le banc de pierre de la pagode ruinée. Mais le temps se passait sans que l’étranger vînt la voir. Le lendemain, en revoyant le banquet qu’elle avait préparé la veille, elle pleurait sur les fruits qui n’avaient plus de fraîcheur ; puis elle s’empressait d’essuyer ses yeux et d’en arranger un nouveau.
Telle était son occupation durant la huitième matinée, quand elle vit tout à coup l’étranger devant elle. La joie naïve et innocente avec laquelle elle courut à sa rencontre excita pour un moment dans son cœur un sentiment de remords dont Immalie s’aperçut au ralentissement de ses pas et à ses yeux détournés. Elle s’arrêta, pleine d’une aimable timidité, comme paraissant lui demander pardon d’une offense involontaire, et sollicitant la permission d’approcher, par l’attitude même qu’elle avait prise pour s’en abstenir. Dans ses yeux brillaient des larmes prêtes à s’échapper s’il avait fait encore un seul mouvement pour la repousser. Cet aspect rendit à l’étranger son courage, et il pensa en lui-même : Il faut qu’elle apprenne à souffrir pour se rendre digne d’être mon élève.
— Vous pleurez, Immalie ! ajouta-t-il en s’approchant d’elle.
— Oh, oui ! répondit-elle en souriant à travers ses larmes, comme une matinée de printemps. Vous devez m’apprendre à souffrir, et je serai bientôt préparée à entrer dans votre monde ; mais j’aime mieux pleurer pour vous, que sourire sur des roses.
— Immalie, reprit l’étranger, repoussant les sentiments de tendresse qui l’amollissaient malgré lui, Immalie, je viens vous montrer quelque chose de ce monde des pensées que vous désirez tant d’habiter, et où vous ne tarderez pas en effet à fixer votre demeure. Montez sur cette colline où vous voyez un bosquet de palmiers.
— Mais je voudrais le voir tout entier à la fois, dit Immalie avec l’avidité naturelle d’une intelligence ardente qui croit pouvoir tout embrasser.
— Tout entier à la fois ! répéta l’étranger en souriant. J’ai quelque idée que la portion que vous en verrez aujourd’hui sera plus que suffisante pour satisfaire votre curiosité, quelle qu’elle soit.
En disant ces mots, il tira de dessous son justaucorps un tube, et lui dit d’y appliquer son œil. La jeune Indienne obéit ; mais au bout d’un instant elle s’écria vivement :
— Suis-je là, où sont-ils ici ? et elle se laissa aller à terre dans une extase inexprimable.
Elle se releva au bout d’un moment, et, saisissant le télescope, elle voulut s’en servir seule ; mais elle porta le grand verre à son œil. N’apercevant plus rien, elle dit avec tristesse :
— Tout est parti ! Ce monde si beau n’a vécu qu’un instant ! Tout ce que j’aime meurt ainsi. Mes roses les plus chéries ne vivent pas aussi longtemps que celles que je néglige. Vous êtes resté absent pendant sept jours, et ce monde superbe n’a vécu qu’un moment !
L’étranger dirigea encore le télescope vers le rivage de l’Inde, dont ils n’étaient pas très éloignés, et Immalie, enchantée, s’écria de nouveau :
— Ah ! tout revit, et plus beau que jamais ! Je vois partout des êtres vivants et pensants. Mais que sont donc ces superbes rochers que j’aperçois, et qui ne ressemblent pas aux rochers de mon île ? Leurs côtés sont polis ; leurs sommets sont découpés comme des fleurs. Oh ! que ce monde doit être beau ! Est-ce la pensée qui a fait tout cela ?
— Attendez, Immalie, dit l’étranger en lui ôtant le télescope des mains ; pour jouir de ce spectacle, il faut que vous le compreniez.
— Sans doute, répondit Immalie, chez qui le monde sensible perdait peu à peu ses attraits en comparaison du monde spirituel nouvellement découvert pour elle. Oh ! oui… laissez-moi penser !
— Immalie, avez-vous de la religion ? dit pour lors l’inconnu, tandis qu’une sensation de douleur inexprimable ajoutait à la pâleur de son front.
Immalie, dont l’intelligence était prompte, et qui sympathisait avec toutes les sensations qu’elle voyait, le quitta avec vivacité, et revint un instant après tenant en main une feuille de bananier, avec laquelle elle essuya les gouttes de sueur qui découlaient de son front décoloré ; puis s’étant assise à ses pieds, dans l’attitude d’une attention avide et profonde, elle répéta :
— De la religion ! qu’est-ce que c’est ? Est-ce une nouvelle pensée ?
— C’est la connaissance d’un Être supérieur à tous les mondes et à leurs habitants, puisque c’est lui qui les a faits tous, et qui sera leur juge ; d’un être que nous ne pouvons voir ; mais dans le pouvoir et la puissance duquel nous devons croire, quoique invisible ; d’un Être qui est partout, sans qu’on le voie nulle part ; qui agit toujours, quoiqu’il ne soit jamais en mouvement ; qui entend tout, et ne se fait jamais entendre.
Immalie l’interrompit avec une espèce d’égarement :
— Arrêtez ! trop de pensées me tueront ; laissez-moi reposer un moment. J’ai vu la pluie qui tombait pour rafraîchir le rosier, et qui le couchait par terre.
Après un effort pénible, comme pour rappeler un souvenir éloigné, elle ajouta :
— La voix des songes m’a dit quelque chose de ce genre avant que je fusse née; mais il y a longtemps !… Quelquefois j’ai eu en moi des pensées qui ressemblaient à cette voix. Il me semblait que j’aimais trop les choses qui m’entouraient, et que j’aurais dû aimer des choses bien loin de moi : des fleurs qui ne se flétriraient point, et un soleil qui ne se coucherait jamais. Après de telles pensées, j’aurais voulu m’enlever comme un oiseau dans l’air ; mais il n’y avait personne pour me montrer le chemin.
— Il est juste, reprit l’étranger, non seulement d’avoir des pensées sur cet Être, mais encore de les exprimer par des actes extérieurs. Les habitants de ce monde que vous allez voir appellent cela adorer, et ils ont adopté divers modes d’adoration. (En disant ces derniers mots, un sourire satanique parut sur ses lèvres.) Ces modes sont si différents, qu’ils ne s’accordent que sur un seul point, celui de faire de la religion un tourment.
— Cela n’est pas possible, s’écria Immalie ; ils doivent sentir que celui qui est toujours le même ne peut agréer des différences dans la manière de l’adorer.
— C’est aussi en cela que consistent leurs erreurs. Pendant qu’il parlait, Immalie avait repris le télescope.
— Eh bien ! que voyez-vous ? dit l’étranger.
Immalie décrivait ce qu’elle voyait d’une manière très imparfaite, mais qui deviendra plus intelligible pour le lecteur, par les paroles explicatives de l’étranger.
— Vous voyez, dit-il, les côtes des Indes, les rivages du monde qui est près de vous. Cet édifice énorme sur lequel votre œil se fixe le premier, est la noire pagode de Juggernaut. À côté de cette pagode, vous voyez une mosquée turque ; elle se distingue par l’emblème d’un croissant qui surmonte le toit. Non loin de là est un bâtiment peu élevé, couronné d’un trident : c’est le temple de Mahadeva, une des anciennes déesses du pays.
— Mais, que m’importent les maisons ! dit Immalie ; montrez-moi les êtres vivants qui s’y rendent.
— C’est juste, reprit le tentateur ; mais ces maisons indiquent les différentes façons de penser de ceux qui les fréquentent. Si vous désirez examiner leurs pensées, il faut voir comment il les expriment par leurs actions. Dans le commerce qu’ils ont les uns avec les autres, les hommes sont souvent de mauvaise foi ; mais ils sont assez sincères dans leurs adorations, conformément au caractère qu’ils prêtent à leurs dieux : si ce caractère est formidable, ils expriment la crainte ; s’il est cruel, ils s’infligent des souffrances ; s’il est triste, l’image du dieu se réfléchit fidèlement sur le visage de ses adorateurs. Voyez du reste et jugez.
Immalie regarda, et vit une vaste plaine sablonneuse, à l’extrémité de laquelle se dessinait l’obscure pagode de Juggernaut. Cette plaine était jonchée de squelettes, tandis que des milliers d’êtres à peine vivants traînaient leurs corps à demi brûlés sur les sables, afin de périr à l’ombre du temple dont ils n’osaient espérer d’atteindre les murs. Une foule mouraient en chemin ; d’autres secouaient faiblement la main, pour éloigner les vautours, qui déjà s’apprêtaient à les dévorer.
À côté de cette scène effroyable, se présentait un spectacle magnifique. La statue de Juggernaut s’avançait sur un énorme char de triomphe, que traînaient une foule innombrable de prêtres, de victimes, de bramines et de faquirs. À mesure que la procession marchait, des malheureux se jetaient devant les roues du char, qui les écrasait en passant. D’autres, qui ne se croyaient pas dignes de périr d’une mort aussi illustre, se faisaient de larges blessures, et se contentaient de laisser couler leur sang sur la route du Dieu. Tel est le mélange de rites qui caractérise partout le paganisme. Moitié brillant, moitié horrible ; invoquant la nature en même temps qu’il l’outrage ; mêlant les fleurs avec le sang, et jetant devant le char de l’idole, tantôt un enfant en pleurs, et tantôt une guirlande. Le temple de Mahadeva ne lui offrit pas un spectacle moins horrible ; nous épargnons au lecteur la description des mères sacrifiant leurs enfants, et des enfants exposant leurs parents décrépits aux tigres et aux crocodiles. Il suffira de dire, qu’après l’avoir contemplé pendant quelque temps, Immalie, couvrant ses yeux de ses deux mains, resta muette de douleur et d’horreur.
— Tournez-vous par ici, dit l’étranger ; les cérémonies de toutes les religions ne sont pas également sanglantes.
Immalie leva les yeux, et elle vit une mosquée turque, dans toute la splendeur qui accompagna la première introduction de la religion mahométane parmi les Hindous. Elle élevait ses dômes recouverts d’or, ses minarets artistement sculptés, et ses flèches couronnées de croissants ; elle était enrichie de tous les ornements que l’imagination orientale prodigue à son architecture, à la fois légère et brillante, pompeuse et aérienne.
Un groupe de Turcs s’avançait gravement vers la mosquée. Leurs traits nobles et expressifs, leurs costumes majestueux et leurs tailles élevées formaient un contraste remarquable avec les pauvres Hindous, à moitié nus, qui, assis par terre, achevaient un léger repas de riz cuit à l’eau. Immalie regardait les Turcs avec respect et plaisir, et commençait à penser qu’il pouvait y avoir quelque chose de bon dans la religion professée par des êtres d’un aspect aussi noble. Tout à coup elle les vit, avant d’entrer dans la mosquée, repousser avec mépris les Indiens, tranquilles et effrayés, et leur cracher à la figure. Ils les frappaient du plat de leurs sabres, et les traitaient de chiens d’idolâtres ; ils les maudissaient au nom de Dieu et du prophète.
Quoique Immalie ne pût pas entendre les mots qui accompagnaient cette action, elle n’en fut pas moins révoltée, et elle en demanda le motif.
— Leur religion, dit l’étranger, leur ordonne de haïr tous ceux qui n’adorent pas Dieu comme eux.
— Hélas ! observa Immalie, cette haine que leur religion enseigne n’est-elle pas la preuve que cette religion n’est pas la véritable ? Mais pourquoi, ajouta-t-elle avec étonnement, ne vois-je pas parmi eux quelques-unes de ces créatures plus aimables, dont les habits diffèrent des leurs, et que vous appelez des femmes ? N’adorent-elles pas aussi Dieu, ou bien ont-elles une religion plus douce qui leur est propre ?
— Cette religion, répondit l’étranger, n’est pas favorable à ces créatures, dont vous êtes, sans contredit, la plus aimable. Elle enseigne que l’homme aura d’autres compagnes dans le monde des âmes, et elle ne dit pas bien clairement si jamais les femmes y arriveront. Aussi vous devez voir quelques-unes de ces créatures délaissées, errantes parmi les pierres qui marquent le lieu où reposent les morts ; elles répètent des prières pour les âmes qu’elles n’osent espérer de revoir. D’autres, âgées et dans l’indigence, assises aux portes de la mosquée, lisent à haute voix des passages d’un livre qu’ils appellent le Koran, non dans la vue d’exciter la dévotion, mais dans l’espoir d’obtenir une faible charité.
À ces mots désolants, Immalie qui avait en vain cherché dans ces divers systèmes cette espérance et ces consolations, dont son esprit si pur et son imagination si vive lui démontraient également la nécessité, éprouva une invincible répugnance pour toute religion ; car on les lui peignait sous des couleurs qui ne lui offraient qu’un hideux tableau de sang et de cruauté, renversant tous les principes de la nature, et rompant tous les liens du cœur.
Elle se jeta par terre, et s’écria :
— Il n’y a point de Dieu, s’il n’y en a point d’autre que le leur. Puis s’étant levée pour jeter un dernier regard sur ce qu’elle venait de voir, dans l’espoir que ce ne serait qu’une illusion, elle découvrit un petit édifice obscur, ombragé de palmiers et surmonté d’une croix. Frappée de la simplicité de son apparence, ainsi que du petit nombre et de la conduite paisible de ceux qui s’en approchaient, elle s’écria que c’était sans doute là une nouvelle religion ; et elle en demanda le nom et les rites. L’étranger qui avait fait ce qu’il avait pu pour empêcher qu’elle n’aperçût ce temple modeste montra beaucoup d’inquiétude à la découverte qu’elle venait de faire, et plus encore de répugnance à répondre aux questions que cette découverte lui suggérait ; mais elle insista si vivement, et mit une si aimable importunité à les réitérer ; elle passa si naïvement d’une douleur profonde et grave à une curiosité à la fois enfantine et intelligente, qu’il était impossible de lui résister.
Il se peut faire encore qu’une autre cause ait agi sur ce prophète de malheur, et l’ait forcé de prononcer une bénédiction, quand il aurait voulu maudire ; mais c’est un mystère qu’il ne nous est pas permis d’approfondir, et qui ne sera bien connu qu’au grand jour où tous les secrets seront dévoilés. Quoi qu’il en soit, il se sentit forcé de lui dire que cette religion dont elle voyait les rites et les serviteurs était celle du Christ.
— Mais quels sont ces rites ? demanda Immalie. Font-ils aussi mourir leurs enfants ou leurs parents pour prouver qu’ils aiment leur Dieu ? Les suspendent-ils dans des corbeilles pour périr, ou les exposent-ils sur les bords des rivières pour être dévorés par des animaux féroces et hideux ?
— La religion qu’ils professent leur défend cela, dit l’étranger, en prononçant à regret des paroles de vérité. Elle leur ordonne, au contraire, d’honorer leurs parents, de soigner leur progéniture.
— Et pourquoi ne repoussent-ils pas de devant leur temple ceux qui ne pensent pas comme eux ?
— Parce que leur religion leur dit d’être charitables, bienveillants et tolérants. Ils doivent chercher à instruire ceux qui n’ont point encore atteint la pureté de sa lumière ; mais ils ne doivent ni les rejeter, ni les dédaigner.
— Ils n’immolent donc pas à leur Dieu des victimes humaines ?
— Non : car ils savent que Dieu ne peut être bien servi que par des cœurs purs, et des mains exemptes de crimes. Ils savent que la dévotion seule est préférable aux cérémonies les plus imposantes et les plus terribles, et que les temples les plus orgueilleux, élevés en l’honneur de sa divinité, seront réduits en poussière, tandis qu’un cœur simple et humilié brûlera éternellement sur son autel ; holocauste agréable, et dont les feux ne s’éteindront jamais.
Pendant qu’il parlait, contraint peut-être par un pouvoir supérieur, Immalie inclinait, en rougissant, son visage contre terre, et puis le relevant avec le regard d’un ange nouveau-né, elle s’écria :
— Le Christ sera mon Dieu ! Je veux être chrétienne !
Elle s’inclina de nouveau avec cette profonde humilité qui indique à la fois la soumission du corps et de l’âme, et elle resta assez longtemps dans cette position. Quand elle se releva, elle chercha l’étranger… Il n’y était plus.
XXII
L’étranger interrompit pendant quelque temps ses visites ; et quand il revint, elles semblaient n’avoir plus le même but. Il n’essayait plus de corrompre les principes d’Immalie, de fausser son jugement, ou de l’induire en erreur au sujet de la religion. Il gardait même un profond silence sur ce dernier sujet, et paraissait regretter de l’avoir jamais touché. Toute l’avidité qu’elle témoignait pour s’instruire, toute la confiante importunité de ses manières ne purent obtenir de lui un mot de plus sur ce sujet. Il l’en dédommagea néanmoins amplement, en déployant devant elle l’instruction riche et variée d’un esprit qui paraissait avoir recueilli plus de connaissances, que l’expérience humaine n’aurait pu en réunir dans le cours d’une longue vie. Cette circonstance n’étonna pourtant pas Immalie ; elle ne faisait aucune attention au temps, et l’anecdote d’hier ou les annales des siècles passés étaient contemporaines pour son esprit auquel les faits, les dates, les coutumes diverses et la suite des événements étaient également étrangers.
Ils s’asseyaient souvent le soir sur le rivage, où Immalie avait soin de préparer un siège de mousse pour son ami, et ils contemplaient ensemble en silence la vaste étendue des mers : car l’intelligence d’Immalie nouvellement réveillée sentait ce besoin d’expressions qu’un sentiment profond imprime à l’esprit le plus cultivé, et qui dans elle était augmenté à la fois par sa pureté et par son ignorance. Quant à l’étranger, il avait peut-être des raisons plus fortes encore pour garder le silence. Ce silence était cependant souvent interrompu ; pas un vaisseau ne se montrait dans l’éloignement qui ne devînt l’occasion d’une question dans la bouche d’Immalie et d’une réponse courte et évasive de la part de l’étranger. Ses connaissances étaient cependant immenses, et depuis le simple canot indien, jusqu’aux vaisseaux énormes et mal dirigés des Rajahs, ou bien aux rapides navires des Européens, qui venaient, comme les dieux de l’Océan, apporter la fertilité, la science, les découvertes des arts et les bienfaits de la civilisation, partout où ils jetaient l’ancre, il aurait pu tout lui décrire ; il aurait pu lui indiquer la destination de chacun de ces vaisseaux ; les sentiments, les mœurs et les usages nationaux de leurs divers équipages ; enfin lui donner une instruction que des livres ne lui auraient jamais procurée : car la conversation est, sans contredit, le moyen le plus sûr de bien enseigner.
Il est possible que cet être extraordinaire, à l’égard duquel les lois de la mortalité et les sentiments de la nature étaient également suspendus, éprouvât dans la société d’Immalie une espèce de repos triste et vague, qui lui faisait oublier la destinée qui le poursuivait d’une manière inévitable. Nous ne savons et nous ne saurons jamais quels furent les sentiments que lui inspira sa bonté innocente et sans soutien ; mais il est du moins certain qu’il cessa de la regarder comme sa victime, et que, pendant les moments qu’il passait auprès d’elle, écoutant ses questions et y faisant des réponses, il semblait jouir des seuls intervalles de bonheur qui furent accordés à son existence sombre et douloureuse. En s’éloignant d’elle, il rentrait dans le monde pour tenter les malheureux.
Loin d’elle, son but était tel qu’on l’a décrit, mais en sa présence, ce but paraissait suspendu. Il la regardait souvent avec des yeux dont l’éclat sauvage et féroce se noyait dans des larmes qu’il s’empressait d’essuyer pour la regarder de nouveau. Tandis qu’il reposait à côté d’elle sur les fleurs qu’elle avait cueillies pour lui, tandis qu’il contemplait ses lèvres de roses qui n’attendaient qu’un signal de lui pour parler, comme des boutons qui n’osent s’ouvrir avant que le soleil brille sur eux, tandis qu’il écoutait des accents impossibles à définir, il penchait la tête, essuyait de son front quelques gouttes d’une sueur glacée, et oubliait pour un moment la marque ineffaçable que, nouveau Caïn, il portait partout avec lui. Mais bientôt la tristesse profonde et habituelle de son âme s’emparait encore de lui. Il sentait la dent du reptile qui ne cessait de le ronger, et la chaleur de cette flamme qui ne s’éteignait jamais. Il tournait l’éclat fatal de ses grands yeux gris, sur le seul être que leur expression n’eût jamais fait frémir, parce que son innocence la rendait inaccessible à la crainte. Il la regardait attentivement pendant que la rage, le désespoir et la pitié déchiraient tour à tour son cœur. Une larme d’humanité mouillait son œil ; mais soudain il détournait ses regards et les portait sur le vaste Océan, comme s’il avait voulu embrasser le monde entier et trouver dans l’aspect de la vie humaine un aliment au feu qui consumait ses entrailles. Cet Océan si pur et si calme qui s’étendait devant eux, n’avait jamais réfléchi deux physionomies plus différentes, ou inspiré à deux cœurs des sentiments plus opposés. Immalie y puisait cette douce et délicieuse rêverie que la nature inspire à des cœurs innocents. Eux seuls peuvent jouir véritablement de la terre, de l’Océan et du ciel.
À l’étranger cette vue causait des idées bien différentes. Il la contemplait comme un tigre regarde une forêt remplie d’une proie abondante. Son imagination lui offrait à la fois des naufrages sans nombre, et le vaisseau, qui, poursuivant sa route par le vent le plus favorable et le ciel le plus pur, touchait soudain un rocher à fleur d’eau, et sombrait dans une mer calme, contraste délicieux pour son âme féroce. Parfois il se contentait de regarder les navires à mesure qu’ils passaient devant ses yeux, et de se dire que chacun d’eux renfermait une ample cargaison de malheurs et de crimes. Il réfléchissait surtout aux vaisseaux européens qui s’approchaient, tout remplis des passions et des vices d’un autre monde, pour trafiquer d’or, d’argent et des âmes des hommes, pour arracher à ces climats tous leurs riches produits, en refusant aux habitants le riz dont ils ont besoin pour soutenir leur chétive existence ; enfin, pour rapporter avec eux, en Europe, des constitutions minées, des passions enflammées, des cœurs ulcérés et des consciences qui ne peuvent plus dormir dans l’obscurité.
Tels étaient les objets qu’il cherchait à distinguer ou à deviner ; et un soir, après qu’Immalie lui eut fait des questions réitérées sur les vaisseaux qu’elle apercevait au loin sur les eaux, il lui fit la description du monde à sa manière, c’est-à-dire dans un esprit de sarcasme, de malignité et d’impatience que lui inspirait la vue de son innocente curiosité. Dans l’ébauche qu’il lui fit de la société, il y avait un mélange d’atroce amertume, d’ironie et d’affreuse vérité, tel qu’Immalie l’interrompit souvent par des cris d’étonnement, de douleur et d’effroi.
Quand il eut cessé de parler, Immalie garda pendant quelque temps le silence, méditant, avec tristesse et mélancolie, sur ce qu’elle venait d’entendre. L’amère ironie de son langage n’avait fait aucune impression sur elle, car elle n’en avait pu saisir le sens détourné ; elle avait seulement compris qu’il avait été beaucoup question de malheurs et de souffrances, mots inconnus pour elle avant qu’elle l’eût vu, et, par un regard, elle parut à la fois lui rendre grâce et lui faire des reproches de l’avoir initiée aux pénibles mystères d’une nouvelle existence. Elle venait de goûter de l’arbre de science, ses yeux étaient ouverts ; mais elle en avait trouvé le fruit amer, et ses regards témoignaient une douce et triste reconnaissance, bien faite pour déchirer le cœur qui venait de donner la première leçon de douleur à celui d’un être si beau, si doux, si plein d’innocence. L’étranger remarqua cette expression, et jouit de son triomphe.
En lui faisant ainsi un tableau exagéré des vices de la société, peut-être avait-il voulu la détourner du désir de la contempler de plus près ; peut-être entretenait-il une espérance vague de la garder dans cette solitude, où il pourrait parfois la voir, et respirer, dans l’atmosphère de pureté qui régnait autour d’elle, le seul zéphyr qui rafraîchit le désert brûlant au sein duquel s’écoulait son existence. Cette espérance acquit un nouveau degré de force, quand il vit l’impression que son discours avait faite sur elle. L’ardente intelligence, l’avide curiosité, la vive reconnaissance qui s’y peignaient, en avaient toutes disparu, pour ne plus offrir qu’un regard baissé et des yeux pensifs et pleins de larmes.
— Ma conversation vous a-t-elle ennuyée, Immalie ? demanda-t-il.
— Elle m’a affligée, répondit l’Indienne, et cependant je voudrais vous écouter encore. J’aime à entendre le murmure du ruisseau, quoique je sache que le crocodile se cache souvent sous ses eaux.
— Vous désireriez peut-être de rencontrer des habitants de ce monde si plein de crimes et de malheurs ?
— Je le désire en effet, car c’est de ce monde que vous êtes venu, et quand vous y retournerez, chacun sera heureux, excepté moi.
— Est-il donc en mon pouvoir de contribuer au bonheur des hommes ? Est-ce pour cela que j’erre au milieu d’eux ?
Une expression horrible et indéfinissable de dérision, de malveillance et de désespoir se peignit sur ses traits quand il ajouta :
— Vous me faites trop d’honneur en m’attribuant une occupation si agréable et surtout si conforme à mes goûts.
Immalie, qui avait détourné les yeux, ne remarqua pas cette expression, et elle répondit :
— Je ne sais comment il se fait ; mais vous m’avez appris à tirer de la joie du sein même de la douleur. Avant de vous avoir vu, je ne faisais que sourire ; maintenant je pleure, et ces larmes sont délicieuses. Oh ! elles sont bien différentes de celles que je versais pour le soleil couchant ou pour la rose qui se fanait ; et cependant, je ne sais…
Ici la pauvre Indienne, oppressée par des émotions qu’elle ne pouvait ni comprendre ni expliquer, posa ses deux mains jointes sur sa poitrine comme pour cacher le secret de ses nouvelles palpitations, et avec un instinct de pureté dont elle ne se rendait pas compte, elle s’éloigna de quelques pas, et baissa vers la terre des yeux dont des larmes s’échappaient malgré elle. L’étranger parut troublé, une émotion, à laquelle il n’était pas accoutumé, l’agita pour un moment ; puis il sourit dédaigneusement, comme s’il s’était reproché de s’être livré même pour un moment à un sentiment humain. Un instant d’après, sa physionomie s’adoucit de nouveau en contemplant les regards baissés et détournés d’Immalie. Il paraissait capable de sentir la douleur, et cependant toujours prêt à se faire un jeu de celle des autres. Ce contraste du désespoir qui se cache sous le masque de la frivolité se rencontre assez souvent. Le sourire est l’enfant du bonheur, mais une gaîté factice règne souvent sur le front de l’être profondément malheureux. Telle fut l’expression de l’étranger quand se tournant vers Immalie, il lui dit :
— Mais que signifie ce discours ?
Une longue pause suivit cette question : enfin l’Indienne répondit :
— Je ne sais, avec cet art délicieux de la nature qui apprend aux femmes à peindre leurs sentiments par des mots qui semblent dire tout le contraire de ce qu’ils expriment.
Je ne sais pas signifie, je ne sais que trop bien.
L’étranger la comprit et jouissant d’avance de son triomphe, il ajouta :
— Et pourquoi vos larmes coulent-elles, Immalie ?
— Je n’en sais rien, dit la pauvre Indienne, et ses larmes n’en coulèrent que plus fort.
À ces mots, ou plutôt à ces pleurs, l’étranger s’oublia pour un moment. Il sentait ce douloureux triomphe dont le vainqueur ne peut jouir ; ce triomphe qui annonce une victoire remportée sur la faiblesse des autres, aux dépens d’une faiblesse plus grande encore de notre cœur. Un sentiment d’humanité remplit, en dépit de lui-même, son âme, et il dit avec des accents d’une douceur involontaire :
— Que voudriez-vous donc que je fisse, Immalie ?
La difficulté qu’elle éprouvait à parler un langage qui fût à la fois intelligible et réservé, qui pût faire connaître ses désirs, sans trahir son cœur et la nature inconnue de ses nouvelles émotions, firent qu’Immalie balança longtemps avant de pouvoir répondre.
— Restez avec moi, dit-elle à la fin, ne retournez pas dans ce monde de maux et de chagrins. Ici les fleurs seront toujours fraîches, et le soleil aura toujours le même éclat que le jour où je vous vis pour la première fois. Pourquoi voulez-vous retourner dans le monde pour penser et être malheureux ?
Le rire sauvage et discordant que son interlocuteur lâcha à ces paroles, la fit frémir et la rendit muette.
— Pauvre enfant ! s’écria-t-il avec ce mélange d’amertume et de compassion qui effraye et qui humilie à la fois : « Est-ce là la destinée que je dois accomplir ? Est-ce à moi à prêter l’oreille au gazouillement des oiseaux, à guetter le bouton qui s’épanouit ? Est-ce là mon sort ? »
Il poussa encore un éclat de rire barbare et rejeta loin de lui la main qu’Immalie lui avait tendue en cessant de parler.
— Oui, sans doute ! Je suis bien fait pour un pareil sort et pour une pareille compagne ! Dites-moi, ajouta-t-il avec une férocité toujours croissante, dites-moi, si ce sont mes traits, ma voix ou mes discours qui vous ont inspiré l’idée de m’insulter en m’offrant dans l’avenir l’espérance du bonheur ?
Immalie, sans comprendre le fond de ce qu’il disait, eut assez de fierté virginale et de pénétration féminine pour comprendre que l’étranger la repoussait. Un sentiment de douleur et d’indignation lutta contre la tendresse de son cœur dévoué. Elle garda le silence un moment, puis, retenant ses larmes, elle dit du ton le plus ferme :
— Allez donc vers votre monde, puisque vous voulez être malheureux. Partez. Hélas ! il n’est pas nécessaire d’aller là pour être malheureux, car je le suis ici. Allez ; mais prenez avec vous ces roses, car elles se flétriront quand vous serez parti ; prenez avec vous ces coquillages, car je n’aurai plus le plaisir à les porter quand vous ne les verrez plus.
Pendant qu’elle parlait, elle détachait avec une action simple mais énergique, les fleurs et les coquillages dont ses cheveux et son sein étaient ornés, et elle les jetait à ses pieds ; puis, le regardant avec une douleur fière et mélancolique, elle s’éloignait, quand il s’écria :
— Restez, Immalie, restez, et écoutez-moi pour un moment. Peut-être dans ce moment aurait-il dévoilé le secret profond et inconcevable qui enveloppait sa destinée ; mais Immalie secoua tristement la tête dans un silence que sa profonde douleur rendait éloquent, et se retira.
XXIII
Plusieurs jours s’écoulèrent avant que l’étranger revînt visiter l’île. Il serait impossible à l’homme de découvrir quelles furent, dans cet intervalle, ou ses occupations, ou ses sensations. Peut-être que parfois il triomphait dans les maux qu’il avait infligés, et que parfois aussi il y compatissait. Poussé enfin ou par la malignité, ou par la tendresse, ou par la curiosité, ou par l’ennui d’une vie artificielle, avec laquelle la pure existence d’Immalie formait un contraste si parfait, il retourna dans l’Ile Enchantée, nom qu’elle avait reçu des Indiens du voisinage ; mais il lui fallut traverser bien des sentiers que nul pied humain n’avait encore foulés, bien des ruisseaux où nul pied n’avait trempé, avant qu’il pût découvrir le lieu où Immalie s’était cachée.
Elle n’avait cependant pas eu l’intention de se dérober à ses regards. Quand il la trouva, elle était appuyée contre un rocher. À ses pieds, l’Océan faisait retentir son murmure éternel. Elle avait choisi le site le plus sauvage qu’elle avait pu trouver. Il n’y avait près d’elle ni fleurs, ni buissons. Les seuls objets qui l’entouraient étaient les masses de rocs calcinés par l’action des volcans et les flots dans lesquels son pied se baignait, en paraissant à la fois inviter et mépriser le danger dont ils le menaçaient. La première fois que l’étranger l’avait vue, elle était environnée de fleurs et de parfums. Tout ce que la nature végétale et animale offre de plus brillant ; des roses et des paons semblaient lutter entre eux à qui répandrait sur elle un éclat plus vif et un baume plus délicieux. Aujourd’hui, elle paraissait abandonnée par la nature dont elle était l’enfant chéri. Elle reposait sur le rocher, et semblait avoir l’Océan pour lit. Elle n’avait ni coquillages dans son sein, ni roses dans ses cheveux ; son caractère paraissait changé avec ses sentiments. Elle n’aimait plus ce qu’il y avait de plus beau dans la nature. On eût dit que, prévoyant sa destinée, elle voulait d’avance se familiariser avec ce qu’elle avait de plus triste et de plus lugubre. Elle commençait à aimer les rochers et l’Océan, le murmure des flots et la stérilité des sables, objets mélancoliques dont la seule vue nous rappelle la douleur et l’éternité.
Ceux qui aiment peuvent chercher les délices des jardins, et s’enivrer des parfums qui semblent être les offrandes de la nature sur l’autel qui brûle déjà dans leur cœur ; mais que ceux qui ont aimé s’égarent sur les rivages de l’Océan : ils y entendront aussi une voix qui leur répondra.
Immalie, dans la solitude, avait un air morne et troublé qui semblait à la fois exprimer le conflit de ses émotions intérieures, et réfléchir la tristesse et l’agitation des objets physiques qui l’entouraient : car la nature préparait une de ces horribles convulsions, une de ces agonies intempestives qui servent à annoncer, pour l’avenir, une colère plus complète, et qui, par la destruction de la nature animée sur un espace limité, proclame, dans les roulements de son tonnerre, qu’un jour viendra où le monde entier sera détruit de même, et où s’accomplira la promesse terrible que cette dévastation partielle s’est bornée à prédire.
La soirée était sombre ; d’épais nuages obscurcissaient l’horizon, du levant au couchant. Un azur pâle brillait au haut des cieux, et ressemblait à l’éclat des yeux d’un mourant. Pas un souffle ne ridait la surface de la mer ; les feuilles se penchaient sans qu’un zéphyr vînt les soulever ; les oiseaux s’étaient retirés, guidés par cet instinct qui leur apprend à éviter le terrible combat des éléments. L’aile abattue et la tête penchée, ils se cachaient dans les branches de leurs arbres favoris. La nature, dans ses grandes et terribles opérations, ressemble à un juge qui garde un silence profond, quelques moments avant de prononcer la terrible sentence qui va sortir de sa bouche implacable.
Immalie considérait le spectacle effrayant qui l’environnait sans aucune émotion née de causes physiques. Jusqu’alors le jour et les ténèbres avaient été la même chose pour elle. Elle aimait le soleil à cause de sa lumière durable, et la foudre pour son éclat passager. L’Océan lui plaisait par son retentissement sonore, et la tempête par l’agitation qu’elle causait aux feuilles des arbres ; enfin, elle aimait le repos de la nuit et la douce lumière des étoiles.
Telle, du moins, elle avait été jadis. Cette fois, son œil se fixait sur le jour qui baissait pour faire place à l’obscurité, à cette obscurité contre nature qui semblait dire aux plus beaux ouvrages de la Divinité : Retirez-vous ; vous ne brillerez plus.
Les ombres s’épaississaient, et les nuages, semblables à une armée qui a réuni toutes ses forces, se préparaient à combattre les rayons épais de lumière qui brillaient encore dans le ciel. Une seule bande large et d’un
rouge obscur bordait l’horizon. Le murmure des eaux augmentait, et le tronc du manglier frémissait, tandis que ses branches enracinées semblaient vouloir abandonner la terre à laquelle elles s’étaient unies. En un mot, la nature, par toutes les voix que pouvaient lui prêter la terre, les airs et les eaux, annonçait à ses enfants un danger imminent.
Ce fut là le moment que l’étranger choisit pour s’approcher d’Immalie. Il était insensible au danger, et ne connaissait point la crainte. Sa misérable destinée l’avait mis à l’abri de l’un et de l’autre : mais que lui avait-elle laissé ? Une seule espérance, celle de plonger les autres hommes dans sa propre condamnation. Une seule crainte, celle de voir sa victime lui échapper. Cependant, malgré sa cruauté diabolique, il ne put s’empêcher de sentir un mouvement de componction en apercevant la jeune Indienne. Ses joues étaient pâles, mais son œil était fixe, et sa figure détournée, comme si elle avait préféré la tempête à ses regards, semblait dire : Puissé-je tomber dans les mains de Dieu plutôt que dans celle des hommes !
Cette attitude qu’Immalie avait prise sans aucune intention, et qui n’exprimait nullement ses véritables sentiments, rendit au cœur de l’étranger toute sa malignité naturelle. Ses projets cruels et ses désirs habituellement sombres et diaboliques reprirent tout leur empire. En voyant le contraste de l’innocence sans secours au milieu des convulsions de la nature, il éprouva le même sentiment de plaisir qu’il ressentait quand, au moyen de la puissance surnaturelle qui lui avait été départie, il pénétrait dans les cabanes des fous ou dans les cachots de l’Inquisition. Il semblait se dire que la foudre qu’il était prêt à diriger contre le cœur de cet être si pur, était plus sûre que celle des nuages qui brillaient autour d’elle.
Armé de toute sa perversité et de toute sa puissance, il s’approcha d’Immalie, qui n’était défendue que par sa pureté. Il y avait, entre sa personne et sa position, un contraste qui aurait touché tout autre que l’Homme errant. L’éclat de sa figure brillait au milieu de l’obscurité qui l’environnait ; et sa douceur était rendue plus remarquable encore par la sévérité du rocher contre lequel elle s’appuyait.
L’étranger s’approcha sans être aperçu. Le murmure des flots et des vents couvrait le bruit de ses pas : mais, en s’avançant il entendit des sons qui l’étonnèrent. Il s’arrêta pour les écouter. C’était la pauvre Indienne, qui, sans connaître et sans craindre son danger, chantait aux échos de la tempête une espèce d’hymne sauvage de désespoir et d’amour. En voici quelques strophes :
« La nuit devient plus obscure ; mais cette obscurité qu’est-elle auprès de celle que son absence a répandue sur mon âme ? Les éclairs brillent autour de moi ; mais que sont-ils auprès de l’éclat de son œil quand il m’a quittée en courroux?
« Je n’ai vécu que dans la lumière de sa présence ; pourquoi ne mourrai-je pas quand cette lumière m’est ôtée ? Courroux des nuages, qu’ai-je à craindre de vous ? Vous pouvez me réduire en poussière, comme je vous l’ai vu faire aux branches des arbres ; mais le tronc restait, et mon cœur sera toujours à lui.
« Mugissez, terrible mer ; vos flots, que je ne puis compter, n’effaceront point son image de mon cœur. Mon cœur restera ferme comme le rocher,
même au sein des calamités de ce monde dont il me menace, de ce monde dont, sans lui, je n’aurais jamais connu les dangers, et que je suis prête à braver pour lui.
« Quand nous nous rencontrâmes pour la première fois, mon sein était couvert de roses ; aujourd’hui, je les rejette loin de moi. Quand il me vit la première fois, tous les êtres vivants m’aimaient ; maintenant leur amour m’est indifférent, je ne sais plus les aimer. Quand il venait tous les soirs me voir, je désirais que la lune brillât ; maintenant je la vois sans regret se cacher dans les nuages. Avant qu’il fût venu tout m’aimait, et j’aimais toute la nature ; maintenant je sens que je ne puis aimer qu’un objet et cet objet m’a abandonnée. Depuis que je l’ai vu tout a changé de face. Les fleurs n’ont plus leurs brillantes couleurs ; le murmure des eaux est moins doux ; les étoiles ne me sourient plus du haut des cieux, et moi-même je commence à préférer la tempête au calme. »
En terminant son chant sauvage, elle voulut quitter le lieu où la fureur toujours croissante de la tempête ne lui permettait plus de rester, quand, en se retournant, elle vit les yeux de l’étranger fixés sur elle. À cet aspect, elle rougit, et ne fit point entendre le cri de joie avec lequel elle avait l’habitude de le recevoir ; mais elle le suivit, d’un pied chancelant et en détournant la tête, jusqu’aux ruines de la pagode, où il lui faisait signe de venir chercher un asile contre le courroux des éléments.
Ils s’en approchèrent en silence ; et il était étrange de voir, au milieu des convulsions de la nature, deux êtres marcher ensemble sans prononcer un mot de crainte, sans éprouver un sentiment d’inquiétude. L’un était armé par son désespoir ; l’autre par son innocence. Immalie aurait préféré l’abri de son bananier favori ; mais l’étranger essaya de lui faire comprendre qu’elle y courrait plus de danger que dans le lieu qu’il lui indiquait.
— Du danger ! s’écria l’Indienne avec un sourire vague, mais enchanteur ; en puis-je courir quand vous êtes auprès de moi ?
— N’y a-t-il donc point de danger en ma présence ? Bien peu de personnes m’ont vu sans en craindre et même sans en éprouver.
Pendant qu’il parlait ainsi, son front se couvrait de nuages plus sombres que ceux qui obscurcissaient le ciel.
— Immalie, ajouta-t-il d’une voix que rendait plus pénétrante l’émotion inusitée qui remplissait son cœur, Immalie, vous ne pourriez être assez faible pour me croire en état de commander aux éléments ? Si je l’étais ; j’en atteste ce ciel qui me contemple avec colère, le premier acte de mon pouvoir serait de choisir sa foudre la plus prompte et la plus meurtrière pour vous clouer à la place où je vous vois.
— Moi ! répéta l’Indienne tremblante, et pâlissant plutôt de ses paroles et du ton dont il les prononçait que de la fureur redoublée de la tempête.
— Oui, oui, vous ; malgré toute votre amabilité, votre innocence, votre pureté ! Et ce serait pour empêcher qu’un feu bien plus ardent ne consume votre existence et ne tarisse la source de votre sang ; pour que vous ne soyez plus exposée à un danger mille fois plus funeste que celui dont les éléments vous menacent, le danger de ma maudite et misérable présence !
Immalie ne sachant ce qu’il voulait dire, mais compatissant à l’agitation qu’il paraissait éprouver, s’approcha de lui pour calmer, s’il était possible,
une émotion dont elle ne pouvait deviner ni le nom ni la cause. Pâle, échevelée, les mains jointes, on eût dit qu’elle demandait pardon d’un crime qu’elle ignorait. Tout autour d’elle était sauvage et terrible. La terre était jonchée de fragments de pierres et de décombres, tandis que la voûte entr’ouverte donnait passage par moments à des éclats d’une lumière terrible plus effrayante que les ténèbres. Au sein de cette désolation, elle semblait un ange descendu du ciel avec un message de réconciliation qu’elle apportait en vain.
L’étranger lui lança un de ces regards qu’aucun œil mortel, autre que le sien, n’avait encore pu contempler sans effroi ; mais son expression ne fit qu’inspirer à la victime un dévouement plus complet. Peut-être un sentiment de terreur involontaire se mêlait-il à cette expression, lorsque cette belle créature se jeta aux pieds de son ennemi désespéré, et le supplia par son silence, plus éloquent que des paroles, d’avoir pitié de lui-même. Toutes ses sensations semblaient concentrées sur l’objet mal choisi de leur idolâtrie. Tout en elle indiquait cette soumission que le cœur d’une femme éprouve pour les fautes, les passions, les crimes même de l’objet qu’elle aime. Immalie s’était d’abord inclinée devant celui qu’elle aimait dans l’espoir de le fléchir ; elle s’était ensuite mise à genoux en restant loin de lui. Elle finit par saisir sa main ; et la pressa de ses lèvres décolorées. Elle voulut prononcer quelques paroles, mais ses larmes, qui baignaient la main qu’elle tenait, l’en empêchèrent, tout en s’expliquant pour elle. Cette main lui fit, dans le premier moment, une réponse en serrant la sienne avec un mouvement convulsif ; mais l’étranger ne tarda pas à la rejeter loin d’elle. Elle restait effrayée et prosternée devant lui.
— Immalie, dit l’étranger avec effort, désirez-vous que je vous explique les sentiments que ma présence devrait vous inspirer ?
— Non, non, non, dit l’Indienne en appliquant ses mains blanches et délicates, d’abord à ses oreilles et puis à sa poitrine, je ne les sens que trop.
— Haïssez-moi, maudissez-moi, dit l’étranger, sans faire attention à ce qu’elle venait de dire, et frappant du pied avec violence : haïssez-moi, car je vous hais. Je hais tout ce qui existe, tout ce qui n’est plus ; je suis moi-même haï et haïssable !
— Ce n’est pas moi qui vous hais, dit la pauvre Indienne en tâtonnant à travers ses larmes, pour saisir sa main qu’il éloignait.
— Vous me haïriez comme les autres, si vous saviez qui je suis et qui je sers.
Immalie appela à son secours toute l’énergie du cœur et de l’esprit qu’elle venait nouvellement d’acquérir, pour répondre à cette observation.
— Je ne sais qui vous êtes ; mais je suis à vous. Je ne sais qui vous serez ; mais, qui que ce soit, je le servirai aussi. Je veux être à vous pour toujours. Abandonnez-moi si vous voulez ; mais quand je serai morte, revenez dans cette île, et dites en vous-même : les roses ont fleuri et se sont fanées ; les ruisseaux ont coulé et se sont desséchés ; les rochers ont été déplacés et les astres dans le ciel ont changé leurs cours ; mais il existait un cœur qui n’a jamais changé et il n’est point ici !
— Immalie ! dit l’étranger.
Elle le regarda, et, avec un mélange d’étonnement et de douleur, elle vit couler des larmes de ses yeux. L’instant d’après, il les essuya avec un geste de désespoir, et grinçant des dents, il poussa un éclat de ce rire
convulsif, qui indique que nous sommes nous-mêmes l’objet de notre raillerie. Immalie, que ses sensations avaient fatiguée à l’excès, tremblait en silence à ses pieds.
— Écoutez-moi, malheureuse fille ! s’écria-t-il d’un ton où la malignité se mêlait à la compassion, et une inimitié habituelle à une douceur involontaire ; écoutez-moi. Je connais le sentiment secret contre lequel vous luttez mieux que le cœur innocent qui le renferme. Bannissez ce sentiment, détruisez-le. Écrasez-le comme vous feriez d’un jeune reptile avant que le temps l’ait rendu aussi dégoûtant que venimeux.
— Je n’ai jamais de ma vie écrasé de reptile, dit Immalie.
— Vous aimez donc, dit l’étranger ; mais ajouta-t-il, après une longue et fatale pause, savez-vous quel est l’être que vous aimez ?
— C’est vous, dit l’Indienne, avec cette sincérité de l’innocence, qui rend sacrée l’impulsion à laquelle elle cède, et qui rougirait plutôt des faussetés de l’art, que de la confiance de la nature : c’est vous ! Vous m’avez appris à penser, à aimer, à pleurer.
— C’est donc pour cela que vous m’aimez ! Songez pour un moment, Immalie, à l’indignité de l’objet auquel vous prodiguez les trésors de votre sensibilité. Il n’a rien d’attrayant dans son extérieur. Ses habitudes sont même repoussantes. Il est séparé de la vie et de l’humanité par un abîme impossible à franchir. C’est un enfant déshérité par la nature, qui erre au loin pour tenter ou pour maudire ses frères plus heureux que lui ; un être qui… Mais qu’est-ce qui m’empêche de vous tout dévoiler ?
Dans ce moment un éclair d’une vivacité telle qu’aucun œil humain n’en aurait pu supporter l’éclat, brilla à travers les ruines et répandit une lumière affreuse. Immalie éprouva un effroi et une émotion involontaires. Elle tomba sur ses genoux et couvrit de ses mains ses yeux éblouis et souffrants.
Elle demeura ainsi pendant quelques moments et crut entendre parler à côté d’elle ; il lui semblait que l’étranger répondait à une voix qui lui adressait la parole. Elle distingua les mots suivants au bruit du tonnerre qui roulait dans le lointain :
— Cette heure est à moi et non à toi… va-t-en, et ne m’importune pas. Quand elle leva les yeux, toute apparence d’émotion avait fui loin des
traits de l’étranger. L’œil sec et brûlant du désespoir qu’il fixait sur elle semblait n’avoir jamais connu une larme. La main avec laquelle il la saisit semblait n’avoir jamais renfermé de sang, son attouchement était froid comme celui de la mort.
— Miséricorde ! s’écria l’Indienne en tremblant, et en cherchant vainement un sentiment d’humanité dans des yeux que les siens invoquaient, baignés de larmes. Miséricorde !
En prononçant ce mot elle ne savait ni ce qu’elle demandait, ni ce qu’elle craignait.
L’étranger ne répondit rien ; pas un de ses muscles ne se relâcha. On eût dit qu’il la serrait de ses mains sans la sentir, qu’il la regardait sans la voir. Il la porta ou plutôt il la traîna jusqu’à cette vaste arcade qui avait servi autrefois d’entrée à la pagode, mais qui, dans l’état de délabrement où elle se trouvait ressemblait plutôt à la bouche d’une caverne, demeure des habitants du désert, qu’au travail de l’homme, consacré par lui au culte de la divinité.
— Vous avez imploré la miséricorde, lui dit son compagnon d’une voix qui glaça son sang, malgré la chaleur étouffante de l’atmosphère. Vous avez imploré la miséricorde et vous l’aurez. Je n’en ai point trouvé, mais j’ai recherché mon affreuse destinée ; ma récompense est juste et assurée. Lève les yeux, femme tremblante : lève les yeux, je te l’ordonne.
Obéissant à ses ordres, elle écarta de ses yeux les longues tresses de cheveux dont elle venait de balayer en vain le rocher empreint des pas de celui qu’elle adorait. Avec la docilité d’un enfant et la douce soumission d’une femme, elle essaya de faire comme il lui disait ; mais ses yeux remplis de larmes ne purent supporter l’horreur du spectacle qui l’entourait. Elle essuya ses yeux brillants avec une chevelure qui se baignait chaque jour dans le cristal des eaux, et tandis qu’elle s’efforçait de fixer ses regards sur la désolation de la nature, elle ressemblait à un esprit céleste, forcé de contempler les effets de la colère du Tout-Puissant, dont il adore les derniers résultats quoique ses opérations lui soient inintelligibles.
Immalie s’approcha donc des ruines et pour la première fois elle frémit en contemplant la nature. Jadis tous ses phénomènes lui avaient paru également terribles ou sublimes. L’éclat du soleil ou la sombre horreur de l’orage contribuaient également à la dévotion involontaire du cœur le plus pur. Mais depuis qu’elle avait vu l’étranger, de nouvelles émotions avaient rempli ce jeune cœur. Elle avait appris à pleurer et à craindre, et peut-être voyait-elle dans l’aspect effrayant des cieux le développement de cette terreur mystérieuse qui se cache toujours au fond du cœur de ceux qui osent aimer.
— Immalie, s’écria l’étranger, est-ce ici le lieu, est-ce le moment de parler d’amour ? La nature entière tremble, le ciel est obscurci, les animaux se cachent, les buissons mêmes frémissent, comme s’ils partageaient la terreur générale.
— C’est le moment d’implorer une protection puissante, dit Immalie en s’attachant à lui avec timidité.
— Levez les yeux, reprit l’étranger, tandis que les siens, fixes et sans émotion, semblaient répondre par un éclair à chaque trait que lançait la foudre ; levez les yeux, et, si vous n’avez pas la force de résister aux mouvements de votre cœur, permettez-moi du moins de vous en indiquer un objet plus convenable.
— Aimez, ajouta-t-il en étendant les bras vers les cieux livides et troublés, aimez l’orage dans toute sa force destructive. Unissez-vous à ces voyageurs rapides et périlleux des airs, à la foudre qui les déchire, au tonnerre qui les ébranle ! Cherchez un abri tutélaire sous ces épais nuages, sous ces montagnes des cieux dont les bases ne reposent sur rien ! Cherchez pour compagnon, pour amant, tout ce que la nature a de plus terrible ; suppliez-les de vous réduire en cendres ; périssez dans leurs cruels embrasements, et vous serez plus heureuse, bien plus heureuse que si vous aviez vécu dans les miens. Vécu, que dis-je ? Oh ! qui peut être à moi et continuer à vivre ? Écoutez-moi, Immalie, écoutez-moi !
En faisant cette apostrophe, il prit ses mains dans les siennes ; ses yeux, fixés sur elle, brillaient d’un éclat plus vif même qu’à l’ordinaire, tandis qu’un nouvel enthousiasme semblait pour un moment ébranler et donner un ton inusité à tout son être.
— Si vous voulez être à moi, il faut que ce soit au milieu d’une scène comme celle-ci ; au sein des flammes et des ténèbres, au sein de la haine et du désespoir, au sein…
Sa voix n’était déjà plus qu’un cri diabolique de rage et d’horreur ; il étendait les bras comme pour lutter contre quelque objet que lui présentait son imagination, et il allait s’élancer du lieu où il s’était placé avec Immalie, poursuivi par le tableau que ses crimes et son désespoir avaient tracé, et par les images qu’il était condamné à contempler pour jamais.
Par ce mouvement soudain, la douce Immalie, perdant son appui, se trouva étendue à ses pieds. Sa voix était étouffée par la crainte, mais elle n’en conservait pas moins ce dévouement complet que le cœur d’une femme sait seul éprouver, et, à ses plus effrayantes questions, elle se contentait de répondre :
— Serez-vous là ?
— Oui, la je dois être et pour jamais ! Et voudriez-vous, oseriez-vous y être avec moi ?
Une sauvage et terrible énergie donnait à sa voix une force extraordinaire, pendant qu’il adressait ces mots affreux à l’être aimable qui, étendu à ses pieds, semblait une tourterelle fascinée qui s’élance dans le bec du vautour.
Une légère convulsion agita les traits livides de l’étranger, et il ajouta :
— Eh bien donc ! au milieu du tonnerre, je t’épouse, fiancée de la perdition ! tu seras à moi pour toujours ! Viens, répétons nos vœux sur l’autel chancelant de la nature : les foudres du ciel seront nos cierges, et la malédiction de l’univers sera notre bénédiction nuptiale.
L’Indienne jeta un cri d’effroi, non à ses discours qu’elle ne comprenait pas, mais à l’expression qui les accompagnait.
— Viens, répéta-t-il, afin que les ténèbres soient les témoins de notre union mémorable et éternelle !
Immalie, pâle, effrayée, mais ferme, s’éloigna de lui.
Dans cet instant, l’orage, qui avait obscurci les cieux et ravagé la terre, se dissipe, avec la rapidité ordinaire dans ces climats où ces terribles phénomènes ne durent que peu de moments, et sont bientôt remplacés par le ciel le plus pur et le plus brillant. À mesure que l’étranger parlait, les nuages s’entr’ouvaient, et la lune apparut bientôt avec un état inconnu au ciel de l’Europe. La jeune Indienne trouva, dans cette circonstance, un présage aussi favorable à son imagination qu’à son cœur. Elle s’arracha d’auprès de l’étranger, et s’élançant dans la lumière de la nature, dont l’éclat pouvait se comparer à la promesse de la rédemption, brillant au sein des ténèbres de la chute de l’homme, elle montra du doigt la lune, ce soleil des nuits de l’Orient, dont la lumière large et argentée couvrait, comme d’un manteau de gloire, les rochers et les ruines, les arbres et les fleurs.
— Épousez-moi à cette lumière, s’écria-t-elle, et je serai à vous pour toujours !
Sa physionomie céleste réfléchissait la lumière de la belle planète qui poursuivait sa course dans un ciel sans nuage ; tandis que ses bras blancs et nus qu’elle étendait vers la lune semblaient deux témoins sans tache de leur union.
— Épousez-moi à cette lumière, répéta-t-elle en se mettant à genoux, et je serai à vous pour toujours !
Tandis qu’elle parlait, l’étranger s’approcha d’elle avec des sentiments qu’aucune pensée humaine ne pénétrera jamais. Dans ce moment, un léger phénomène vint changer sa destinée. Un nuage obscur couvrit, pour un instant, la lune. On eût dit que l’orage se hâtait de recueillir les derniers restes de sa fureur passée, pour s’évanouir ensuite à jamais.
Les yeux de l’étranger se fixèrent sur Immalie avec un mélange affreux de tendresse et de férocité. Il montra les nuages, et dit :
— Épousez-moi par cette lumière, et vous serez à moi aux siècles des siècles !
Immalie frémit en sentant sa main qui la saisissait avec force. Elle essaya vainement de découvrir l’expression de sa physionomie, mais elle comprit assez son danger pour s’arracher de ses bras.
— Adieu, pour jamais ! s’écria l’étranger en s’éloignant d’elle à son tour.
Immalie, épuisée par l’émotion et la terreur, était tombée, privée de sentiment, sur un des monticules de décombres qui couvraient le sentier de la pagode ruinée. L’étranger revint ; il la souleva dans ses bras ; ses longs cheveux noirs les couvraient ; elle n’avait plus de mouvement ; sa joue froide et décolorée s’appuyait sur son épaule.
— Est-elle morte ? murmura-t-il tout bas. Eh bien ! soit ! qu’elle périsse ! qu’elle meure mille fois plutôt que d’être à moi !
En disant ces mots, il replaça son immobile fardeau sur les décombres, et quitta l’île pour n’y plus rentrer.
XXIV
Trois ans s’étaient écoulés depuis la séparation d’Immalie et de l’étranger, quand, un soir, l’attention de quelques gentilshommes espagnols qui se promenaient dans une allée du Prado de Madrid, se fixa sur une personne qui passait auprès d’eux. Ses vêtements étaient ceux du pays, mais il ne portait point d’épée, et marchait fort lentement. Ils s’arrêtèrent avec un tressaillement simultané, et parurent se demander, l’un l’autre, par leurs regards, quelle avait été la cause de l’impression que l’apparition de cet individu avait faite sur eux. Il n’y avait rien de remarquable dans sa figure. Il marchait tranquillement, mais c’était l’expression singulière de sa physionomie qui les avait frappés d’une sensation qu’aucun d’eux ne pouvait expliquer.
Ils étaient encore à la même place, quand l’inconnu repassa devant eux, marchant toujours avec la même lenteur, et ils rencontrèrent de nouveau cette singulière expression dans les traits, et surtout dans les yeux, qu’aucun regard humain ne pouvait contempler sans frémir. Accoutumés à considérer des objets révoltants pour la nature et pour l’homme, parcourant sans cesse les hospices des aliénés, les prisons de l’Inquisition, les cavernes de la faim, les cachots du crime ou le lit de mort du désespoir, ils avaient contracté un éclat et un langage qui leur étaient propres : un éclat que nul ne pouvait envisager, un langage que peu d’hommes auraient osé comprendre.
Ces gentilshommes observèrent deux autres personnes dont l’attention paraissait, comme la leur, fixée sur le même objet : car elles le montraient du doigt, et se parlaient à voix basse avec des gestes qui indiquaient une émotion forte et évidente. La curiosité du groupe vainquit, pour une fois, la réserve espagnole ; et, s’approchant des deux cavaliers, on leur demanda si l’étrange personnage qui venait de passer devant eux n’avait pas été le sujet de leur conversation, et la cause de l’émotion qui avait marqué leurs discours.
Ils répondirent affirmativement, et ajoutèrent qu’ils étaient instruits de certaines circonstances du caractère et de l’histoire de cet être extraordinaire, qui pouvaient justifier des marques d’émotion plus fortes encore à son aspect. Ces paroles augmentèrent la curiosité des passants, et le groupe devint plus nombreux. Quelques personnes savaient, ou prétendaient savoir des détails sur ce sujet remarquable, et il s’entama une de ces conversations vagues dont la matière principale se compose d’ignorance, de curiosité et de frayeur, mêlées à quelque peu de vérités et de connaissances positives ; de ces conversations peu satisfaisantes, mais qui ne manquent pas d’intérêt ; où chaque interlocuteur est bien aise de contribuer pour sa part aux bruits, aux conjectures, aux anecdotes, d’autant plus facilement crues qu’elles sont plus incroyables, et aux conclusions d’autant plus convaincantes qu’elles sont plus fausses.
Voici de quoi donner une idée de cette conversation.
— Mais quoi ! dit l’un des interlocuteurs : s’il est réellement ce que l’on pense, ce que l’on assure qu’il est, pourquoi ne l’arrête-t-on pas ? Pourquoi l’Inquisition ne s’en empare-t-elle pas ?
— Il a déjà souvent été dans les prisons du Saint-Office, répondit un second ; plus souvent peut-être que les révérends pères ne l’eussent voulu.
— Le fait est cependant certain, qu’il a toujours été délivré sur-le-champ. Un quatrième ajouta que cet inconnu avait été enfermé, tour à tour, dans toutes les prisons de l’Europe, mais qu’il avait toujours trouvé moyen de mettre en défaut la puissance qui paraissait le tenir dans ses mains. Au moment même où l’on croyait qu’il expiait ses crimes dans un pays, il en commettait déjà de nouveaux dans un autre.
— Sait-on quelle est sa patrie ? demanda quelqu’un.
— Il est originaire de l’Irlande, répondit-on, pays peu connu, et où, par divers motifs, ses habitants ne restent qu’avec répugnance. Il s’appelle Melmoth.
Un des interlocuteurs qui paraissait en savoir plus que les autres, leur fit part de la promptitude inconcevable avec laquelle cet étranger se transportait d’un pays à l’autre, promptitude qui surpassait tous moyens humains. Il leur raconta aussi, que sa coutume était de rechercher partout les êtres les plus misérables et les plus vicieux, sans que l’on pût deviner le motif qu’il avait pour se plaire dans leur société. Comme il achevait de parler, une voix grave frappa les oreilles des personnes rassemblées. Elle prononça ces mots :
— Ce motif est bien connu d’eux et de lui.
Le jour était baissé, ce qui n’empêchait pas que l’on distinguât fort bien la figure de l’étranger. Quelques personnes assurèrent même qu’elles avaient observé l’éclat remarquable de ses yeux, qui ne brillaient jamais sur la destinée des hommes que comme des planètes de malheur. Le groupe s’arrêta pendant quelque temps pour guetter le départ de cette figure, qui avait produit sur elle l’effet d’une torpille. Elle s’éloigna lentement ; personne ne tenta de l’arrêter.
? J’ai entendu dire, observa quelqu’un, que la musique la plus délicieuse précède l’approche de cette personne quand elle se trouve près de la victime qu’il lui est permis de tenter ou de tourmenter. Parfois, cette musique n’est sensible que pour la victime seule ; dans d’autres moments, les assistants peuvent l’entendre aussi. On m’en a fait les relations les plus étonnantes… La Sainte Vierge Marie nous protège !… Avez-vous jamais ouï de pareils sons ?
— Il n’est pas étonnant, dit un jeune fat de la société, que l’approche d’une créature aussi céleste que celle que j’aperçois soit annoncée par des sons délicieux.
Comme il parlait, tous les yeux se tournèrent vers une jeune femme qui, placée au milieu d’un groupe de personnes charmantes, les surpassait toutes par l’élégance de sa taille et sa marche noble, gracieuse et aisée. Elle ne cherchait point à attirer les regards ; mais les regards s’arrêtaient tous sur elle, sans pouvoir s’en détacher. En vain ses compagnes faisaient-elles usage de toutes les armes que leur fournissait la coquetterie pour fixer l’attention des cavaliers ; il y en avait une dont les armes n’étaient point artificielles : elles n’étaient formées que du contraste de ses attraits singuliers et simples, avec l’arrangement étudié des autres. Quand elle s’éventait, c’était vraiment pour se rafraîchir ; quand elle arrangeait son voile, c’était pour couvrir sa figure ; quand elle ajustait sa mantille, c’était pour cacher cette taille, dont la rare perfection n’était pas déguisée même par la volumineuse draperie qui la couvrait. Les hommes les plus dissolus ne pouvaient la contempler qu’avec un respect involontaire ; les infortunés trouvaient de la consolation à la regarder ; les vieux songeaient à leur jeunesse, et les jeunes éprouvaient pour la première fois ce sentiment qui seul mérite le nom d’amour, parce que la pureté seule peut l’inspirer ou le récompenser.
Nous avons déjà remarqué combien ses mouvements étaient gracieux et aisés. En effet, ils avaient tous une élasticité, un ressort, une vitalité, qui faisaient que chacune de ses actions était l’expression d’une pensée. Elle s’en apercevait soudain, et les efforts qu’elle faisait pour cacher ce qu’elle avait annoncé malgré elle, découvraient un nouveau charme à des sensations ainsi dévoilées. Autour d’elle régnait cet éclat d’innocence, de majesté, qui ne se trouve jamais uni que dans son sexe. Les hommes peuvent conserver longtemps sur leurs traits l’expression de la puissance que la nature leur a départie ; mais celle de l’innocence tarde peu à s’oblitérer.
Au milieu de toutes les grâces vives et un peu extraordinaires d’une figure qui semblait ne connaître d’autres lois que celles qu’elle s’était imposées à elle-même, régnait une teinte de mélancolie qui, aux yeux d’un observateur superficiel, aurait pu paraître passagère ou affectée ; mais qui, à d’autres, offrait la preuve que tandis que toute l’énergie de son intelligence était occupée et tout l’instinct de sa raison éveillé, son cœur était encore vide et demandait un habitant.
Le groupe de cavaliers, qui avait été occupé à causer de l’étranger, se sentit irrésistiblement attiré à la vue de cet objet. Leurs chuchotements craintifs se changèrent en exclamations de plaisir et d’étonnement en voyant passer cette femme charmante. À peine avait-elle fait quelques pas pour s’éloigner, que l’on vit l’étranger se retourner lentement : les femmes le rencontrèrent. Son regard fixe en choisit une seule sur laquelle il s’attacha. Elle le vit, le reconnut, jeta un grand cri et tomba par terre privée de sentiment.
Le tumulte occasionné par cet accident que tout le monde avait vu, sans que personne en pût deviner la cause, détourna pendant quelques instants, l’attention, qui cessa de se porter sur l’étranger. Chacun s’occupait d’assister la jeune dame ou de demander de ses nouvelles. On s’empressa de la porter dans sa voiture, et au moment où elle y fut placée, une voix, non loin d’elle, prononça le mot d’Immalie ! Elle reconnut cette voix et se retourna, avec un regard d’angoisse et un faible cri, vers le côté d’où elle était partie. Ceux qui l’entouraient l’avaient entendue comme elle ; mais ne comprenant pas le sens du mot et ne sachant pas à qui il s’adressait, ils attribuèrent l’émotion de la jeune dame à son indisposition. La voiture partit et l’étranger la suivit des yeux. Bientôt la société se dispersa : il resta seul. Les ombres s’épaississaient ; il ne paraissait pas remarquer ce changement. Un petit nombre de personnes, qui ne l’avaient pas perdu de vue, continuaient à se promener pour l’observer. Il ne les aperçut pas. L’un de ceux qui restèrent le plus longtemps dit qu’il lui avait vu faire un geste comme pour essuyer ses yeux. Les larmes de la pénitence lui étaient à jamais prohibées. Était-ce donc la passion qui aurait fait couler celles-là. Dans ce cas, malheur à l’objet de cette passion !
XXV
Le lendemain, la jeune personne, qui avait excité tant d’intérêt, devait quitter Madrid pour passer quelques semaines dans un château peu éloigné de la capitale, et qui appartenait à sa famille. Cette famille se composait de sa mère, dona Clara d’Aliaga, épouse d’un riche négociant, que l’on attendait d’un moment à l’autre de retour des Indes ; de son frère don Fernand d’Aliaga, et d’un grand nombre de domestiques : car ces riches citoyens, fiers de leur opulence et de la noblesse de leurs ancêtres, se piquaient de voyager avec autant de lenteur et de cérémonie que le premier grand du royaume. Aussi le vieux et lourd carrosse s’avançait gravement comme un corbillard. Le cocher dormait sur le siège, et les six chevaux noirs ne changeaient jamais leur pas solennel et mesuré. Fernand d’Aliaga et les domestiques étaient à cheval à côté de la voiture, dans laquelle s’étaient placées dona Clara et sa fille.
Dona Clara était une femme d’une humeur grave et d’un caractère froid. Elle avait toute la solennité d’une Espagnole et toute l’austérité d’une dévote. Don Fernand offrait l’union des passions vives et des mœurs austères, assez commune parmi les habitants de l’Espagne. Son orgueil triste et personnel était blessé quand il se rappelait que sa famille avait dérogé en se livrant au commerce ; et il regardait l’extrême beauté de sa sœur comme le moyen le plus probable de recouvrer son rang par une alliance avec une famille illustre ; il la contemplait avec cette partialité, mêlée d’égoïsme, aussi peu honorable pour celui qui l’éprouve que pour celle qui l’inspire.
C’était au milieu de pareils êtres que la vive et sensible Immalie, la fille de la nature, était condamnée à voir flétrir la fleur d’une existence transplantée dans un climat si étranger pour elle. Sa singulière destinée semblait ne l’avoir éloignée d’un désert physique que pour la placer dans un désert moral. Sa dernière position était peut-être plus triste encore que la première.
Il est certain que le point de vue le plus lugubre n’offre rien d’aussi glaçant que l’aspect de figures humaines, sur lesquelles nous cherchons vainement à découvrir une expression qui réponde à ce que nous sentons. La stérilité de la nature est de l’abondance quand on la compare à celle d’un cœur qui communique sa désolation à tout ce qui l’entoure.
Il y avait déjà quelque temps qu’ils étaient en route, quand dona Clara, qui ne parlait jamais qu’après une longue préface muette, sans doute pour donner une espèce de poids à ce qui, sans cela n’en aurait eu aucun, dit du ton d’un oracle :
— Ma fille, on m’a appris que vous vous étiez trouvée mal hier au soir dans une promenade publique : auriez-vous rencontré quelque objet qui vous ait surprise ou effrayée ?
— Non, Madame.
— Quelle a donc pu être la cause de l’émotion que vous avez témoignée… m’a-t-on dit… car je n’en ai aucune connaissance… à la vue d’un personnage d’une apparence extraordinaire ?
— Oh ! je ne puis, je n’ose vous le dire, répondit Immalie en baissant son voile sur sa figure rougissante.
Puis tout à coup, l’irrépressible ingénuité de sa première nature reprenant tout son empire sur elle, elle se laissa glisser du coussin où elle était assise et embrassant les genoux de dona Clara, elle s’écria :
— Ô ma mère ! je vous dirai tout.
— Non, dit dona Clara, en la repoussant avec toute la froideur de l’orgueil offensé ; non, cela n’est pas nécessaire. Je ne recherche point une confiance qu’on me retire et qu’on me rend tout d’une haleine. Je n’aime pas non plus ces émotions violentes. Elles sont indignes d’une jeune fille. Rien n’est plus simple que vos devoirs d’enfant. Ils consistent en une parfaite obéissance, une soumission profonde et un silence non interrompu, à moins que la parole ne vous soit adressée par moi, par votre frère ou par le père Jozé. Certes, il n’est point de devoirs plus faciles. Levez-vous donc et cessez de pleurer ; si votre conscience est troublée, le père Jozé ne manquera pas de vous infliger une pénitence proportionnée à votre faute.
Après ce discours, dona Clara, qui n’en avait jamais autant dit à la fois, se reposa sur son coussin et commença à défiler son chapelet avec la plus grande dévotion. Elle s’endormit ensuite d’un sommeil profond dont elle ne se réveilla que quand la voiture arriva à sa destination.
Il était midi, et le dîner servi dans un appartement de plain-pied avec le jardin, n’attendait que l’arrivée du père Jozé, confesseur de dona Clara et de dona Isidora sa fille. Il ne tarda pas à se présenter. C’était un homme d’une figure imposante, monté sur une mule majestueuse. À la première vue ses traits portaient l’empreinte d’une profonde méditation ; mais quand on l’examinait de plus près, ces traces semblaient plutôt le résultat de sa conformation physique que d’un exercice intellectuel. Le lit était tracé, mais les eaux n’y avaient point été dirigées. En attendant, bien que son éducation eût été défectueuse et que son esprit fût un peu resserré, le père Jozé était un honnête homme, dont les intentions étaient pures. Il aimait le pouvoir et il était dévoué aux intérêts de l’Église, mais il frémissait quand il entendait parler des flammes d’un auto-da-fé.
Le dîner était terminé ; les plus beaux fruits et les vins les plus recherchés venaient d’être placés devant le père Jozé, quand dona Isidora, après une profonde révérence à sa mère et à l’ecclésiastique se retira, selon sa coutume dans son appartement.
— C’est l’heure de la sieste, observa le père Jozé.
— Non, mon père, non, dit dona Clara d’un air triste, sa femme de chambre m’assure qu’elle ne se retire pas pour dormir. Elle s’est, hélas ! trop bien accoutumée à l’ardeur du climat où elle fut perdue dans son enfance, pour sentir la chaleur comme nous. Non, elle ne se retire ni pour dormir, ni pour prier, selon la pieuse coutume des dames espagnoles. Je crains que ce ne soit pour…
— Pour quoi ?… interrompit le prêtre avec effroi.
— Pour réfléchir, pour penser ; car j’ai souvent observé, à son retour, des traces de larmes sur sa figure. Je tremble, mon père, qu’elle ne regrette ce pays d’idolâtres, ce domaine de Satan, où elle a passé sa jeunesse.
Le bon ecclésiastique demanda à sa dévote pénitente quelques détails sur la manière d’être d’Isidora, sur ses discours, ses amusements et ses occupations. Dona Clara lui donna tous ceux qu’elle avait pu recueillir, entremêlant son discours d’exclamations continuelles sur la crainte que lui inspirait le salut de sa fille. Le père s’efforça de la tranquilliser, il promit d’entretenir la jeune personne, de lui imposer quelques légères pénitences pour occuper son esprit, et assura dona Clara que, confiée à ses soins et à sa direction, elle ne pouvait courir aucun danger. Quand cette conversation importante fut terminée, le père Jozé ajouta :
— Et maintenant, ma fille, quand votre fils don Fernand, qui sans doute ne se livre pas comme sa sœur à la réflexion, aura achevé sa sieste, veuillez lui faire dire que je suis prêt à continuer la partie d’échecs que nous avons commencée il y a quatre mois. J’avais poussé mon pion jusqu’à l’avant-dernière case, il ne me fallait plus qu’un coup pour arriver à dame.
— La partie a-t-elle donc duré si longtemps ? dit dona Clara.
— Si longtemps ! s’écria l’ecclésiastique, elle aurait pu durer bien plus longtemps encore : nous n’avons guère joué que trois heures par jour l’un portant l’autre.
La soirée se passa dans un profond silence de la part de tout le monde. Le père et don Fernand faisaient la partie d’échecs ; dona Clara travaillait à sa tapisserie et dona Isidora, assise à la fenêtre ouverte, contemplait l’éclat de la lune, respirait le parfum de la tubéreuse et guettait l’épanouissement de la belle de nuit. Ces objets lui rappelaient tous les charmes que la nature avait répandus jadis sur son existence. L’azur foncé du ciel et la lumière brillante de la planète, qui y régnait en souveraine, auraient pu faire lutter la beauté de cette nuit avec l’éclat incomparable de celles des Tropiques. Un songe délicieux la ramenait par moments à l’île enchantée dont elle avait été si longtemps la reine et la divinité. Une seule image y manquait : une image, dont l’absence changeait également en un désert ce paradis insulaire et tous les charmes d’un jardin espagnol éclairé par le plus beau clair de lune. Cette image, elle ne pouvait espérer de la rencontrer que dans son cœur. Ce n’était que dans la solitude la plus profonde qu’elle osait parfois se répéter à elle-même et son nom et ces airs pittoresques de son pays qu’il lui avait appris à chanter dans les moments où son humeur prenait une teinte de douceur. Le contraste entre sa vie passée et présente était si grand ; elle se sentait tellement vaincue par la contrainte et la froideur ; on lui avait si souvent répété que tout ce qu’elle faisait, disait ou pensait, était mal, qu’elle commençait à renoncer au témoignage de ses sens, et qu’elle se persuadait que les visites de l’étranger n’avaient été que des visions qui avaient répandu à la fois le trouble et la joie sur une existence tout à fait illusoire.
— Je suis surpris, ma sœur, dit don Fernand qui était de très mauvaise humeur de la tournure défavorable que la partie avait prise pour lui, je suis fort surpris que vous ne vous occupiez jamais, comme tant de jeunes filles, à travailler à l’aiguille ou bien à faire quelques autres ouvrages féminins.
— Ou bien à lire quelques livres de piété, dit dona Clara, en levant pour un moment ses yeux de sa tapisserie et les y laissant retomber sur-le-champ. Il y a la légende de ce saint Polonais né comme vous dans une terre de ténèbres… il s’appelait… révérend père, j’ai oublié son nom.
— Échec au roi, dit le père.
— Vous ne songez qu’à cultiver quelques fleurs, à jouer du luth ou à regarder la lune, continua don Fernand, vexé du succès de son adversaire et du silence de dona Isidora.
— Elle fait beaucoup d’aumônes et de grandes œuvres de charité, dit le bon prêtre. J’ai été appelé dernièrement dans une misérable chaumière, non loin de votre château, dona Clara, pour visiter un pêcheur mourant sur la paille. Je ne faisais que remplir mon devoir ; mais votre fille y était avant moi. Elle s’y était rendue sans qu’on l’y eût appelée et je l’entendis prononcer les consolations les plus tendres et les plus éloquentes… que, par parenthèse, elle avait tirées d’une homélie manuscrite qu’un pauvre prêtre, que je ne nommerai pas, lui avait prêtée.
Isidora rougit à cette petite preuve de vanité, tandis que les taquineries de don Fernand et la froide austérité de sa mère la faisaient alternativement sourire et pleurer.
— Oui, continua le père Jozé, j’entendis tout cela comme je vous le dis, en entrant dans la chaumière, et, je vous le jure par l’habit que je porte, je m’arrêtai avec délices sur le seuil. Ses premiers mots furent… Échec et mat !
Dans son triomphe, le bon père avait oublié jusqu’à son homélie et il s’arrêta, montrant du doigt l’état désespéré du jeu de son adversaire.
— Échec et mat ! répéta dona Clara, sans lever les yeux de dessus son ouvrage.
Avant que le père Jozé pût lui expliquer que cette exclamation n’avait aucun rapport avec l’acte de charité de sa fille, un cri que celle-ci jeta, répandit l’alarme dans le salon. Tout le monde s’empressa autour d’elle ; il s’y joignit quatre femmes de chambre et deux pages. Dona Isidora n’avait pas perdu connaissance. Elle se tenait au milieu de tout ce monde, pâle comme la mort ; muette, ses yeux erraient sur le groupe qui l’environnait, sans en distinguer un seul individu. Elle conservait cependant cette présence d’esprit qui n’abandonne jamais une femme quand il s’agit de garder son secret et elle n’indiquait ni du doigt ni de l’œil la fenêtre où l’objet de sa frayeur s’était présenté. Pressée de mille questions, elle paraissait incapable d’y répondre et refusant toute assistance elle s’appuya sur la croisée pour se soutenir.
Dona Clara s’avançait d’un pas mesuré pour présenter à sa fille un flacon d’essence qu’elle portait toujours dans sa poche, quand une des femmes de chambre qui connaissait les goûts de sa jeune maîtresse, proposa de la ranimer par l’odeur des fleurs. Elle s’empressa donc de cueillir une poignée de roses et les présenta à dona Isidora. La vue et le parfum de ces fleurs magnifiques rappela mille souvenirs du temps passé à l’esprit de l’infortunée. Elle fit un signe de la main pour qu’on les ôtât, et s’écria :
— Il n’y a point ici de roses semblables à celles qui m’entouraient quand il m’aperçut pour la première fois.
— Lui ! qui, ma fille ? dit dona Clara, au comble de l’effroi.
— Expliquez-vous, ma sœur, je vous l’ordonne, dit le fougueux don Fernand. De qui parlez-vous ?
— Elle est dans le délire, dit le prêtre à qui sa pénétration habituelle avait fait découvrir qu’il existait un secret dans cette aventure. Elle est dans le délire, et vous avez tort de l’entourer ainsi, et de la questionner si vivement. Mademoiselle, allez vous reposer, et que les saints veillent sur votre sommeil.
Isidora salua l’ecclésiastique en signe de reconnaissance, et rentra dans son appartement. Le père Jozé resta pendant plus d’une heure avec dona Clara et son fils, pour combattre les craintes de l’une et la sombre susceptibilité de l’autre. Il espérait que leurs discours lui procureraient quelque éclaircissement sur un mystère qu’il voulait dévoiler. Au désir de rendre service à dona Isidora, qui était son véritable motif, se joignait peut-être même à son insu, celui d’augmenter son pouvoir dans la famille par la connaissance de tous ses secrets. Dans le cours de la conversation, il glissa quelques mots pour savoir si dona Clara ne serait pas disposée à consacrer sa fille au service de Dieu. La pieuse mère trouva ce projet merveilleux ; il n’en fut pas de même du frère qui, pour les motifs déjà indiqués, le combattit fortement. N’étant point parvenu à convaincre dona Clara ni le confesseur, il exigea de celui-ci qu’il n’en fût plus question jusqu’au retour de son père, ce qui lui fut accordé sans peine.
Dona Clara passa en prières la plus grande partie de la nuit, et ne se coucha que quand le zéphyr frais du matin lui permit d’espérer un peu de repos.
Isidora ne dormait pas davantage. Ainsi que sa mère, elle s’était prosternée devant l’image sacrée de la Vierge, mais avec des pensées bien différentes. Son existence, qui se composait de contrastes perpétuels entre les objets présents et les souvenirs du passé, la différence entre ce qu’elle voyait et ce qu’elle sentait, entre la vie pleine de sensations que lui offrait sa mémoire, et celle trop monotone qu’elle coulait, tout cela surpassait les forces d’un cœur trop plein d’une sensibilité que rien ne dirigeait, et d’une tête étourdie par des vicissitudes auxquelles même un esprit plus fort que le sien n’aurait pu résister.
Après avoir répété les prières habituelles qu’elle adressait à la Mère du Sauveur, elle sentit le besoin d’épancher son cœur devant elle, et elle commença à l’implorer en des discours dictés par ses seuls sentiments.
— Être doux et céleste, s’écria-t-elle en s’agenouillant devant l’image, vous qui seule n’avez cessé de me sourire depuis mon arrivée dans votre terre chrétienne, vous dont j’ai cru parfois que la physionomie représentait celle des êtres qui demeuraient dans les étoiles de mon ciel indien, écoutez-moi et ne soyez pas en courroux. Souffrez que je perde tout sentiment de mon existence présente, ou bien tout souvenir de celle qui est passée. Pourquoi ces pensées reviennent-elles me poursuivre ? Elles faisaient jadis mon bonheur ; maintenant elles me percent le cœur. Pourquoi conservent-elles leur pouvoir, puisque leur nature est changée ? Je ne puis plus redevenir ce que j’étais : laissez-moi donc l’oublier. Laissez-moi, s’il est possible, voir, sentir et penser comme ceux qui m’entourent. Je sens qu’il est plus facile de descendre jusqu’à eux, que de les élever jusqu’à moi. Non, Mère de Dieu ! femme divine et mystérieuse ! ils ne seront plus témoins des émotions de mon cœur brûlant. Il se consumera dans sa propre flamme, avant que leur froide compassion contribue à l’éteindre ! Ô Mère divine ; un cœur brûlant n’est-il pas la plus digne offrande que je puisse vous présenter ? L’amour de la nature ne s’assimile-t-il pas à l’amour de Dieu ? Nous pouvons, à la vérité, aimer sans religion, mais nous ne pouvons avoir de la religion sans aimer. Pourquoi faut-il que je pense, que je sente, puisque la vie n’exige que des devoirs qu’aucun sentiment n’inspire, qu’une apathie qu’aucune réflexion ne trouble ? Oui, oui, aidez-moi à bannir de mon âme toute autre image que la sienne. Que mon cœur soit comme cet appartement solitaire, éclaire par cette lumière seule que l’amour a placée devant l’objet de son adoration, et qui seule y brûle à jamais.
Dona Isidora, dont l’enthousiasme était monté au plus haut point, restait à genoux devant l’image de la Vierge, et quand elle se leva, le silence qui régnait dans sa chambre, et le sourire calme qui brillait sur les traits de cette figure céleste, semblèrent lui reprocher l’excès de sensibilité auquel elle s’était livrée. Ce sourire paraissait une marque de courroux. Il est certain que quand nous sommes très émus, nous ne trouvons point de consolation à contempler des traits qui n’expriment qu’une tranquillité profonde. Nous aimerions mieux une émotion aussi forte que la nôtre, fût-elle même dans un sens opposé. Tout nous paraît préférable à un calme qui nous absorbe et nous neutralise. C’est la réponse du rocher à la vague, qui se brise en écumant contre son pied, sans qu’il en ressente le moindre ébranlement.
Telles étaient les sensations d’Isidora, qui s’appuya sur sa croisée, pour tâcher de respirer un souffle d’air, que l’atmosphère brûlante lui refusait. Elle songeait que pendant une pareille nuit, dans son île indienne, elle se serait plongée dans le ruisseau qu’ombrageait son tamarin chéri ; peut-être même se serait-elle risquée dans les flots tranquilles et argentés de l’Océan ; mais alors, elle venait d’achever la cérémonie du bain : car elle pouvait, avec raison, appeler une cérémonie, ce qui avait autrefois été un plaisir enchanteur. Les savons, les parfums, les éponges, et surtout les secours des femmes qui la servaient, lui avaient donné de la répugnance pour ce qui jadis lui avait paru si délicieux. Ni le bain, ni la prière n’avaient calmé ses sens agités. Elle chercha de l’air à sa croisée, et le chercha vainement. La lune brillait au haut des cieux avec autant d’éclat que le soleil dans des climats plus froids. En comparant la beauté du ciel avec la triste uniformité des parterres et des bosquets peignés qui s’étendaient à ses pieds, Isidora pleura. Les larmes étaient devenues son langage chaque fois qu’elle était seule ; elle n’osait s’en servir en présence de sa famille. Tout à coup elle vit une des allées, que la lune éclairait, obscurcie par l’approche d’une figure humaine. Elle s’avança ; elle prononça son nom, ce nom qu’elle reconnaissait et qu’elle aimait, celui d’Immalie !
— Ah ! s’écria-t-elle, en mettant la tête hors de la fenêtre, y a-t-il encore quelqu’un qui me connaisse sous ce nom ?
— C’est le seul sous lequel je puis vous adresser la parole, répondit une voix qui était celle de l’étranger. Je n’ai pas encore l’honneur de connaître celui que vos amis chrétiens vous ont donné.
— Ils me nomment Isidora ; mais continuez toujours à m’appeler Immalie.
Tout à coup, tremblante pour la sûreté de l’étranger, et sa crainte surmontant sa joie innocente et pure, elle ajouta :
— Mais comment se fait-il que vous soyez ici, dans ce lieu où il n’entre jamais personne que les habitants de la maison ? Comment avez-vous fait pour passer par-dessus le mur du jardin ? Comment êtes-vous venu des Indes ? De grâce, retirez-vous, votre sûreté en dépend. Je suis entourée de personnes auxquelles je ne puis me fier et que je ne puis aimer. Ma mère est sévère ; mon frère est violent. Oh ! comment êtes-vous entré dans le jardin ? Comment avez-vous pu courir de si grands risques pour voir une personne que vous aviez depuis si longtemps oubliée ?
Elle prononça ces derniers mots à voix basse. L’étranger répondit avec un air moqueur et plein de malignité.
— Belle néophyte, charmante chrétienne, sachez que les verroux, les barreaux et les murailles ne m’embarrassent pas plus que les rochers et les brisants de votre île indienne. Je puis aller où je veux et me retirer à mon gré, sans demander la permission aux chiens de basse-cour de votre frère ou à ses pièges ; je me moque également de l’avant-garde de duègnes de votre mère, armées de leurs lunettes et flanquées d’un double rang de batteries de rosaires avec des grains aussi gros que…
— Chut, chut ! Ne prononcez pas ces mots impies ; on m’a appris à respecter ces objets sacrés. Mais est-ce bien vous ? Était-ce encore vous que j’ai vu hier au soir, ou bien n’était-ce qu’une de ces visions que m’offrent parfois mes songes quand je m’imagine être encore dans l’île bienheureuse où pour la première fois… Oh ! pourquoi vous ai-je jamais vu ?
— Aimable chrétienne, accoutumez-vous à votre affreuse destinée. Vous m’avez en effet vu hier au soir. Deux fois j’ai visité la route où vous brilliez, la plus éclatante et la plus belle de tout Madrid. C’est moi que vous avez vu ; j’ai fixé votre œil ; j’ai percé votre sein léger comme l’aurait fait un éclair ; vous tombâtes flétrie et sans connaissance sous mon regard brûlant. Oui, c’est moi que vous avez vu, moi, qui déjà avait troublé votre angélique existence dans ce paradis insulaire, moi qui vous poursuis même au sein de l’existence factice que vous avez embrassée.
— Que j’ai embrassée !… Oh non : ils m’ont saisie, entraînée ici ; ils m’ont dit que c’était pour mon bonheur présent et à venir.
— Je le crois bien ; et n’êtes-vous pas heureuse ? Votre corps délicat n’est plus exposé à l’intempérie des éléments. Votre goût si raffiné est flatté par mille inventions nouvelles ; votre lit est de duvet ; votre chambre est tendue en tapisserie. Que la lune soit brillante ou obscure, des bougies n’en brûlent pas moins toute la nuit dans votre appartement. Que le ciel soit serein ou couvert de nuages, que la terre soit émaillée de fleurs ou désolée par la tempête, l’art du peintre vous a fourni un nouveau ciel et une nouvelle terre ; et vous pouvez vous réchauffer aux feux d’un soleil qui ne se couche jamais, tandis que le ciel est sombre aux yeux des autres ; ou errer au milieu des paysages et des fleurs, tandis que la moitié de vos semblables périssent au sein des neiges et des ouragans. Vous avez ensuite des êtres raisonnables avec qui vous pouvez causer, au lieu de vos loxias et de vos singes.
— La conversation que j’ai trouvée ici ne m’a pas paru beaucoup plus intelligente ou plus instructive que la leur, dit Isidora à demi-voix.
L’étranger sans faire semblant de l’entendre, continua :
— Vous êtes environnée de tout ce qui peut flatter les sens, enivrer l’imagination ou délecter le cœur. Tous ces plaisirs doivent vous faire oublier la liberté voluptueuse, mais inculte, de votre ancienne existence.
— Les oiseaux dans les cages de ma mère, dit Isidora, ne cessent de becqueter leurs barreaux dorés ; ils foulent aux pieds les semences et l’eau limpide qu’on leur apporte. N’aimeraient-ils pas mieux reposer dans le tronc d’un vieux chêne, et prendre une nourriture plus grossière, plutôt que de se briser le bec contre leur prison magnifique ?
— Vous ne trouvez donc pas que cette nouvelle existence dans ce pays chrétien soit aussi délicieuse que vous vous l’étiez une fois imaginée ? Vous devriez rougir, Immalie, de votre ingratitude et de votre caprice. Vous rappelez-vous quand de votre île indienne, vous entrevîtes de loin le culte chrétien, que cet aspect vous mit dans l’enchantement ?
— Je me rappelle parfaitement tout ce qui s’est passé dans cette île. Jadis je vivais dans l’avenir ; maintenant je vis dans le passé.
— Vous ne vous trouvez donc point heureuse dans ce nouveau monde d’intelligence et de luxe ? dit Melmoth avec une douceur involontaire.
— Oui, quelquefois.
— À quelle occasion ?
— À la fin d’une triste et pénible journée, quand mes songes me ramènent vers cette île enchantée. Le sommeil est pour moi comme une barque, conduite par des rameurs imaginaires, et qui me pousse vers des bords charmants et bienheureux. C’est alors que j’existe de nouveau au milieu des fleurs et des parfums. J’entends la musique des airs et des ruisseaux. Tout vit et tout aime autour de moi. Mes pas sont jonchés de fleurs, et l’onde pure vient encore baiser mes pieds !
— Et dans vos songes, Immalie, ne voyez-vous jamais d’autres images ?
— Je n’ai pas besoin de vous dire, répondit Isidora avec ce singulier mélange de fermeté et de naïveté, résultat de son caractère et des circonstances extraordinaires de sa première existence, je n’ai pas besoin de vous dire que vous êtes avec moi toutes les nuits.
— Moi !
— Oui, vous. Vous êtes toujours dans ce canot qui me porte dans mon île indienne. Vous me regardez ; mais l’expression de votre figure est si changée, que je n’ose vous adresser la parole. Nous traversons les mers dans un instant. Vous tenez toujours le gouvernail, quoique vous ne débarquiez jamais. Aussitôt que mon île se montre à ma vue, vous disparaissez. Quand nous revenons, l’obscurité règne sur l’Océan, et notre course est aussi ténébreuse et aussi prompte que la tempête. Vous me regardez et vous ne parlez jamais. Oh ! oui ! vous êtes avec moi toutes les nuits.
— Mais, Immalie, ce ne sont que des songes, de vaines illusions. Qui ? moi ! vous conduire sur les mers d’Espagne jusqu’aux Indes ! Ce ne sont là que des visions de votre imagination !
— Est-ce donc encore un songe qui m’abuse à présent ? N’est-ce pas à vous que je parle ? Expliquez-vous ; car il me paraît non moins étrange de vous voir en Espagne que d’être dans mon île. Hélas ! dans la vie que je mène à présent, mes songes sont devenus des réalités et les réalités semblent n’être que des songes. Si vous êtes réellement ici, comment se fait-il que vous y soyez ? Comment avez-vous fait pour venir me voir de si loin ? Combien vous avez dû traverser d’océans, combien vous avez dû voir d’îles sans qu’il y en eût aucune de semblable à celle où je vous vis pour la première fois ! Mais est-ce vraiment vous que je vois ? Je croyais vous avoir vu hier au soir ; mais j’aime encore mieux m’en fier à mes songes qu’à mes sens. Je croyais que vous ne visitiez jamais que cette île d’illusions ; seriez-vous réellement un être vivant, un être que je puis espérer de voir dans cette terre de froides réalités ?
— Belle Immalie ou Isidora, ou quelque nom que vos adorateurs indiens ou vos parrains chrétiens vous ont donné, je vous prie de m’écouter, pendant que je vous dévoile quelques mystères.
Et parlant ainsi, Melmoth se jeta sur un lit de jacinthes et tulipes qui déployaient leurs brillantes couleurs et exhalaient leurs parfums délicieux sous la fenêtre d’Isidora.
— Oh ! vous allez détruire mes fleurs, s’écria-t-elle, se rappelant tout à coup les moments heureux où des fleurs étaient à la fois les compagnes de son imagination et de son cœur.
— Je vous prie de me pardonner ; c’est ma vocation, dit Melmoth en se roulant sur les fleurs écrasées et en lançant à Isidora un de ses regards sombres et effrayants. Je suis envoyé pour fouler aux pieds toutes les fleurs du monde physique et moral, n’importe que ce soient des jacinthes, des cœurs ou d’autres bagatelles de ce genre. Et maintenant, dona Isidora, puisqu’il faut vous appeler ainsi, je suis ce soir ici ; demain, je serai… où votre choix m’aura placé. Je vous préviens d’avance que cela m’est égal, soit que vous m’envoyiez aux mers de l’Inde, où vos songes m’ont déjà si souvent expédié, ou bien qu’il me faille briser la glace du pôle, ou bien enfin que je sillonne les flots de cet Océan qu’un jour, jour affreux, qui n’aura ni soleil ni lune, ni commencement ni fin, il me faudra sillonner à jamais pour ne recueillir que le désespoir !
— Paix ! paix ! ne prononcez pas des mots aussi horribles ! Est-ce vous en effet que j’ai vu dans l’île ? Est-ce vous qui depuis ce moment avez fait partie de mes prières, de mes espérances, de mon cœur ? Êtes-vous cet être sur qui je fondais encore mon espoir quand la vie était sur le point de me manquer ? Dans ma traversée pour me rendre à cette terre chrétienne, j’ai beaucoup souffert. J’étais si malade que vous auriez eu pitié de moi. Oh ! vous seul, votre pensée, votre image pouvait me soutenir ! J’aimais, et quand on aime on vit. Privée de cette existence délicieuse qui me parut un songe et qui remplit encore mes songes, en faisant de mon sommeil une seconde existence, j’ai pensé à vous, j’ai rêvé de vous, je n’ai aimé que vous !
— M’aimer !… aucun être ne m’a encore prouvé son amour que par des larmes !
— Et n’en ai-je pas versé ? dit Isidora, croyez-en celles-ci, elles ne sont pas les premières que j’ai répandues, et je crains bien, grâce à vous, qu’elles ne soient pas non plus les dernières.
— En vérité, vous finiriez par m’inspirer de la fatuité, dit le voyageur avec un rire sardonique. Soit : je le veux bien et quand viendra le jour trop heureux, belle Immalie, toujours belle Isidora, en dépit de votre nom chrétien que j’ai bien de la peine à prononcer, ce jour où vous vous réveillerez au milieu des baisers, des rayons de la lumière, de l’amour et de tous les vains ornements dont la folie couvre le malheur avant leur union ?
Il accompagna ce discours de ce rire affreux et convulsif qui unit l’expression de la frivolité à celle du désespoir. La pauvre et timide Isidora lui répondit :
— Je ne vous comprends pas ; et si vous ne voulez pas me priver de ma raison, ne riez plus, ou du moins ne riez plus ainsi.
— Il faut bien que je rie, puisque je ne saurais pleurer, dit Melmoth en fixant sur elle ses yeux secs et brûlants, que le clair de lune rendait plus visibles. Il y a longtemps que la source des larmes est tarie en moi, comme celle de tout autre bonheur humain.
— Je saurai pleurer pour nous deux, dit Isidora, et ses larmes coulaient autant de souvenir que de douleur ; quand ces deux sources s’unissent, Dieu seul et le malheureux savent s’ils coulent en abondance.
— Gardez ces pleurs pour notre heure nuptiale, mon aimable fiancée, dit Melmoth en lui-même, vous n’en aurez pas trop.
Cédant à un sentiment naturel au cœur des femmes, Isidora, d’une voix mal assurée, lui dit :
— Si vous m’aimez, ne me recherchez plus en secret ; ma mère, quoique sévère, est bonne ; mon frère est généreux, quoique susceptible… mon père… je ne l’ai jamais vu ; mais puisqu’il est mon père, il faudra qu’il vous aime. Que je vous retrouve en leur présence, le plaisir que j’éprouve en vous voyant ne sera plus mêlé de douleur et de honte. Invoquez la sanction de l’Église, et alors, peut-être…
— Peut-être ! reprit Melmoth. Vous avez donc déjà appris le peut-être européen ; cet art de suspendre le sens d’un mot significatif, d’affecter de la franchise, au moment où l’on cache de plus en plus les replis de son cœur, de nous mettre au désespoir, au moment où l’on veut que nous espérions !
— Oh non, non ! s’écria l’innocente créature, je suis toute vérité. Je suis Immalie quand je vous parle, quoique pour tout autre, dans ce pays, je sois Isidora. Quand je vous aimai pour la première fois, je n’avais qu’un cœur à consulter ; maintenant il y en a plusieurs, et dans le nombre il y en a bien peu qui ressemblent au mien. Mais si vous m’aimez, vous pourrez vous plier à eux comme je l’ai fait ; vous pourrez aimer leur Dieu, leurs foyers, leurs espérances et leur pays. Même avec vous je ne saurais être heureuse, si vous n’adorez la croix que votre main indiqua la première à ma vue errante, et cette religion que vous confessâtes à regret être la plus belle et la plus bienfaisante de la terre.
— Ai-je confessé cela ? répéta Melmoth, il faut vraiment que je l’aie fait à regret. Belle Immalie, ajouta-t-il en étouffant un rire satirique, vous m’avez converti à votre nouvelle religion, à votre beauté, à votre naissance espagnole, à vos noms ronflants, à tout ce que vous pouvez désirer. Je me présenterai incontinent devant votre pieuse mère, devant votre frère irrité, et devant tous vos parents, quelque susceptibles, fiers ou ridicules qu’ils puissent être. Je leur parlerai, je les flatterai, et quand ils me renverront à votre homme de loi avec ses larges moustaches et son manteau de velours noir râpé, je vous assignerai pour douaire, le plus ample territoire que jamais épouse ait reçu de son époux.
— Oh ! puisse-t-il être situé dans cette terre harmonieuse et brillante où je vous ai vu pour la première fois ! Un seul endroit pour placer mes pieds au milieu de ses fleurs, me serait plus précieux que toute la terre cultivée de l’Europe.
— Non, ce sera dans une région que ces hommes de loi connaissent bien mieux, et à laquelle votre pieuse mère et votre orgueilleuse famille reconnaîtront elles-mêmes mes droits quand je les leur aurai expliqués. Il se peut que d’autres y possèdent des droits indivis avec moi ; et cependant, chose étrange à dire ! ils ne me disputeront jamais mon titre exclusif à sa possession.
— Je ne comprends rien à tout cela, dit Isidora ; mais je sens que je manque aux bienséances imposées à une femme espagnole et chrétienne en causant plus longtemps avec vous. Si vous pensez comme vous faisiez jadis ; si vous sentez comme je dois sentir à jamais, toute cette discussion, qui m’embarrasse et m’effraye, devient inutile. Qu’ai-je à faire de ce territoire dont vous me parlez ? si vous en êtes le possesseur, c’est là son seul prix à mes yeux.
— Ce que vous y avez à faire ! répéta Melmoth. Oh ! vous ne savez pas encore tout ce que vous pouvez avoir à faire avec ce territoire et avec moi ! Par moi, vous vous en assurez l’éternelle possession. Mes héritiers en jouiront aux siècles des siècles, pourvu qu’ils le tiennent au même titre que moi. Écoutez-moi, belle Immalie, ou chrétienne, ou tout autre nom qu’il vous plaira d’adopter, écoutez-moi, pendant que je vous annonce la richesse, la population et la magnificence de cette région dont je veux vous faire le don nuptial. Là, se trouvent tous les chefs de la terre : les héros, les souverains, les tyrans. Là, sont leurs richesses, leur pompe et leur pouvoir. Quelle superbe accumulation ! Ils y ont des trônes et des couronnes, et des piédestaux et des trophées de feu, qui brûlent aux siècles des siècles, et l’éclat de leur gloire y brille éternellement. Là, sont tous ceux dont vous avez lu l’histoire, vos Alexandres, vos Césars, vos Ptolémées et vos pharaons. Là sont les princes de l’Orient, les Nemrods, les Baltasars et les Holophernes de leurs siècles. Là sont les princes du Nord, les Odins, les Attilas, les Alarics, tous ces barbares sans nom, et qui n’en méritent pas, lesquels, sous des titres et des prétextes différents, ont ravagé et désolé la terre qu’ils venaient conquérir. Là, enfin, se trouvent les souverains du Midi, de l’Orient et de l’Occident, les descendants de Mahomet, les califes, les Sarrasins, les Maures avec leurs titres pompeux, leurs prétentions et leurs ornements, le croissant, le Koran et la queue de cheval. Oh ! vous ne manquerez pas de société dans cette brillante région : car elle sera véritablement brillante, et qu’importe que sa lumière provienne du soufre enflammé ou des rayons tremblants de la lune qui vous font paraître si pâle en ce moment ?
— Je suis pâle, dites-vous, répondit Isidora, respirant avec peine, je ne m’en étonne pas. Je ne comprends pas le sens de vos paroles ; mais ce sens doit être horrible : ne me parlez plus de cette région avec son orgueil, ses vices et sa splendeur ! Je suis prête à vous suivre dans des déserts, dans des solitudes qu’aucun pied n’aura foulées que le vôtre, et où le mien, toujours fidèle, suivra la trace de vos pas. Je suis née dans la solitude, et je saurai, s’il le faut, y mourir ; pourvu qu’en quelque lieu que je vive, à quelque époque que je meure, je sois à vous. Pour le lieu, il ne m’importe guère, quand même ce serait !…
Elle frémit involontairement.
— Quand même ce serait… Où ? demanda Melmoth qui éprouvait à la fois un triomphe sauvage à la vue du dévouement de cette infortunée, et un sentiment d’horreur à la destinée qu’elle allait, par ses imprécations, attirer sur elle-même.
— Partout où vous serez, répondit Isidora. Là, je veux être, et là je serai heureuse comme dans l’île des fleurs et du soleil où je vous vis pour la première fois. Oh ! je ne vois plus de fleurs aussi belles et aussi odorantes que celles qui y croissaient ; je n’entends plus la musique de ses ruisseaux et de ses zéphyrs qui me semblaient répéter le son de vos pas !…
— Vous entendrez une musique bien plus parfaite, interrompit Melmoth : vous entendrez les voix de dix mille, que dis-je ? de dix millions d’esprits, dont les tons sont éternels, sans pauses et sans intervalles.
— Ce sera vraiment beau, s’écria Isidora en joignant les mains. Le seul langage que j’aie appris dans ce nouveau monde, et qui mérite qu’on le parle, est le langage de la musique. J’en avais distingué quelques sons imparfaits dans le gazouillement des oiseaux de mon ancien monde ; mais c’est dans celui-ci qu’on me l’apprit véritablement. Le malheur, que j’ai en même temps appris à connaître, balance à peine ce nouvel et délicieux langage.
— Mais songez, reprit Melmoth, si vous avez réellement tant de goût pour la musique, combien vous aurez de jouissances quand vous entendrez ces accents accompagnés et répétés par les torrents de dix mille flots de feu battant contre les rochers auxquels le désespoir éternel a donné la dureté du diamant ! On parle de la musique des sphères ! pensez plutôt à celle de ces orbes vivants, tournant éternellement sur leurs axes de feu, et chantant éternellement pendant qu’ils brûlent, comme ces chrétiens, vos frères, qui servirent à illuminer les jardins de Néron, dans Rome, pendant une nuit de réjouissances.
— Vous me faites trembler !
— Trembler, parce qu’on vous parle de feu ! quelle étrange timidité ! Je vous ai promis que, quand vous arriveriez dans vos nouveaux domaines, vous y trouveriez tout ce qu’il y a de plus grand et de plus magnifique, de plus splendide et de plus voluptueux : le monarque et l’épicurien, un lit de roses et un dais de feu.
— Et c’est là la demeure à laquelle vous m’invitez ?
— Oui, c’est elle ; venez et soyez à moi. Des milliers de voix vous y appellent : écoutez et obéissez-leur ! Ces voix retentissent toutes dans la mienne. Leurs feux brillent dans mes yeux, et brûlent dans mon cœur. Écoutez-moi, Isidora ; ma bien-aimée, écoutez-moi. C’est sincèrement et pour jamais que je vous recherche. Oh ! qu’ils sont frivoles les liens qui unissent des amants mortels, comparés à ceux qui nous uniront tous deux dans l’éternité ! Vous aimez la musique : là, vous entendrez sans doute la plupart des musiciens qui ont existé, depuis Tubalcaïn jusqu’à Lulli. Leur accompagnement sera singulier : ce sera le rugissement éternel d’une mer de feu, formant une basse continue aux chants de millions de chanteurs souffrants !
— Que voulez-vous dire par cette horrible description ? demanda la tremblante Isidora ; vos paroles sont des énigmes pour moi : je ne vous comprends pas.
— Vous ne me comprenez pas ! répéta Melmoth avec un air froidement satirique qui contrastait effroyablement avec la brûlante intelligence qui brillait dans ses yeux ; vous ne me comprenez pas ! N’aimez-vous donc pas la musique ?
— Je l’aime.
— Aimez-vous aussi la danse, ma belle, ma gracieuse amante ?
— Je l’aimais.
— Pourquoi cette différence dans vos réponses ?
— J’aime la musique ; je dois l’aimer à jamais : elle est pour moi le langage du souvenir. Chaque son que j’entends me ramène avec ma chère île : je ne saurais en dire autant de la danse. J’ai appris la danse ; mais j’ai senti la musique. Je n’oublierai jamais la première fois que je l’entendis : je crus que c’était le langage que les chrétiens parlaient toujours entre eux.
— Ces raisons sont assez bonnes ; mais je voudrais savoir si vous n’en avez pas encore d’autres pour aimer la musique, et pour avoir aimé la danse. Si vous en avez, dites-les-moi, de grâce.
— J’aime la musique, parce qu’en l’entendant je pense à vous. J’ai cessé d’aimer la danse, quoiqu’elle m’eût d’abord ravie, parce qu’en dansant il m’est arrivé quelquefois de vous oublier. En votre présence, quoiqu’elle paraisse nécessaire à mon existence, je n’ai jamais éprouvé cette sensation délicieuse que me cause votre image quand la musique l’évoque du fond de mon cœur. La musique me paraît être la voix de la religion qui m’ordonne de me rappeler et d’adorer le Dieu de mon cœur. La danse me semble une apostasie momentanée, et presque une profanation.
— Ces raisons sont subtiles, j’en conviens, dit Melmoth, je n’y trouve qu’un défaut ; c’est de n’être pas assez flatteuses pour celui qui les écoute… mais n’importe la danse ou la musique ! il paraît que mon image est également pernicieuse dans l’une et dans l’autre. Celle-ci vous tourmente par des souvenirs ; celle-là par des remords. Mais je suppose que cette image vous soit retirée à jamais ; je suppose qu’il fût possible de rompre le lien qui nous unit et dont l’illusion a pénétré jusque dans l’âme de tous deux…
— Vous pouvez le supposer, dit Isidora, avec un mélange de fierté virginale et de tendre douleur ; et si vous le faites, vous pouvez croire que j’y ferai aussi mon possible de mon côté. L’effort ne me coûtera pas beaucoup… rien que… ma vie !
Melmoth contemplait cette belle et innocente créature, jadis si cultivée au sein de la nature, maintenant si naturelle encore au milieu de la civilisation, et conservant toute la douce richesse de sa première nature angélique, dans l’atmosphère artificielle où nul n’appréciait ni son parfum ni son éclat. Melmoth la contemplait, il sentait son prix et se maudissait lui-même. Puis avec cet égoïsme, compagnon d’un malheur sans espoir, il crut que cette malédiction serait affaiblie en se partageant ; et s’approchant de la fenêtre devant laquelle se tenait sa victime pâle et toujours belle, il lui dit du ton le plus doux qu’il lui fut possible de prendre :
— Isidora ! voulez-vous donc être à moi ?
— Que vous répondrai-je ? dit Isidora. Si c’est l’amour qui m’interroge, j’en ai dit assez ; si ce n’est que la vanité, j’en ai dit beaucoup trop.
— La vanité ! hélas ! vous ne savez ce que vous dites ! L’ange accusateur lui-même n’osera mettre ce péché au nombre des miens. Il est impossible que je le commette jamais. C’est un sentiment terrestre. Je ne puis, par conséquent, y participer ni en jouir. Il n’en est pas moins vrai que dans ce moment je sens un peu d’orgueil humain.
En prononçant ces derniers mots, sa physionomie prit en effet une expression d’orgueil si effrayante, qu’Isidora ne put s’empêcher de frémir. Tremblante et remplie d’inquiétude, elle lui dit :
— Voulez-vous donc être à moi ? Ou bien que faut-il que je pense de vos horribles discours ? Hélas ! mon cœur ne s’est jamais enveloppé de mystère. Jamais l’éclat de sa vérité ne s’est montré au milieu des éclats et du tonnerre, du sein desquels vous avez prononcé l’arrêt de ma destinée.
— Voulez-vous donc être à moi, Isidora ?
— Consultez mes parents ; épousez-moi selon les rites et en face de l’Église, dont je suis un membre indigne, et je serai à vous pour toujours.
— Pour toujours ! s’écria Melmoth. C’est bien dit, mon épouse ! vous voulez donc être à moi pour toujours ?… Le voulez-vous, Isidora ?
— Oui… oui… je l’ai déjà dit… Mais le soleil est près de se lever. Je sens la fraîcheur de la matinée ; les orangers exhalent un parfum plus fort. Retirez-vous… Je suis restée trop longtemps… Les domestiques ne tarderont pas à se lever ; ils pourraient vous apercevoir… Retirez-vous, je vous en conjure.
— Je pars ; mais un seul mot encore. Pour moi, le lever du soleil, l’arrivée de vos domestiques, tout ce qui est dans les cieux au-dessus de ma tête ou sur la terre à mes pieds ; tout, vous dis-je, est également indifférent. Que le soleil reste sous l’horizon et m’attende. Vous êtes à moi !
— Oui, je suis à vous ; mais il faut que vous sollicitiez le consentement de ma famille.
— Oh ! sans doute. Pourquoi pas ? Je suis si accoutumé à la sollicitation.
— Et…
— Eh bien ! Quoi ? vous hésitez.
— J’hésite, dit l’ingénue et timide Isidora, parce que…
— Encore ?
— Parce que, ajouta-t-elle en fondant en larmes, ceux à qui vous parlerez ne prononceront pas le même langage que moi. Ils vous parleront de richesses et de douaire ; ils vous demanderont des détails sur cette région où vous m’avez dit qu’étaient situés ces riches et vastes domaines ; et, s’ils m’en parlaient la première, que faudra-t-il que je réponde ?
À ce discours, Melmoth s’approcha, le plus près qu’il lui fut possible, de la fenêtre, et prononça un mot que, dans le premier moment, Isidora ne parut pas avoir entendu ou compris. Tremblante, elle réitéra sa demande. La réponse fut donnée d’une voix plus basse encore. N’osant croire à ce qu’elle venait d’entendre, et se flattant que ses oreilles l’avaient trompée, elle répéta, pour la troisième fois, sa question. Cette fois un mot épouvantable, impossible à redire, tonna dans son oreille. Elle poussa un cri perçant en fermant sa fenêtre. Hélas ! cette fenêtre ne lui déroba que la figure de l’étranger ! Son image restait gravée dans son cœur.
Source: http://fr.wikisource.org/wiki/Melmoth_ou_l%E2%80%99Homme_errant
Cet enregistrement est mis à disposition sous un contrat Creative Commons BY (attribution) SA (Partage dans les mêmes conditions).
Cet enregistrement est également mis à disposition sous un contrat Art Libre.
Cet enregistrement est également mis à disposition sous un contrat Art Libre.
Warning: Undefined variable $cookies in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 7
Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 7
Warning: Undefined variable $validcookiesStats in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 7
Warning: Undefined variable $cookies in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 134
Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 134
Warning: Undefined variable $validcookiesSoc in /home/audiocit/www/cookies-modules.php on line 134





